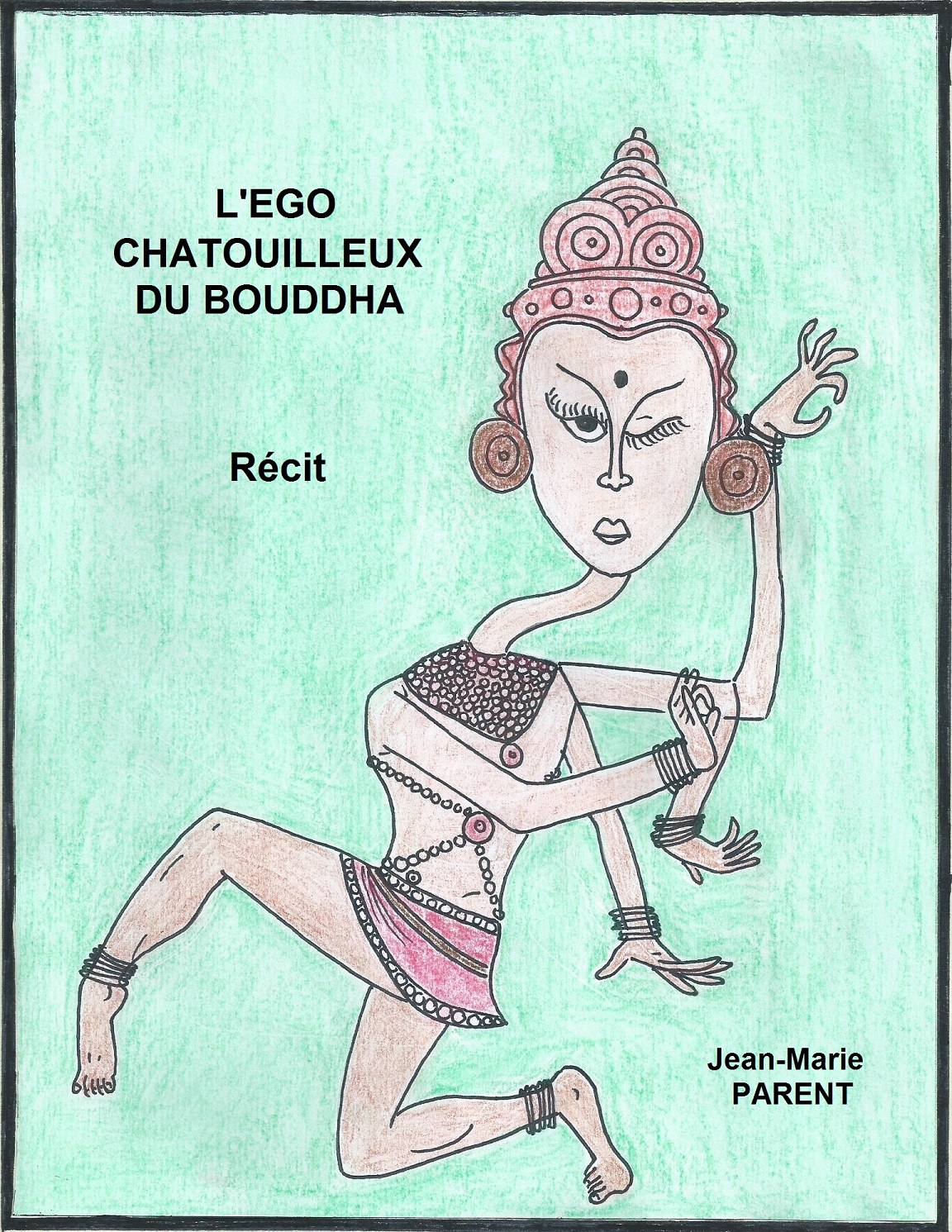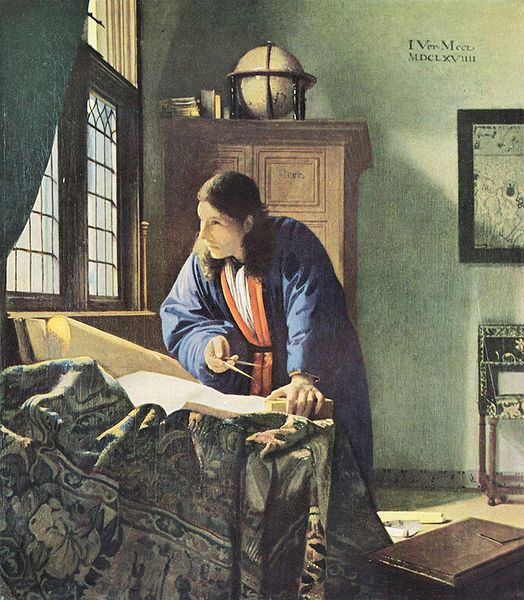mardi 7 juin 2011
LE "GRAND RECIT" DE MICHEL SERRES, ENTRE MEMOIRE ET OUBLI ...

dimanche 1 mai 2011
VERCORS : LA VIOLENCE DE LA HOULE SOUS "LE SILENCE DE LA MER"

« Désespoir est mort » : tel est le titre donné par « Vercors » (nom de code du Résistant Jean Bruller) à la préface de sa courte nouvelle Le Silence de la Mer, à l’automne 1941, date à laquelle il fonde aussi les Editions de Minuit. Comment passer du désespoir de la défaite à un « drôle » d’espoir « battant et combattant » ?
Curieusement, c’est le spectacle burlesque de la parade de quatre canetons passant sur un chemin, « claudicants et solennels, vifs, vigilants et militaires », qui allume une étincelle dans l’esprit du résistant abattu. « Ils ne cessaient de couiner. Ils faisaient penser à ces défilés de gymnastes portant orgueilleusement leur bannière… »
La vision amusée, insolite et revigorante, de ces canetons « fanfarons et candides » (dont le dernier, plus jeune, « se cassait régulièrement la gueule »), prend la valeur d’une fable rassurante – ou à tout le moins rafraîchissante – sur le désespoir « pervers et stérile » de ces hommes plongés en pleine tragédie de guerre mondiale. Désormais, c’est possible : le pire comme le meilleur peuvent habiter les esprits en alerte des résistants du petit groupe, et tout cela vaut la peine d’être vécu.
« Je sais que c’est à ces petits canards délurés, martiaux, attendrissants et ridicules, que je dus, au plus sombre couloir d’un sombre jour, de sentir soudain glisser de mes épaules comme un manteau trop lourd. » L’absurde, teinté de burlesque, en contrepoint au désespoir.
Le Silence de la mer ouvre un pesant huis clos à trois personnages. Mise en scène glaciale, réglée au cordeau, avec ses codes réitérés jusqu’à l’hypnose. Le monologue de l’officier allemand Werner von Ebrennac (nom qui ne traduit pas vraiment ses origines), forçant le logis d’un vieil homme et de sa nièce, se déroule en continu, aussi têtu que le silence lourd qui lui fait écho chez ses deux hôtes paralysés.
Chacun des trois cherche désespérément à sa façon des raisons … d’espérer encore, de croire à un au-delà de la situation présente en formulant un déni au drame réel qui se joue : celui de la guerre, de l’occupation pesante qui force, malgré soi, à douter des valeurs qui vous fondent.
Soldat allemand occupant, Werner est aussi un musicien cultivé qui admire la France et sa culture. Le monologue pathétique qu’il déroule au fil des soirées d’hiver face à ses deux hôtes muets, prend la couleur d’ultimes imprécations pour conjurer l’irrémédiable, lui donner un sens envers et contre tout, le rendre acceptable, en quelque sorte, au quotidien.
Le vieil homme donne à son silence obstiné la valeur d’une défense passive, tout en laissant planer les vagues et secrets vestiges d’un respect humain. De son côté, Werner pose la force du guerrier vainqueur face à « l’esprit, la pensée subtile et poétique » du pays vaincu, occupé. Son affection se mêle visiblement de tendresse pour la France, cette « Princesse lointaine ». La jeune nièce, elle, semble taire jusqu’à toute voix intérieure.
Werner fouille son passé, exhumant une vieille fidélité au patriotisme de son père, et plein d’espoir, à sa suite, sur l’émergence future d’une grande cause européenne. Encouragé par ces signaux qu’il juge positifs, le vieil homme replonge dans son questionnement humaniste : « C’est peut-être inhumain de lui refuser l’obole d’un seul mot… »
Mais Werner n’attend visiblement rien de ses hôtes, poursuivant sans fin son monologue grave, tentant de graver un peu de son « âme » dans la maison, le fumoir. Il caresse pieusement les reliures de la bibliothèque, égrenant, l’air rêveur, les grands noms de la littérature française. Et face au visage « impitoyablement insensible » du vieil homme, l’officier s’incline : « Je suis heureux d’avoir trouvé ici un vieil homme digne. Et une demoiselle délicieuse. » Il parvient à imposer sa séduction en invoquant la métaphore de La Belle et la Bête : « Il faut qu’elle (la France) accepte de s’unir à nous (l’Allemagne) ».
Ainsi s’écoulent « cent soirées d’hiver », sans que jamais ne se produise une seule violence de langage du dominant face à l’implacable silence des dominés : de quel côté est l’agression ?... peut-on se demander. Six mois d’espoir pour tenter de donner une image acceptable à une réalité que l’on souhaiterait moins souffrante.
Puis Werner s’absente quinze jours, au cours desquels le vieil homme évoque de possibles regrets et une inquiétude ; comme si la maison gardait la marque de la présence fantomatique de Werner. Mais au retour, c’est un autre homme qui apparaît, bouleversé. « Tout ce que j’ai dit ces six mois, il faut l’oublier. » La voix de Werner se fait sourde. Il a rencontré des compatriotes victorieux, il leur a parlé, ils ont ri de lui : « Nous ferons de la France une chienne rampante. » Il n’y a plus d’espoir.
« Ils éteindront la flamme tout à fait ! cria-t-il. L’Europe ne sera plus éclairée par cette lumière ! Nevermore !... Ô Dieu ! Montrez-moi où est MON devoir !... C’est le Combat, la grande Bataille du Temporel contre le Spirituel »… Werner part en campagne… « Pour l’Enfer ».
L’ultime regard de Werner pour la jeune fille arrache à celle-ci un premier – et dernier - mot : « Adieu », l’entend-on prononcer dans un souffle, à l’intention de l’officier. Ce dernier sort en esquissant, enfin, un vrai sourire.
Derrière la dernière vague vient s’échouer dans ce sourire vaincu … le silence de la mer.
dimanche 17 avril 2011
VATANEN ET SON LIEVRE, SAVOUREUSE FABLE ECOLOGIQUE

Comment déserter proprement une vie qui vous est totalement étrangère ?... Le premier lièvre venu fera l’affaire ! Vatanen, journaliste fatigué, blasé, malheureux, accablé par la vie, approche de la quarantaine et se sent bien loin des espoirs qu’il a nourris dans sa jeunesse. Marié, trompé, déçu, il endure un ulcère à l’estomac et bien d’autres soucis quotidiens.
Dans ces conditions, Paasilina nous souffle qu’un bon coup de patte du destin s’impose. Celui-ci prend les allures d’un lièvre blanc perdu sur une route forestière de Finlande, un soir d’été. Et lorsque le petit animal saute en l’air sur le capot de sa voiture, Vatanen n’imagine pas encore qu’il a ce pouvoir magique de transformer sa vie … Tenant sa future mascotte dans ses bras, Kaarlo Vatanen s’enfonce dans la forêt profonde …
« Un homme n’ pas le droit de disparaître comme ça ! », a beau clamer la femme de l’intéressé, cela ne changera rien à l’affaire. Vatanen est ravi de fuir et d’oublier un appartement aussi hétéroclite que le ménage qu’il forme avec sa femme, ou que son emploi dans un magazine par lequel il ne se sent plus concerné. Une soif de liberté totale embrase soudainement notre homme, aiguise son instinct, le laissant exprimer son souhait définitif au dos d’un billet laconique laissé bien en vue dans un hôtel de passage, à l’intention de ses proches : « Fichez-moi la paix. »
Et voilà « l’homme au lièvre » parti sans laisser d’adresse dans les forêts profondes qui peuplent la Finlande jusqu’au Cercle Arctique. De grange en cabane, son aventure est ponctuée par les soins à apporter au cher lièvre qu’il installe sans hésiter à ses côtés, sur une chaise, sur une table pour déguster une salade à même le saladier, ou sur le comptoir vitré d’un guichet de banque.
La suite s’annonce plus sauvage et pleine d’imprévus burlesques de toutes sortes. Ainsi apprend-il que la loi lui interdit d’adopter un animal d’une espèce protégée. Un garde-chasse croisé par le fuyard fournit à celui-ci une autorisation officielle complétée par des conseils précis portant sur les herbes préférées du rongeur (conseils assortis de croquis artistiques exécutés par le garde-chasse artiste). Un chauffeur de taxi aux tendances écologistes aide à la cueillette des fleurs.
Hélas, tout le monde n’est pas aussi bien disposé à l’égard de l’animal favori : Vatanen passe pour un fou auprès de paisibles habitants d’un village, et finit par se faire embarquer par des policiers benêts … presque heureux d’avoir enfin de la compagnie. Mais on va jusqu’à porter plainte contre l’écologiste de passage pour … trouble à l’ordre public !... lui qui « ne va nulle part et se promène simplement avec son lièvre… »
« Le levraut suit tranquillement l’interrogatoire », avec l’assurance de ne pas aboutir en cellule, « un endroit trop malsain pour un animal aussi fragile ! » aux dires mêmes des policiers. Et quand l’un des jeunes agents propose de prendre l’animal chez lui pour la nuit, Vatanen lui réclame tout de go une formation qui l’autorise à soigner les rongeurs sauvages ! On laisse le lièvre gambader librement sur le plancher du commissariat.
Enfin libéré, l'animal prend goût à la vie lacustre, grandit, grossit et se fortifie. Jusqu’à ce qu’un gigantesque incendie de forêt ne chasse toute la faune du secteur. Vatanen se dit que décidément la vie est pleine de surprises : « Plutôt mille fois ici qu’à Helsinki ! », sourit-il à travers ses larmes. Et l’on peut voir le touchant tableau de Vatanen marchant à travers bois, un veau sur l’épaule, suivi d’une vache « pensive », et du lièvre qui gambade en queue de procession. Tableau touchant et baroque, aux parfums écologiques troublants.
Pénétrant dans une petite église de campagne, le lièvre est poursuivi par un pasteur armé d’un pistolet et qui tire au jugé. Malchance et disgrâce, le saint homme ne parvient qu’à … se tirer une balle dans le pied ! Vatanen est ensuite embauché pour des travaux forestiers. Il croise un vieux bûcheron lapon à qui il enseigne … à nager. Puis, perdu dans la forêt, il fait la conversation à son lièvre qui l’écoute religieusement, mais … sans rien comprendre ! Il doit enfin se défendre contre un énorme corbeau noir qui dévalise ses vivres, l’abreuvant d’injures.
(...) Le lièvre de Vatanen finit par partager tout naturellement le repas des autres héros de la partie de chasse. Mais Vatanen ne peut résister à la tentation de boire un bon coup après six mois d’abstinence et se retrouve, après dégrisement, … fiancé à une belle jeune femme. Le lièvre, lui, a disparu. Leila, l’heureuse élue, n’en a cure et souhaite que Vatanen quitte la Laponie pour revenir enfin vers la civilisation. Cruel dilemme pour Vatanen qui n’arrive pas à se décider !... et n’évite pas une dernière foucade. Franchissant la frontière russo-finlandaise, il est capturé par les Soviétiques ; lui et son lièvre y resteront détenus deux mois.
La Finlande demande son extradition dans un document où sont consignés, à l’encontre de Vatanen, pas moins de … vingt deux chefs d’accusation, allant de la violation du pacte conjugal au franchissement de frontière sans passeport, en passant par le vagabondage et la pêche sans permis. Vatanen se retrouve en fourgon cellulaire avec son lièvre. Le lecteur garde cette dernière image du fuyard écologiste, dans sa cellule, caressant son lièvre avec la tendresse d’une mère … avant de s’évader une dernière fois pour tenter de se faire oublier !...
Vatanen, le roi de la poudre d’escampette, est un homme définitivement libre et heureux !
samedi 2 avril 2011
TINTIN AU PAYS DES PHILOSOPHES
 Il est des héros mythiques dont l’éternelle présence et la référence toujours disponible nous remplissent d’une joie vraie, spontanée. «Tin-tin » : vocable simple et familier qui chante à nos oreilles comme un retour bienfaiteur aux origines ; lieu d’apaisement autant qu’exhausteur de rire.
Il est des héros mythiques dont l’éternelle présence et la référence toujours disponible nous remplissent d’une joie vraie, spontanée. «Tin-tin » : vocable simple et familier qui chante à nos oreilles comme un retour bienfaiteur aux origines ; lieu d’apaisement autant qu’exhausteur de rire. Ce personnage de papier androgyne et sympathique, vecteur d’aventures aux parfums enfantins, semble porteur de neutralité, de transparence. Il est « l’enveloppe » de son lecteur et résonne comme un synonyme d’identification totale et de lecture palimpseste : on relit Tintin « ad libitum », de 7 à 77 ans, selon la formule bien connue.
Son créateur Hergé (pseudonyme pour « Rémy Georges ») a fait du « Secret de la Licorne » et du «Trésor de Rackham le Rouge », parmi 23 autres albums, de merveilleux exutoires aux rêveries enfantines. Récits elliptiques, textes ciselés, fameuse « ligne claire » des images : telle est la marque de fabrique de la fameuse BD belge.
Comme de bien entendu, les parents sont les grands absents de ces récits imagés qui insèrent des histoires dans l’histoire : gags burlesques des Dupond/t en jumeaux complices/ennemis, objets fétiches cachés-montrés, savoureux bestiaire enchanté (perroquets, lamas, requins …), répertoire ad libitum de jurons choisis comme autant de délicieux jeux verbaux. Tintin, «sur-enfant » faussement naïf, ouvre un accès naturel à l’impertinence, aux rêves, aux fantasmes. Bref au monde tel qu’il pourrait mieux aller.
En créateur malicieux, Hergé tient sans en avoir l’air le fil conducteur du psychanalyste. On verrait bien son héros en fils de Louis XIV comme lui-même se rêve en fils ...du Roi des Belges. A contrario, le chevalier De Haddoque, ancêtre du Capitaine, endosserait l’habit d’un fils - non reconnu celui-là - du grand Roi-Soleil. Toute généalogie suppose quelque secret de filiation bien caché, à l’image du trésor de Rackham le Rouge, enfoui dans les fondations du Château de Moulinsart. Et si le Chevalier De Haddoque revient hanter son irascible descendant, c’est qu’il y a toujours quelque chose à réparer du passé. La crypte du château pose la question du lieu caché des fondations, de même que le fond de la personnalité est porteur d’un secret enfoui dont tout bon fantôme est la figuration machiavélique.
Tintin, lui, en ado/adulte, se trouve libéré de tout lien généalogique. Le chien Milou est son miroir narcissique et sonne comme … le surnom du premier amour d’Hergé. Ainsi le couple Tintin/Milou se trouve-t-il le pendant idéalisé du couple séparé Hergé/Marie-Louise. Milou est le centre de l’affectivité de Tintin, sa dimension féminine en quelque sorte. D’ailleurs Tintin n’a-t-il pas le poil, attribut des « méchants », en horreur ?... Sauf à apprivoiser ces pilosités rébarbatives, il y a aussi un principe de rédemption par le poil, ou en dépit de lui. Sous le poil, l’humain peut toujours s’amender et devenir un gars… « au poil » ! Haddock en est l’exemple frappant (bien que demeure son penchant pour la bouteille !) Tintin / Hadddock / Tournesol : la « Sainte Trinité », elle, est intouchable.
Quant à la surdité tenace (pseudo ? à géométrie variable ?) de Tournesol, savant prototypique, elle lui permet de persister dans une curieuse obstination : se faire oublier, tout en répétant inlassablement quelques vérités imparables et donner à Hergé l’occasion de jouer avec l’originalité du récit.
Ironie et « gai savoir », fécondité dans la naïveté, le philosophe Michel Serres voit aussi une leçon de morale et d’histoire dans « Tintin ». Hergé est un autodidacte, un homme de curiosité. Son « Tintin » fait « marcher », fait penser les psychanalystes. Hergé s’imbibe de l’actualité de son temps, dans ses bons comme dans ses mauvais côtés, et la restitue d’une façon innocente et naïve dans ses albums. Le « Lotus bleu » prend place dans le contexte de la guerre sino-japonaise. « Objectif lune » annonce la période toute proche de la conquête spatiale et de l’inévitable espionnage industriel. L’album « Les sept boules de cristal » rappelle les excès coupables (et ici punis) des Occidentaux dans l’exploration des civilisations disparues.
Il n’est jusqu’aux animaux mis en scène qui n’annoncent des angoisses individuelles ou des travers de société. Ainsi, le perroquet, animal transmetteur de secrets, a la mémoire capricieuse. Il est l’oiseau de la répétition, de la duplication. Parole coupée, vidée de son sens, il est un peu l’animal-angoisse révélateur de nos incertitudes. C’est lui qui annonce en permanence l’irruption du parasite Séraphin Lampion, personnage fat, superficiel, auteur d’une famille nombreuse, envahissante, et de lieux communs persistants. A travers lui, Hergé annonce la société du spectacle en devenir (signe d’une démocratie duplicative), symbolisée dans la dernière scène du harcèlement médiatique prémonitoire… Scandale maximal : le Parc de Moulinsard transformé en immense kermesse populaire filmée en direct. De quoi faire se retourner le brave chevalier De Haddoque dans sa tombe !...
Hergé initiateur d’une BD porteuse d’une philosophie qui s’ignore ?... Sous la rêverie enfantine dort parfois une généalogie secrète.
La science-fiction se plaît parfois à transgresser les codes sociaux ordinaires en les inversant. Qui sont ces pompiers pyromanes zélés qui ont pour mission d’incendier toute maison abritant le moindre livre ? Terrifiants et insensibles, les hommes « à la salamandre » chargés d’exécuter ces autodafés légaux sont visiblement là pour entretenir un incendie purificateur qui n’est pas sans rappeler les bûchers de l’Inquisition cinq siècles plus tôt.
Un climat étouffant vous prend d’emblée à la gorge dans cette ville contemporaine. Omniprésents, image et son envahissent chaque foyer jusque dans ses recoins les plus intimes, n’accordant aucun répit à leurs occupants. Ce sont de vrais murs-écrans aux dimensions des pièces qui hantent les citoyens ordinaires à longueur de journées : ceux-ci n’ont d’autre possibilité que d’écouter, fascinés, les murs … qui ont aussi des oreilles. Tout un appareillage sophistiqué est mis au service de l’impérialisme des médias et du grand décervelage auquel procèdent en continu la publicité, les jeux, les feuilletons, les « infos » télévisées. On pense bien sûr au « Big Brother » de George Orwell dans sa fiction « 1984 », grand surveillant omniprésent sur les télécrans des domiciles privés. Une ambiance de dictature qui suggère à Bradbury une remarque toute simple : « Il y a plus d’une façon de brûler un livre ». L’une d’elles, peut-être la plus insidieuse et la plus radicale, étant de rendre les gens incapables de lire, par matraquage, paresse mentale, et lente atrophie de tout intérêt pour la chose littéraire. L’extinction de conscience accompagnant l’extinction par le feu.
Montag, le héros, pompier pyromane, a gardé au fond de lui une petite lueur d’esprit qui lui permet de continuer à rêver d’un monde différent. Il part pourtant de loin, estimant ses mains « contaminées » par le contact avec l’un des rares livres encore intacts. Et les questions se bousculent dans son esprit : « Qui fait ainsi le vide en nous ? Qu’y a-t-il derrière chacun de ces livres qu’on brûle ? »
Mais du côté de Beatty, le chef direct de Montag, le constat est sans pitié : l’accélération du « progrès » et la pression des médias de masse ont raccourci sans cesse les livres, les ont condamnés, abrégés, digérés. Pour les réduire au « gag », à la chute, à un résumé de dix lignes dans les dictionnaires. Le livre s’est volatilisé dans la dictature de l’immédiat. Et selon Beatty, c’est très bien ainsi, car selon lui, « Un livre est un fusil chargé dans la maison d’à côté. Déchargeons l’arme. Brûlons-le. Mettons en brèche l’esprit humain. Protégeons la paix de l’esprit… Place à tout ce qui ne suppose que des réflexes automatiques. Nous sommes les Garants du Bonheur. »
Montag ne se résout pas , se lance à corps perdu dans la résistance et prend le maquis. Il trouve en Faber un vieux résistant attaché à la cause littéraire et trouvant les mots justes pour la défendre … « Je parle du sens des choses. Là je sais que je suis vivant, assure ce dernier. Le livre a des pores, des traits, une texture : il donne des détails qui touchent la vie du doigt. Ils montrent les pores sur le visage de la vie. »
Et pourtant, en dépit de cette belle lucidité, Montag est amené malgré lui à incendier … sa propre maison. Et le voilà qui s’enfuit, poursuivi par l’implacable « Limier », mi-machine mi-animal : une « luminescence vert pâle » capable de retenir en un temps record … 10 000 constituants olfactifs sur 10 000 personnes !
Face à la puissance mécanique du robot, seule une ruse de sioux permet la victoire. Montag, tel une bête pourchassée, ne doit sa survie qu’au grand fleuve qu’il traverse dans l’obscurité. Il rejoint de nuit , en pleine forêt, un groupe de savants et d’universitaires qui, eux aussi, ont pris le maquis, à jamais en marge de la société totalitaire qui les étouffe. Il y a là comme le parfum d’un retour aux premiers âges de l’humanité. Chacun se charge du nom d’un grand écrivain qu’il a entièrement mémorisé pour en sauvegarder la mémoire vive : en chair et en os continueront de survivre Platon, Machiavel, Confucius, Shakespeare et bien d’autres …
En mentor éclairé de ces nouveaux hommes-livres, Granger résume la philosophie de leur combat : « Chacun doit laisser quelque chose derrière soi après sa mort : un enfant, un livre, un tableau ou un jardin. » Il reste à sauvegarder ce message en entretenant sa flamme intérieure : n’est-ce pas le meilleur remède contre toutes les formes d’incendie ? Et là c’est à notre tour, lecteurs, de jouer …
lundi 21 mars 2011
BERNARD SCHLINK : LE LISEUR ET L'ANALPHABETE

Jusqu’où peut mener la honte d’être analphabète ? Et la peur née d’une telle honte ?...
Hannah, 35 ans, amante mystérieuse et impassible, partage avec le jeune Michaël, 15 ans, le rite passionné – passionnel ? – d’une lecture quotidienne à haute voix. Un rite qui amène Bernhard Schlink et son narrateur, au mitan du récit, à lever l’insoupçonnable secret qui éclaire la destinée incroyable de cette femme. Un destin que l’auteur condense dans ces deux phrases : « Elle (Hanna) combattait depuis toujours, non pour montrer ce dont elle était capable, mais pour dissimuler ce dont elle était incapable. C’était une vie dont les élans consistaient à battre vigoureusement en retraite, et les victoires à encaisser de secrètes défaites. »
La vie d’Hanna la contraint à garder coûte que coûte le masque de ses origines. Tous ses efforts sont tendus vers un seul et même but : sauver sa propre image au prix d’années de prison qu’elle ne mérite objectivement pas.
Schlink, via son narrateur, enfonce le clou : « Avec l’énergie qu’elle mettait à maintenir ce mensonge de toute une vie, elle aurait pu apprendre depuis longtemps à lire et à écrire. » Jusqu’où, à quels excès, peut mener le déni de réalité ? C’est la question de la distance à soi-même qui se trouve posée là. A travers l’acte de tromperie infligé à l’autre.... et finalement à soi-même. Avoir peur pour les autres les rend vulnérables. Le problème d’Hanna trouve un écho inattendu dans l’histoire personnelle de son amant Mickaël et d’un père distant mais capable de formuler une question éducative centrale : faut-il mettre en avant l’idée de bonheur en lieu et place de celle de dignité et de liberté ?...
La réponse de Schlink, via le père de Mickaël, est sans ambages : « S’agissant d’adultes, je ne vois absolument rien qui justifie qu’on mette ce qu’un autre estime bon pour eux au-dessus de ce qu’eux-mêmes estiment bon pour eux. » Essayer d’ouvrir les yeux de l’autre, oui pourquoi pas. Mais en lui laissant le dernier mot, en lui parlant à lui et non à quelqu’un d’autre derrière son dos. Ou en plaquant sur lui des points de vue factices par une justification en valeur d’excuse qui n’en est pas une. Avoir peur pour ses enfants les rend vulnérables. Alors bien sûr Schlink tempère : « En tant que père, être incapable d’aider ses enfants est une expérience quasi-intolérable. »
Liseur d’émotions contre analphabète de l’âme. Là est le vrai débat. Essayer/éprouver la tonalité de sa voix, propre et unique, face au monde et à ses résistances, c’est cela trouver sa voie. Nul ne peut réaliser à la place de l’autre cet apprentissage d’une langue universelle : celle, infiniment précieuse, irremplaçable, des émotions, des sentiments. Vouloir se substituer à l’autre dans cette entreprise ne conduit qu’à l’insécuriser pour plus tard, à installer au cœur des personnalités des stratégies hésitantes, des peurs coupables, des silences paralysants, des impuissances durables.
Curieuse homophonie de langage que celle qui rapproche « je me suis tu » et « je me suis tué ». Comme si autour de soi s’installait une chape de plomb qui dicte le silence. Notre rapport au dire, à l’écrire, ou à « l’apprendre à lire » - tous trois codes d’une même participation au monde – rappellent sans fin de premières expériences , souveraines ou douloureuses : ne pas être écouté, entendu, compris reconnu, au cœur de ces aventures originelles, peut suffire à se forcer à se murer dans un silence de mort.
Il faut apprendre à repérer ces gestes symboliques qui en disent tant. Le mécanisme d’auto-protection qui s’incarne dans le mouvement instinctif des deux bras que l’on place devant son visage pour se protéger de coups qui risquent de pleuvoir. Ou encore les doigts placés verticalement sur la bouche de celui qui écrit dans le silence : « Ce secret que j’écris ne peut se dire. » Ainsi peut-on s’enfoncer très tôt et durablement dans les souterrains de sa personnalité. Ce qui est impossible à dire, « l’indicible », se fait de plus en plus impossible à entendre avec le temps. Dans ce silence forcé, forcené, on finit par ne plus s’entendre soi-même … allant parfois jusqu’à s’inventer des récits à la troisième personne pour se décharger du poids de sa propre vie, devenu intolérable. Ou pire, à confondre sa honte avec une moralité bien assumée : la pudeur, surtout fausse, pourrait-elle rendre muet celui qui fuit ce qu’il ressent comme de vagues poisses d’obscénité.
Schlink place dans le personnage d’Hanna l’image d’une énergie inversée, tournée contre elle-même et niant le monde. C’est son secret inavouable qui va la conduire à mener le rôle involontaire de bourreau anonyme dans « l’administration » d’un camp de la mort. Hanna appartient à ce type humain « taiseux », en mal d’éducation, pour tout dire misérable, qu’ont toujours cherché à s’acoquiner les régimes totalitaires, les religieux fanatiques ou les monarques absolus, en vue d’accomplir leurs basses besogne de conservation du pouvoir à tout prix. Apeurés, dociles, sans recul, ils sont les instruments tout désignés dont on n’est sûr qu’aucune prise de conscience, aucun surmoi tapageur ou tyrannique, ne viendra gêner l’activisme aveugle.
Ainsi Hanna est-elle jugée et condamnée pour avoir été l’un de ces innombrables bourreaux anonymes dont l’indifférence apparente à l’égard de leurs victimes semble d’emblée incompréhensible et révoltante. « Où est la solidarité, le respect de la vie ?!... », s’insurge Schlink. Mais ces valeurs n’en ont – de valeur – qu’aux yeux de ceux qui ont la faculté de se parler à eux-mêmes, de parler aux autres, de s’expliquer, de comprendre et d’ajuster leurs moyens d’action au monde. Avec justesse. Justice.
Le drame secret d’Hanna – son analphabétisme ancré, assumé – s’est peu à peu mué, à son insu, en drame social : les manques primaires de son histoire ont fini par rejoindre fatalement les brutalités sans nom de l’Histoire. Ce destin-là, que rien n’est venu détourner à temps, semblait écrit comme bien d’autres. Les bourreaux consentants se construisent souvent à l’ombre de victimes silencieuses.
Michaël, bouleversé par cette vérité, veut à la fois condamner et comprendre après coup le crime d’Hanna. Une chose et son contraire, le grand écart impossible : une impasse. Hanna n’est pas une criminelle : elle n’est qu’une femme faible, paralysée, qui s’est laissé embarquer comme surveillante obéissante d’un camp. Et quand viendra l’heure de la condamnation, elle ne saura, elle ne pourra se défendre, incapable qu’elle est de lire l’acte d’accusation. Rejointe par son passé.
La victime d’analphabétisme, forme d’anorexie, acte manqué en réponse à l’incompréhension du monde, clamera toujours son désir de justice auprès de liseurs lucides et impuissants. Hanna finira, sur le tard et en prison, par faire cet effort d’apprendre à lire. Par amour, grâce à des cassettes sonores enregistrées et envoyées par Mickaël. Ce dernier raconte : « Je relisais à l’époque l’Odyssée. Ulysse ne revient pas pour rester mais pour repartir. L’Odyssée est l’histoire d’un mouvement qui à la fois vise un but et n’en a pas, une histoire de succès vains… Je me suis mis à lire à haute voix, à lire pour Hanna … »
Pour Hanna, « l’éternel retour » aura été bien tardif ! Mais qu’il est long de faire la paix avec son histoire !…
dimanche 6 mars 2011
JEAN DE LA FONTAINE : PLUME VIVE ET LEGERE SUR LE FIL DE LA LANGUE

Les villes et la campagne, enfin tout,
Il n'est rien qui ne me soit souverain Bien
Jusqu'aux sombres plaisirs d'un coeur mélancolique "
Ainsi parle l'homme qui conçut le dessein de "se servir des animaux pour instruire les hommes". Mais d'où vient chez lui ce secret qui est la quintessence absolue de l'éblouissement de la langue ? La Fontaine, ce n'est certes pas la belle langue " à la Saint Simon ". Non, plutôt la langue inventive, vivante, émouvante. D'une beauté faite de douceur, de vélocité, de discrétion.
Sens de la rupture, richesse (jamais docte pour autant), fluidité, rigueur, liberté au milieu de la contrainte. Fond et forme au service d'une même force philosophique du propos. Et tout cela s'enracine dans des situations de la pleine vie. Tel " L'homme et la couleuvre " :
" S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde
A qui pourrait-on pardonner ? (.../...)
On en use ainsi chez les Grands : la raison les offense
Ils se mettent en tête que tout est né pour eux :
Quadrupèdes et gens et serpents
Si quelqu'un desserre les dents
C'est un sot j'en conviens
Mais que faut-il donc faire ?
Parler ou bien se taire ?... "
Belle illustration de la difficulté extrême à se confronter au pouvoir en tout temps. Ainsi le classicisme du XVIIè siècle engloberait-il dans un même souffle l'académisme officiel du règne des puissants et la liberté insolente de quelques poètes de génie. La Fontaine est un réceptacle, un passeur qui traîne avec lui toutes les mythologies de la vie : Antiquité, Renaissance, tout. S'y mêle même la légèreté colorée, pittoresque, quasi intemporelle propre au haïku asiatique :
" Une tortue était à la tête légère
Qui lasse de son trou
Voulut voir du pays ..."
Jusqu'à nous questionner dans les dérives consommatrices de nos sociétés contemporaines. Le poète se pose en adversaire résolu du cogito cartésien, s'en prenant avec vigueur à l'idée de l'animal-machine. Que dirait La Fontaine aujourd'hui face aux excès de nos élevages industriels ? Ou plutôt que ferait-il dire aux animaux du XXIè siècle ?...
En homme de la morale commune, le fabuliste écrit toujours comme pour argumenter face à de potentiels contradicteurs. Invitant à la sagesse, il nous fait sentir aussi l'insuffisance de toute sagesse.
" La mort ne surprend point le Sage
Je voudrais qu'à cet âge
On sortît de la vie ainsi que d'un banquet "
Là est sa participation au grand "memento mori" qui parcourt l'Occident depuis l'Antiquité jusqu'à Nietzsche : " Comme on voit bien derrière chacun se dresser son ombre, son obscur compagnon de route. J'aimerais leur rendre l'idée de la vie encore mille fois plus digne d'être pensée ". Et, plus près de nous, jusqu'à Jankélévitch : " La mort lorsqu'elle arrive, arrive toujours pour la première fois et nous trouve invariablement démunis ".
La Fontaine, artisan de la précision et de la souplesse de notre langue. Patient alchimiste, aussi, du liant tragi-comique des situations où il nous plonge. Ainsi dans "L'ours et l'amateur de jardins" :
" Il est bon de parler et meilleur de se taire
Mais tous deux sont mauvais dès lors qu'ils sont outrés ...
Les jardins parlent peu si ce n'est dans mon livre ...
Le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé
Le lance avec raideur
Casse la tête à l'homme en écrasant la mouche
Et non moins bon archer que mauvais raisonneur
Raide mort étendu sur place il le couche
Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami
Mieux vaudrait un sage ennemi "
" Je suis ébloui du retentissement subjectif que les oeuvres produisent sur nous ", notait Roland Barthes. L'amitié maladroite comme le surinvestissement amoureux peuvent donc tuer ! L'homme cerné d'affects et de solitudes.
Aux yeux de Louis Ferdinand Céline, " Il y a très peu de stylistes. Le plus grand, c'est La Fontaine : c'est fin, c'est ça et c'est tout. " Même rejet de la lourdeur chez les deux écrivains. Et ce mélange de l'argot rural avec la grande langue du XVIIè chez La Fontaine. Les deux ont en commun d'avoir su "oraliser" la structure de la langue, d'avoir injecté charme et fluidité dans cette oralité. Infinie richesse des mots au service du " parler vie ".
Jubilation du rythme. La Fontaine anticipe le "slam" moderne de la langue dans le savoureux "Conseil tenu par les rats" :
" Un chat nommé Rodilardus
Faisait des rats telle déconfiture
Qu'on n'en voyait presque plus
Tant il en avait mis dedans la sépulture ...
Leur doyen personne fort prudente
Opina qu'il fallait et plus tôt que plus tard
Attacher un grelot au cou de Rodilard. "
" Amor fati " murmure le philosophe Jean au fabuliste La Fontaine : des Anciens il faut accepter tout, y prendre le meilleur.
" Je chante les héros dont Esope est le père
Troupe de qui l'histoire encore que mensongère
Contient des vérités qui servent de leçons
Tout parle en mon ouvrage et même les poissons. "
mercredi 23 février 2011
JANKELEVITCH : PENSER LE VOLATIL

Quelque chose a été vécu, réalisé, qui s'inscrit pour toujours dans une " sempiternité ". C'est l'irrévocable dont peuvent témoigner les rescapés de la mort.
Modulation haut perchée, la voix de Jankélévitch chante juste et faux. Il digresse sans jamais se perdre, improvise, pense par métaphore, sa façon à lui de faire cours/t (dans la Sorbonne familière). Sa philosophie ne cherche pas à saisir, à cristalliser, mais laisse entrevoir le " je ne sais quoi " ou son cousin proche, le " presque rien ". Comme un mystère concret qui existe indubitablement ... et disparaît l'instant d'après. La note, la parole, le cri , le souffle... Le temps porte cet indéterminé par excellence : je sais que le temps est, mais je ne sais pas ce qu'est le temps. Je sais que je suis ... mais qui suis-je ?...
Propulsés au coeur de ce temps, René et Descartes se regardent l'un l'autre, se saisissent en train de penser. Le funambule se demande, l'espace d'une fraction de seconde, ce qu'il est en train de faire ... et chute ! Je suis, j'existe, et cette vérité sera toujours vraie chaque fois que je la concevrai. Le "je" est contenu dans l'instant, la fulgurance, l'apparition/disparition.
La musique joue le langage de l'indétermination. Son expression multivoque nous ouvre des horizons à déployer. Quant aux idées en fuite, on ne les cherche pas parce qu'elles sont géniales, mais elles sont géniales parce qu'on les cherche. Subtile inversion des causalités. On touche au coeur de la nostalgie selon Vladimir : crissements, odeurs, parfums, se chargent d'affectivité. De menus détails sont porteurs d'un sens profond lié à notre vérité humaine. Mais des idées en fuite, il nous faut faire le deuil.
L'horizon des possibles irrigue le futur, l'horizon de l'impossible défait le passé. Le futur se dit dans l'architecture urbaine, le passé dans l'Eden, dans les brumes du Jardin Perdu disponible à l'errance. La musique est de l'ordre du jardin, de l'inutile, de l'impossible : rêver, chanter, poétiser, peindre, sont les seules attitudes viables face au passé.
" Si l'Homme a un bel avenir derrière lui, c'est parce qu'il a devant lui un vaste passé. " Lorsque l'énigme se met à tutoyer la clarté...
Fils du traducteur de Freud et de Hegel, nourri de culture grecque, juive, chrétienne et russe, Jankélévitch pointe la tragédie de toute culture : la vie qui en est la source porte en elle des forces contraires. Et l'homme est cet être "mitoyen" constamment soumis au mouvement alternatif du pendule cher à Schopenhauer : il sait qu'il va mourir, mais il ne sait pas quand. La vie n'est vivante que parce qu'elle est promise à la mort. On ne peut être et savoir que l'on est. " Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait !... "
L'avoir été est inscrit dans l'avenir comme porté par un " presque rien " incomparable. Et l'univers tout entier ne serait pas ce qu'il est sans l'idée d'un enfant gazé à Auschwitz. L'affectivité profonde marque de sa trace ineffable ce que nous fûmes. L'indignation infinie jaillit d'un rapport silencieux à l'indicible : pour le philosophe, le pardon est mort ... dans les camps de la mort.
La pensée morale de Jankélévitch nous ramène à une vie vécue selon l'ordre du coeur. Il s'y développe une réflexion sur l'existence de la conscience dans le temps. Le philosophe du devenir, à l'instar de son maître Bergson, se propose de surprendre en équilibre, en " flagrant délit ", la fine pointe de l'instant. La vie ne serait-elle finalement que cette mélodie éphémère arrachée à l'infini de la mort ? ...
Celui qui a vécu ne peut plus " ne pas être " : " Désormais, ce fait mystérieux, profondément obscur, d'avoir vécu, est son viatique pour l'éternité " (L'irréversible et la nostalgie).
On peut avoir été ... et continuer d'être. Volatile éternité.
mercredi 9 février 2011
BLAISE CENDRARS : UN ELOGE DE LA PARTANCE

Le jeune Blaise, encore adolescent, saute par la fenêtre, attrape le premier train, chemine là où ses pas le mènent, au hasard des ruelles, des sentes, des chemins de traverse. Rupture et partance. L'homme est ainsi. Il fait son latin à cheval, passe le bachot... et repart. En rimbaldien féru, Blaise chante l'éloge du perpétuel départ au goût d'universel, dans une rumeur toujours neuve. Il meurt si on l'attache.
Chacune de ses missives se colore d'un " ... et il y a encore quelque chose ". C'est du pays que vient ... le mal du pays. Le mal c'est l'appartenance. Comme Gary, Cendrars est l'homme de l'inappartenance, y compris à l'égard de son oeuvre. Le bourlingueur a choisi de mêler dans son nom la cendre ... et l'art. Destin singulier. Toute vie n'est qu'un poème pour cet amoureux de l'errance.
La fluidité de son écriture est celle de l'écrivain-voyageur toujours prêt à embarquer pour planter son regard dans le monde tel qu'il va. Dans sa malle : ses manuscrits en cours, sa Remington portable, quelques vêtements, deux paires de godasses, des kilos de papier blanc... Traversée de dix huit jours de Pernambouc à Cherbourg. Et ce rêve fou de charger avec lui un magnifique fourmilier au nez en forme de bannière, marchandé à un vieux nègre borgne. " Avoir un emmanché comme celui-là vous fait rire du matin au soir ! "
Au gré de sa vie idéale - sur un bateau bien sûr - l'homme aura tout le loisir de penser à ses "sept merveilles du monde ", toutes prosaïques au possible : le roulement à bille, la publicité, l'argent, la musique de son ami Erik Satie ... et la nuque dénudée d'une femme. Sans oublier la merveille des merveilles : le don de création.
" Quand tu aimes il faut partir
sentir chanter courir
Respire marche pars va-t-en "
La poésie, la vraie, n'a pas de patrie. Le stylo de Cendrars caracole. Et lui est en bras de chemise, sifflotant. Ou s'amuse avec un dictaphone, inventant une polyphonie de voix amicales. Blaise a le goût du risque. Ecrire est pour lui la chose la plus dure, il l'avoue. Ecrire, c'est peut-être abdiquer. A qui veut l'entendre, il professe un mépris pour la chose écrite. La poésie est toujours en jeu. A l'image de ce poème-énigme qu'il a caché-cloué dans la caisse d'un grenier de campagne... " Au coeur du monde " : l'homme " de la main droite " (d)écrit une promenade nocturne dans Paris. Orion, c'est son étoile, sa main droite perdue à la guerre et montée au ciel. Cendrars se met dans ses propres pas, mais le poème se refuse à lui pour devenir ce texte "antipoétique" qui conduit à la prose, malgré son auteur.
L'aventure continue, neuve et fluide. Blaise reste un an à Rome, à faire ... du cinéma. Puis débarque à Hollywood, là où " toutes les rues mènent à un studio ". Cendrars entre fascination pour l'image et humour naïf : " J'avais l'intention de tourner un couple d'éléphants en train de coïter. Je n'ai pas réussi. " Quant au "filmage" de la classique parade du baiser amoureux, il énumère avec délice la liste des cinquante personnes nécessaires au tournage de la scène. Depuis les deux acteurs jusqu'au ... "producer".
L'ami Doisneau photographie Blaise écrivant, dans le vieux Aix : figure de l'écrivain solitaire face à un mur lisse, à la lumière d'une ampoule nue. Cendrars évoque l'oiseau rare s'envolant d'une clairière de la forêt brésilienne : le "Septicolore", ahuri et passif, a l'oeil lucide de l'oiseau halluciné, et un peu du panache... du champignon atomique de Bikini !
Le rêve est son autre voyage : " Je rêvais que je volais comme un oiseau, battant des bras, des jambes "... Avant de se voir "couillonné" au réveil, avoue-t-il, hilare. Blaise se rêve aussi, se voit, se plaît "à poil" sur le pont d'un bateau, lors d'aubes qu'il aime à se décrire... pour lui. Toujours en partance dans sa tête. " Le langage est une chose qui m'a séduit, formé, perverti. Correct... incorrect, mais bien vivant "
" Toute vie n'est qu'un poème, un mouvement. Je ne suis qu'un mot, un verbe, une profondeur, dans le sens le plus sauvage, le plus mystique, le plus vivant ", écrit Cendrars en 1913 à propos de La Prose du Transsibérien. Eloge de la partance, la nôtre cette fois, dans l'oeuvre-monde de l'écrivain voyageur.
" Pourquoi j'écris ? Parce que. " Apothéose sibylline d'une langue crépitante.
lundi 31 janvier 2011
QUENEAU ET SA " ZAZIE " : UN BOUQUET DE GOUAILLE ENFANTINE
 Mais "doukipudonktan ? " se demande Tonton Gabriel, se tamponnant le tarin de Barbouze de chez Fior. Queneau lance ainsi la virée burlesque de sa nièce Zazie dans Paris. Une gamine effrontée que cette "mouflette cambrousarde", qui n'a pas froid aux yeux et affronte le monde adulte sans complexe, avec un culot digne des Titis et autres Gavroches parigots, "les coudocor".
Mais "doukipudonktan ? " se demande Tonton Gabriel, se tamponnant le tarin de Barbouze de chez Fior. Queneau lance ainsi la virée burlesque de sa nièce Zazie dans Paris. Une gamine effrontée que cette "mouflette cambrousarde", qui n'a pas froid aux yeux et affronte le monde adulte sans complexe, avec un culot digne des Titis et autres Gavroches parigots, "les coudocor".Et Queneau poursuit sa jubilante balade urbaine de bistrot en coinstot, où le jeu consiste à repeindre la langue aux couleurs de la plus pure phonétique et du parler poulbot. "Snob mon cul", entonne la mouflette en guise d'entrée en matière. Et quand l'oncle Gabriel lui propose la visite des Invalides en guise de plongée dans l' "métrolleybus", la réponse fuse, sèche : "Napoléon mon cul ! Il m'intéresse pas du tout, cet enflé, avec son chapeau à la con ! "
Le savoureux perroquet Laverdure donne la réplique, de manière aussi réitérée que sibylline : "Tu causes, tu causes, c'est tout c'que tu sais faire !...". Zazie egzamine éberluée tout ce petit monde : "Et çui-là ki cè ?... " Elle ne rêve que du métro et de Singermindépré, la gosseline, on ne lui enlèvera pas ça de l'idée ! Mais Tonton Gabriel veille sanxaenèlèr : " La rue, c'est l'école du vice " prévient-il, et gare aux papouilles zozées !
Zazie apprend vite, "assèche un demi à bulbulements, expulse trois p'tits rots et se laisse aller, épuisée", avant de goûter aux joies de la Foire aux Puces, "là où on trouve des rambrans pour pas cher". Stoppée net devant un achalandage de surplus, aboujpludutout : " Izont des blouddjinnzes !..." Et tant pis s'il y a des croquants ki n'aiment pas squi est raffiné !
Les lourdingues, rombières, satyres, galapiats, gougnafiers, guidenappeurs et autres fleurs de nave en prennent pour leur grade. Les "nomdehieu, nomdguieu, lagoçamilébou, exétéra..."se profèrent par bordées. Mais, comme pour rattraper, il y a aussi "des médzavotché, des oeillades aphrodisiaques et vulcanisantes, des commissures labiales, des ombres quasiment anthropophagiques et des lamellibranches forcées dans leur coquille avec une férocité mérovingienne."
Queneau s'invite lui-même au détour d'une phrase, tel Hitchcock apparaissant fugacement dans ses films : "Toute cette histoire, à peine plus qu'un délire tapé à la machine par un romancier idiot (oh ! pardon)." Puis il n'hésite pas à faire valser les conjugaisons : " Gabriel fermit les yeux et se tournit vers le type... Elle lui foutit un bon coup de pied sur la cheville."
Zazie la mouflette, elle, sait ce qu'elle veut : "Je veux aller à l'école jusqu'à soixante cinq ans. Je veux être institutrice pour faire chier les mômes, pour leur larder la chair du derche... Sinon, je serai astronaute pour aller faire chier les Martiens !..." A défaut de métro, la môme est embarquée malgré elle dans un lot de touristes grouillants : " On veut ouïr ! On veut ouïr ! Kouavouar ? Kouavouar ? " Foin de bâille-naïte, tonton Gabriel est promu archiguide de tout ce petit monde aux cris de "Montjoie Sainte Chapelle ! ouvrez grands vos hublots, tas d'caves !..." A quoi tous ces cons répondent par la nécessité d'un pourliche.
Conséquences emmerdatoires et déconnances variées amènent les uns et les autres à quelque surenchère métaphysique : " La vie, un rien l'amène, un rien l'anime, un rien la mine, un rien l'emmène..." " Oui, surenchérit Laverdure, facétieux : nous ne comprenons pas le hic de ce nunc, ni le quid de ce quod ", " Quelle colique que l'egzistence ! " Et quand une rombière a "un fleurte terrible avec le flicmane Trouscaillon", Zazie poursuit ses découvertes au gré des apibeursdétouillou et des "politesse mon cul." " J'veux ottchose", clame-t-elle ("que la ffine efflorescence de la cuisine ffrançouèze")... " " Et pourtant, isi connaissent en bectance, les enfouarés ! "
" Les pas marrants, dit Zazie en asséchant un glasse, j'les emmerde. " Et d'ailleurs, Tonton Gabriel se voit bientôt en prise avec la "meute limonadière". " Tapage nocturne, chahut lunaire, boucan somnivore, médianoche gueulante... " Tous les signes de l'hécatombe finale (digne de celle de Brassens au marché de Brive-la-Gaillarde) s'accumulent devant la gosseline épuisée mais reconnaissante pour son oncle : " T'étais bath, t'as vraiment été suprême !"
Et lorsque Jeanne Lalochère la récupère, la môme dort debout. A la question immanquable : "Alors, qu'est-ce qu'est-ce que t'as fait ?...", Zazie expire dans un souffle : " J'ai vieilli ".
jeudi 20 janvier 2011
LE TARTUFFE IMPOSTEUR : MOLIERE ET LA COMEDIE DE LA CONSCIENCE DUPEE

Courir le risque d'être " tartuffié " : voilà bien ce qui guette chacun, quel que soit son siècle ou son groupe social. Molière prévient :
Déclaration douce-amère propre à la société-spectacle en place sous le Grand Règne, comme à toute mise en scène -intemporelle- d'un moi coupable et pathétique.
" Et je ne suis rien moins hélas ! que ce qu'on pense.
Tout le monde me prend pour un homme de bien,
Mais la réalité pure est que je ne vaux rien. "
Aveu cruel que celui qui révèle le réel derrière le masque. Molière dévoile sans détour la fausse bonne conscience qui se revêt des atours de la tromperie. Le Tartuffe, imposteur par nature, prend l'autre pour une ... "truffe" (quasi homonymie, mi-familière mi-vulgaire, du mot "tartuffe", et autre sens de ce mot). Pour que le mécanisme de l'usurpation fonctionne, il faut être deux : le trompeur et le trompé, le duplice et son complice. Et que chacun tienne son rôle sans faillir ! La tartufferie est un plat qui se mange chaud, en pleine connivence. Tartuffe, forçat évadé, est tel qu'Orgon l'invente, le veut, le rêve : réceptacle de tous les péchés du monde, rédempteur improbable et messie malgré lui.
C'est un mal bien profond que l'imposture, puisqu'elle se pare des apparences de la vérité -confisquée- assénée au nom d'un Souverain Bien... hypothétique, symbolisé par une religion intimement associée au pouvoir royal de l'époque. Arme imparable contre les dissidences de toutes natures, sauf-conduit passe-partout où se complaire ouvertement sans risque d'être critiqué : bienheureuse surenchère !
Or il s'agit rien de moins que de transformer le sacré en instrument de violence, d'agression. Le Tartuffe, expert en dissimulation, se cache derrière une pureté qui n'existe pas, car étrangère au monde tel qu'il est : l'imposteur se nie lui-même comme il nie le monde. Le Tartuffe tient commerce occulte avec une sorte d'obscénité secrète et, sommet de (mauvaise) foi, se veut et se fait le justicier du Ciel. Comble de la tromperie pourfendant... la tromperie !
" ... Que j'ai de quoi confondre et punir l'imposture,
Venger le Ciel qu'on blesse, et faire repentir ... "
Il se déclare l'alpha et l'oméga du Bien et du Salut à administrer aux autres :
" Dans l'amour du prochain sa vertu se consomme
... Et par charité pure, il veut vous enlever
Tout ce qui peut faire obstacle à vous sauver. "
Pureté, dureté infaillible, il est la voix de l'Inquisiteur, prêt à faire abjurer tous ses proches :
" ... Et je sacrifierais à de si puissants noeuds
Ami, femme, parents, et moi-même avec eux. "
Il se pose en prototype, en porte-parole avoué de tous les fanatismes, même les plus larvés, des prosélytismes de tous bords (religions, sectes , communautarismes, clans, castes et processions ...) qui tiennent à tout prix à se donner raison pour étendre leur emprise sur les esprits. Molière ne dénonce pas là seulement les "faux-monnayeurs en dévotion", mais aussi les "gens de bien à outrance". Le théâtre, royaume de l'apparence, a bel et bien la vertu de dénoncer les façades mensongères. Imposture et folie s'écartent de la norme : c'est le mérite de la comédie de le révéler. Ce lieu des masques est par excellence celui où l'on ... démasque. Tartuffe n'avoue jamais, ne tombe jamais le masque : il faut le lui arracher à la fin de la pièce.
Apparence contre réalité, double langage contre bonne foi, illusion contre connaissance, tutelle contre liberté : et si toute religion renfermait en elle-même les ferments de sa propre parodie, à travers cette propension têtue à convertir les âmes ? Projet suspect que celui qui pousse tout homme à renoncer à son intégrité naturelle pour ... se tartuffier lui-même !
Molière, en défenseur élégant et subtil d'une morale du "juste milieu", nous rend à notre lucidité et à notre liberté de conscience. N'en déplaise aux dévots et justiciers de tout poil !... Renvoyant duperie et complaisance dos à dos, Orgon, enfin délivré, peut s'écrier (un peu excessif) :
" C'en est fait, je renonce à tous les gens de bien ... "
lundi 10 janvier 2011
SCHOPENHAUER : ENTRE TRAGEDIE ET COMEDIE, " LE MONDE COMME VOLONTE ... "

De la tendresse blessée à l'endurance fragile, de la caricature forcée à la vérité intérieure, de la tragédie à la comédie, le pendule ne cesse d'osciller ... Arthur Schopenhauer s'est patiemment forgé, aux yeux de l'histoire, le visage douteux du personnage antipathique. Grincheux, misanthrope, avare, arrogant, réactionnaire, l'homme affiche tous les traits du "bouffon" qu'il prétend mettre au jour et sublimer dans sa propre philosophie.
Comment le vouloir vivre est-il la racine de tous nos maux ? Quel est cet arrière-plan du désir que nous ne maîtrisons pas et qui nous dirige ? L'amour n'est-il qu'une ruse de la raison en vue de perpétuer l'espèce ?... L'intérêt de ces questions n'est pourtant pas douteux.
Moment fondateur pour Arthur, futur "Homme des Lumières" : lorsqu'à seize ans, il croise des bagnards enchaînés dans le port de Toulon. Il s'y imprègne là, définitivement, de la condition humaine comme de toute la souffrance du monde.
A trente ans, le philosophe a clos son oeuvre : "Le Monde comme volonté et comme représentation "(1818). L'homme pratique la flûte chaque matin; la musique est pour lui ce calmant qui apaise l'absurdité du vouloir vivre. En contemplatif, il opte pour l'art qui suspend la douleur, exhausse le désir ardent... de ne plus désirer.
Dans la lignée des grands moralistes français, Arthur se fait le penseur des inconvénients d'exister face à un monde qu'il déclare absurde : pire que l'ennui est la tentation d'en sortir par de vains divertissements. Le vrai plaisir est désincarné : c'est l'art qui nous confie la vérité du monde. Le génie, lui, relève de la contemplation : il peut isoler au sein de la nature un objet et, le représentant, il en saisit l'essence. Arthur élève la contemplation esthétique à l'ambition d'une épure : un arc-en-ciel s'immobilise au-dessus du " cafouillis phénoménal " ressenti et subi par l'homme du commun.
A travers l'image du " deuil éternel du monde ", nous participons de l'éternité. La métaphysique d'Arthur fait ici écho à celle de Platon : épure et arrière-monde. Derrière l'image "goethéenne" de la volonté de vivre se profile le regard que notre volonté s'accorde à elle-même : il faut aimer la vie malgré elle, malgré son balancement permanent de la souffrance à l'ennui. De la négation de la douleur peut naître la contemplation.
Un demi-siècle plus tard, Nietzsche vénérera l'homme Schopenhauer comme éducateur, caractère noble, philosophe et ami, reconnaissant en lui un " professeur de solitude ". Philosophes de l'absurde, penseurs de l'égoïsme et de la pitié, les deux hommes désignent le triomphe sur la douleur comme but unique de nos existences.
Un paysage désert et recueilli se teinte de sublime dans un profond silence : l'état contemplatif nous fait entrer dans un autre monde où s'abolit le temps. Anticipant Bergson, Arthur nous place dans la peau de l'artiste - ou de l'amateur d'art - en être détaché, visionnaire, en capacité de saisir la vérité elle-même.
Nul but utile à l'oeuvre dans l'esprit : l'inutilité-même rentre dans la conception d'une oeuvre de génie, nous tirant ainsi de la pesanteur du besoin. En révélant notre disponibilité au monde, l'art nous rend "poreux" et nous conduit à l'expérience intuitive la plus pure ; l'idée vole au-devant de la beauté, et c'est le " voile de Maya ", membrane percée de nos illusions et chimères, faux problèmes et fausses souffrances, qui s'entrouvre enfin. L'individu se découvre traversé par le monde, dans une quête de salut éclairée par la lucidité.
La volonté selon Shopenhauer est l'essence-même. Arthur le philosophe nous guide vers une pure jouissance intellectuelle, sans désir, débarrassée du sujet, uniquement attachée à l'objet. Le "logos" (connaissance) nous élève et nous fait entrevoir une autre humanité possible. La poésie tragique devient sommet des arts. Par l'art nous devenons autre chose que nous-mêmes : l'esthétique en avant-goût de la sérénité, du Nirvâna... Une manière de jour de repos accordé à des galériens qui fêteraient l'aubaine !...
On entendrait presque Prévert murmurer : " J'ai reconnu mon bonheur au bruit qu'il a fait en partant ... "
samedi 1 janvier 2011
SAN ANTONIO ET SON DOUBLE EN ARTIFICIERS DU LANGAGE
 A quoi ressemblerait une langue aussi riche que verte, constamment nourrie aux mille feux de néologismes bigarrés et dont les couleurs "tapagent" aux tourniquets des kiosques de gare ?... Partir d'un fou-rire franc, enfantin, en parcourant l'un des 175 épisodes de la saga parus entre 1949 et 1999, c'est cela se laisser toucher par la grâce san-antoniesque.
A quoi ressemblerait une langue aussi riche que verte, constamment nourrie aux mille feux de néologismes bigarrés et dont les couleurs "tapagent" aux tourniquets des kiosques de gare ?... Partir d'un fou-rire franc, enfantin, en parcourant l'un des 175 épisodes de la saga parus entre 1949 et 1999, c'est cela se laisser toucher par la grâce san-antoniesque.220 millions de lecteurs répertoriés. On aime... ou on déteste ce génie... ou intolérable bouffon ! D'ailleurs, San Antonio naît du hasard... et de la nécessité, cela au moins ne se discute pas. Que fût-il advenu si le doigt inspiré de Frédéric Dard n'avait pointé "à l'aveugle", sur une carte, la ville de San Antonio au Texas, un beau jour de 1949 ? En digne héritier du polar noir américain du début du siècle (Chester Hines, James Hadley Chase), Frédéric Dard, l"obsédé textuel", entamait par ce geste inaugural la saga flamboyante du fameux commissaire.
Cadre policier estampillé " Fleuve Noir " pour le flic matamore et son rabelaisien collègue Bérurier. Puis glissement insouciant vers une fresque bouffonne pleine d'inventions langagières : San Antonio se fera peu à peu le témoin attentif, irrespectueux, gaillard, de la vie hexagonale. Le principe est simple : l'intrigue, franchement, on "s'en bat l'oeil". Ce qui compte et attire, c'est l'humour de langue et de situation. San Antonio est "une espèce d'énorme polisson, d'énorme clown, d'énorme paillard", selon son double et créateur Frédéric Dard.
Inlassable ciseleur de néologismes (on lui en attribue 20 000 !...), cet artificier du langage boit à la source du vieil "argot d'Paname" pour créer un délire verbal mêlant tous les registres. Du trivial (les flatulences de Béru) au sublime (l'affection pour les obscurs). Des idiomes d'une fabuleuse luxuriance où le calembour le plus gras côtoie la métonymie la plus audacieuse. Un souffle rabelaisien mâtiné du " Mort à crédit " de Céline.
Chez San Antonio, le ciel peut être "gris comme une frime d'huissier"; on ne boit pas un remontant, on "installe le chauffage central dans l'corgnolon"; on ne s'évanouit pas, on "déguste de la purée de tunnel". Tandis que le brio inventif "déberlingue" hardiment la syntaxe, la grivoiserie apparente masque à peine un humanisme réel, inquiet.
Entrer dans cet univers, c'est aussi adopter toute une famille, une vraie comédie humaine. En figure de proue, Alexandre-Benoît Bérurier, dit Béru, dit le Gros... (1300 sobriquets relevés), bêtise bovine et bon sens paysan. En bras gauche du commissaire, l'inspecteur César Pinaud, dit Pinuche, petit père malingre et chenu. Et puis tous les autres : Achille, dit le Dabe, directeur de la police; Mathias dit le Rouquemoute, Jérémie Blanc dit le Noirpiot, et Félicie la Merveilleuse, la mère bien-aimée du héros, cajolée par celui-ci. Enfin, gravitant autour de ce premier cercle, fourmille une foule de "lavedus, greluches, brasse-gadoue et autres "zimondes"... l'humanité, quoi. Cortège répugnant et superbe à la fois, que San Antonio ne cesse de blâmer que pour mieux le prendre en affection.
Tout récit littéraire met en scène l'amour et la mort. La prose de Frédéric Dard le fait jusqu'au délire. On copule et on meurt furieusement chez San Antonio. Les prouesses plumardières du commissaire ponctuent les chapitres comme des refrains. Quant à Béru, il est un rut perpétuel. Et les macchabées se numérotent à la pelle. Tout ce petit monde va, vient, s'agite durant un demi-siècle, suivant la verve rabelaisienne du polar citadin.
Mais un jour vient où il faut laisser la compagnie sur le quai de l'imaginaire. Lorsque Frédéric Dard tire sa révérence à 79 balais, c'est en assurant que "les derniers seront les pommiers". Ultime pirouette. C'est un peu de notre hygiène métaphysique qui fiche le camp tout à coup. Il nous reste heureusement, précieuse et chaude, sa croisade permanente contre la connerie.
" Je suis comme un type qui crie "au secours !" Je voudrais seulement que ce cri soit mélodieux !... ", nous lâche-t-il en guise de viatique. Frédéric Dard n'est plus... San Antonio court encore !...