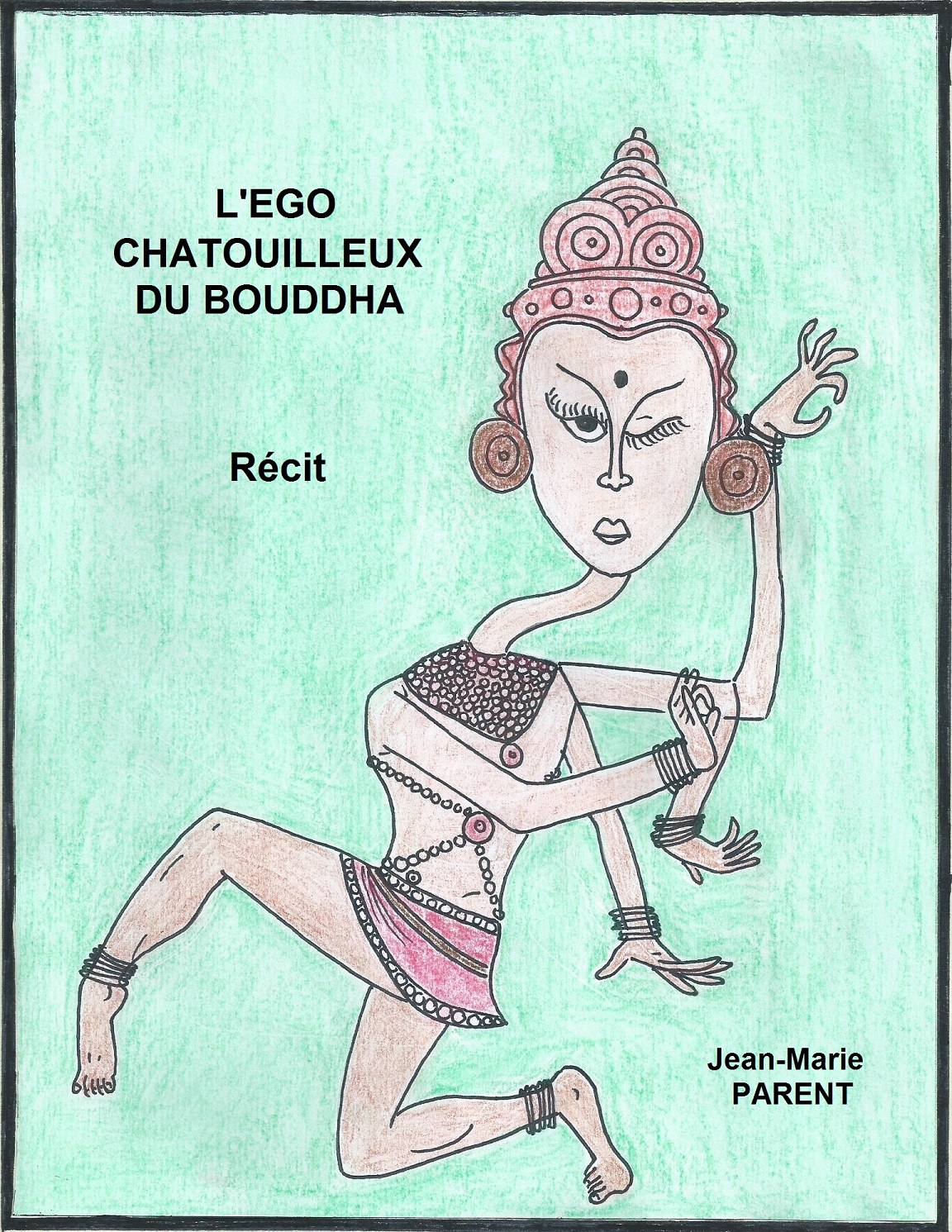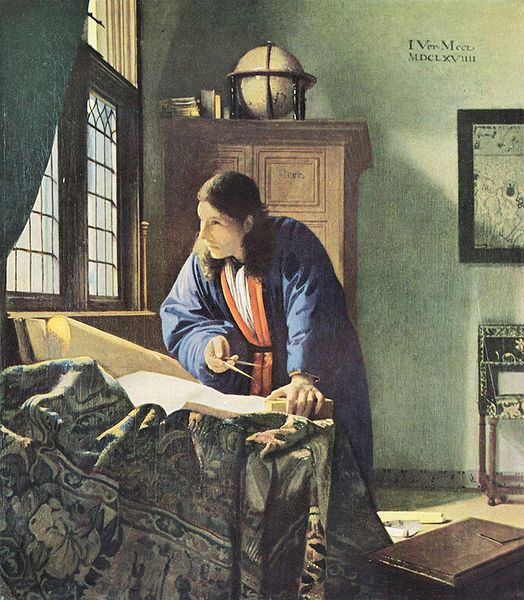lundi 16 septembre 2013
EMOUVANCES (4) SIXTINE
Le doigt de Dieu. On ne voit que lui, plein centre de
l’immense voûte où dansent cent figures sculptées célébrant la fête des corps
dans un paradis perdu des origines. Vaste scène primitive sans haut ni bas,
flottant dans un espace que le peintre a voulu céleste. Le mouvement y
tournoie, le flux y circule, à l’aune d’un vertige créateur dont la divinité
seule sait apprécier le détonant secret.
D’un geste
nonchalant, Adam étend son bras gauche pour recueillir l’énergie vitale que
Dieu lui transmet de sa main droite, celle qui désigne et confère. Du divin à
l’humain, symétrie savante, entendue, des mondes prêts à fusionner sans tout à
fait se mélanger. Les deux index se rapprochent sans se toucher. Entre Dieu et
sa créature, la poignée de main est télépathique. Car si Adam est à l’échelle
de l’homme, Dieu, lui, s’élève à l’échelle des astres. Et flotte de toute sa masse
au-dessus du monde interstellaire, enlaçant une jeune fille prépubère
préfigurant sans doute la Vierge. Enveloppé dans une cape ondulante, le corps
aérien semble esquisser dans l’espace une coupe d’encéphale propre à insuffler
l’esprit aux malheureux mortels que nous sommes et demeurons. Tout le plafond
de la chapelle tourne autour de ces deux doigts que sépare un vide infinitésimal
et pourtant sidéral. C’est le moment unique, sublime, qui voit l’œuvre jaillir
des mains de son créateur. Instant magique de tous les possibles dont nous
prend l’envie d’isoler la grâce, pressentant qu’elle ne durera pas.
Déjà,
pressant l’homme, s’annonce la figure séductrice d’Eve, suivie par l’ombre d’un
serpent vigoureux et tentateur. On devine alors - plus que l’on ne la voit
s’accomplir - la laide déchéance d’un couple banni et la cohorte des malheurs
conséquents. Mais pour l’heure, le peintre est tout à sa joie d’animer la
puissance des chairs que décuple à l’infini l’originalité du modèle. Autour de
lui, le génial Adam voit ainsi se décliner une profusion de nus aux formes
sculpturales : prophètes en méditation, sibylles inspirées, enfants
cariatides, tous exposant leurs corps glorieux dans une vaste fresque qui
célèbre l’ancien récit et annonce le nouveau. L’arbre généalogique du Sauveur
est en place sans toutefois que celui-ci n’apparaisse nulle part. Géniale
absence. Le message visuel célèbre l’œuvre totale déclinant peinture,
architecture et sculpture. L’arc de triomphe à ciel ouvert, dédié à l’homme
bâtisseur, peuple les arcades de cette immense galerie à claire-voie, ouvrant
un gigantesque continent où pierre, marbre et chair humaine s’entremêlent, tous
convoqués par le créateur pour les besoins d’une fiction conçue ex abrupto à notre intention.
Mais il
arrive que l’œuvre, échappant en partie à son auteur, infléchisse ses
innocences premières vers des réalités plus prosaïques. Ainsi, la fraîcheur des
origines transmue sa gratuité au gré d’une Histoire qui la dépasse. Sous la grâce
éphémère dormait l’impatience des ego.
L’homme alangui fait place au potentat investi : laissant se déployer la
continuelle marche en avant du désir, l’état de nature cède sa place à celui de
culture. Le paroxysme de la peur - celle que l’on éprouve comme celle que l’on
crée - s’incarne dans le scénario implacable de duels fratricides. Les hommes
découvrent qu’ils adorent se faire peur. Notre semblable nous devient
intolérable et génère la crise mimétique qui appelle le grand Léviathan cher à
Hobbes : le pouvoir tombe dans l’escarcelle d’institutions prêtes à le
faire fructifier jusqu’à la confiscation. L’irascible Caïn a tué l’innocent
Abel, provoquant la naissance des nations et de leurs lois. La collusion
secrète du sabre et du goupillon s’organise, inventant des configurations fécondes
que l’Histoire validera cent fois, confisquant à l’art la fraîcheur originelle
et magique de la danse des corps. L’homme vient de perdre son innocence.
D’impeccables soldatesques en ordre de bataille sont désormais prêtes à
écrire maints récits de prises de pouvoir occultes, éphémères, répétitives. Le
plafond sublime des corps éclatants accouche soudain, à quelque vingt mètres
sous sa voûte, au ras du plancher des vaches, d’un long cortège de corporéités
spectrales aux chairs enfouies sous cape, dont seules émergent des têtes
livides, omniscientes, aux visées omnipotentes. Cardinale et somnambulique
cohorte des soldats de Dieu vêtus de chasubles asexuantes, aux teintes sanguinaires de l’incarnat, entonnant sur
une seule note hypnotique la litanie mortifère des inusables martyrs de la
cause. Une causa nostra porteuse de
mort exalte le sacrifice sans fin des chairs flétries. Vingt mètres plus haut,
le Dieu planant ne peut que jeter un regard affligé sur cette absconse réalité
humaine, lointainement engendrée, mesurant combien l’œuvre a définitivement
échappé à son créateur. « Je ferai pleuvoir sur terre quarante jours et
quarante nuits », se surprend-il à proférer en guise de menace. Mais y
croit-il encore, témoin atterré de ce long cortège de vieillards cacochymes se
balançant au rythme d’une lettre morte qui a su escamoter son Verbe
génial ?... Le bienheureux pouvoir divin accouche en direct d’une chimère
cléricale.
Comment la
fête des corps glorieux a-t-elle pu
engendrer cette légion impuissante, éplorée, de fantômes égrotants, uniques
locataires désormais de la chapelle magique transformée en une immense salle
fermée à clé, con clave. Conclave. Marmite
autoclave plutôt où barbotent de misérables secrets prestement réduits en
cendres dans la fumée grisâtre d’une pauvre cheminée sans âge. Pacotilles
célestes aux relents de bondieuseries fumeuses. Torves manœuvres sur fond de
confidences codées, de lenteurs millénaires, de scénarios simplissimes où bons
et méchants s’étripent avec jubilation. Clergé médiatique qui ne sait que
détester ou adorer et fait semblant de connaître ce qu’il ne comprend toujours
pas. Triste réalité propre à enfumer la foule hystérique des pèlerins qui s’engrouillent, béats, aux aguets de la
consolante papale prête à choir du balcon lointain. La masse, mère des tyrans,
s’apprête à rejouer la farce récurrente des peurs enfantines exaltées. « Une preuve du pire, c’est la foule », nous suggère Sénèque, stoïque
figure de la sagesse antique.
Quant à
Dieu, à jamais frustré de ses essais créateurs, on peut l’entendre expirer dans
un souffle du tonnerre de Zeus : « Diable, mais pour qui se prennent-ils
tous ?!... Je ne joue plus pour tous ces pauvres hères. J’ai peur que la
fin du monde soit bien triste. » Divin courroux aux accents séculiers.
dimanche 1 septembre 2013
EMOUVANCES (3) SOURCES
Longeant le
cours de l’eau, plein centre ou sur ses bords, nous réinventons la tradition
péripatéticienne chère aux Anciens. Batelier ou nageur, marcheur ou écrivain,
nous voilà invités à forger nos nids avec l’écume des mots, à l’image des
grands oiseaux du fleuve voguant à fleur d’eau. Le texte naît sous nos yeux,
contemporain de la masse liquide. Pénétrant au cœur des paysages intérieurs
qu’elle suggère, notre exploration panthéiste de la nature confine au voyage
initiatique. D’autres, nombreux, illustres, sont déjà passés par là, pionniers
anciens d’espaces imaginaires qu’ils ont voulu féconds. Longtemps après ils
nous séduisent encore et nous mettons naturellement nos pas dans les leurs.
La genèse
aqueuse affronte des cours rebelles, épouse des lignes sinueuses, remonte
fièrement à rebours de rapides peu hospitaliers, pour s’apaiser enfin en se
lovant au creux de zones calmes et vastes où l’esprit reprend souffle. Perdant
parfois son fil, elle discourt, empruntant d’improbables affluents. Penser
contre et à l’envers n’est pas sans risque pour l’entendement, subitement renversé
cul par-dessus tête. Le récit s’écrit là sans toit ni loi, ouvert sur l’éther,
rebattu par l’indiscipline de toutes les météorologies. Il s’habite et se
gonfle du génie de lieux mouvants, de paysages volages dont l’écrivain nourrit
sa mémoire appliquée. Mémoire où bruissent déjà mille légendes hydrographiques,
comme autant de mythes précieux confiés par notre antiquité bimillénaire
toujours prête à reprendre chair. Des livres jamais scellés nous précèdent ou
nous accompagnent telles de petites flammes vives éclairant le cours du fleuve
et lui donnant l’aspect lisse, clair, marbré, de mers attiques où s’ébattent de
fières goélettes aux voiles auriques. Moment choisi par la mythologie pour nous
glisser d’inquiétantes visions de sirènes enjôleuses, femmes tentatrices et
fatales avalant goulûment des marins dérisoires. Images de légendes. Des
odyssées nous ont précédés, porteuses de peurs primitives devenues familières
au gré de nos lectures enfantines. .../...
Abandonnant
tout titre de propriété sur le paysage, le passager des eaux, novice philosophe,
ressaisit le temps pour capter la valeur véritable du monde. L’univers devient
sphère dont le centre est partout où croît l’intelligence. Nous foulons et
refondons à chaque instant notre terre natale, en autochtones prodigues de
retour au pays. Le dôme d’azur libère pour nous des espaces où l’ouverture de
l’air le dispute à la puissance de l’eau. Notre pensée murmure au rythme des
frissons salubres et roboratifs de l’inspir.
Notre paradis est ici ou nulle part, flottant dans ces vers que nous glisse
Borges :
« Se pencher sur le fleuve, qui est de temps et d’eau,
Puisque nous nous
perdons comme se perd le fleuve
Et que passe un
visage autant que passe l’eau »
Inscription à :
Articles (Atom)