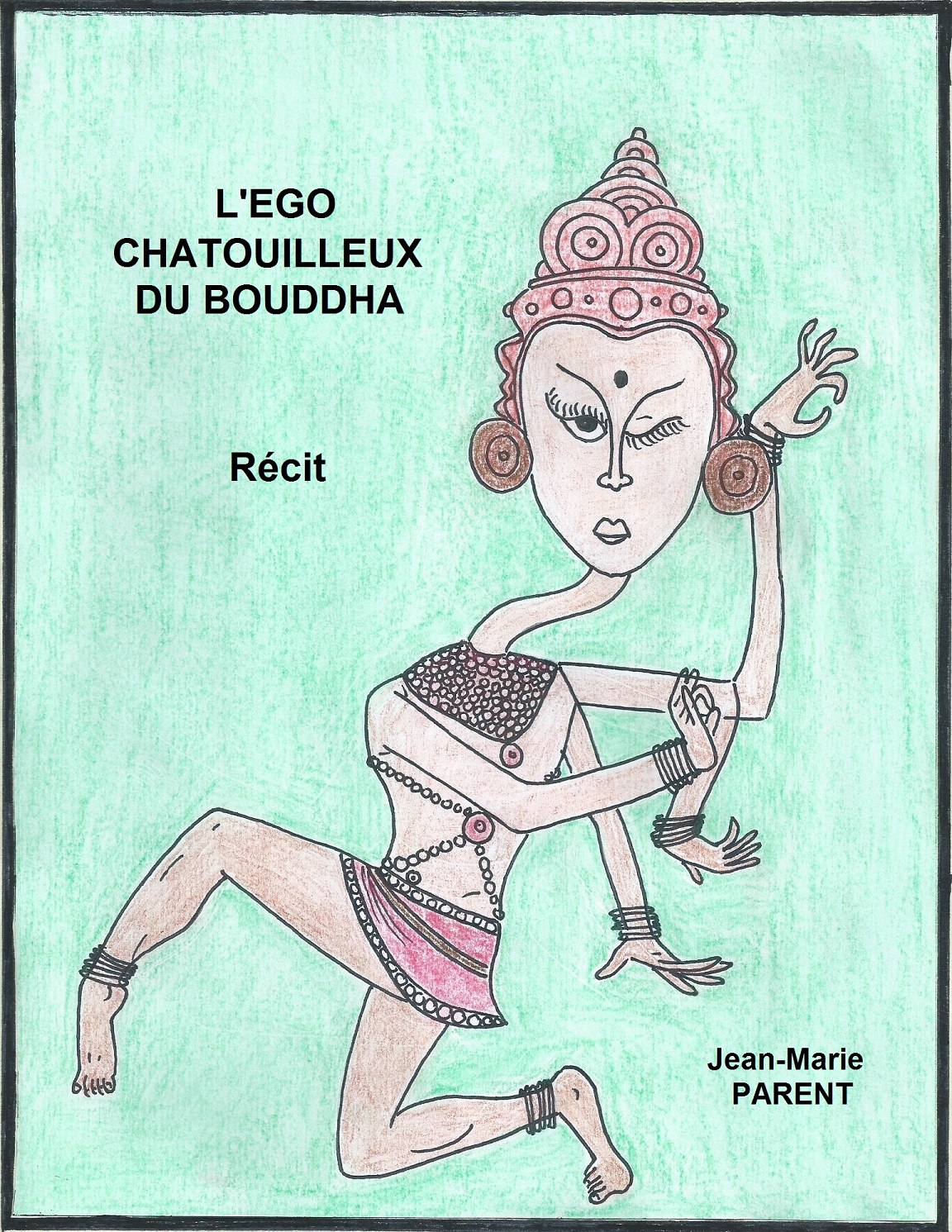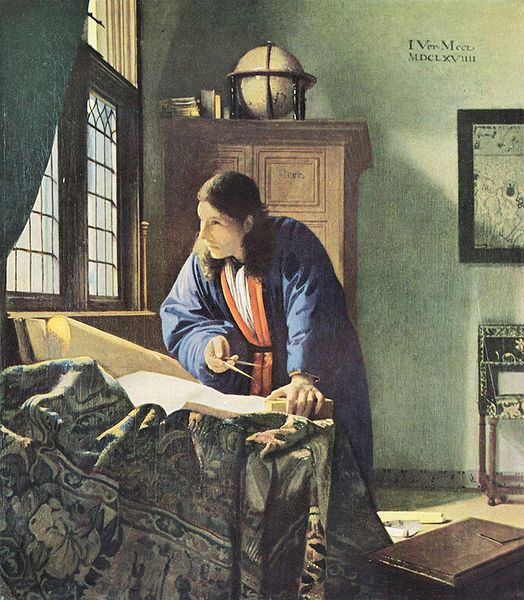Mais "doukipudonktan ? " se demande Tonton Gabriel, se tamponnant le tarin de Barbouze de chez Fior. Queneau lance ainsi la virée burlesque de sa nièce Zazie dans Paris. Une gamine effrontée que cette "mouflette cambrousarde", qui n'a pas froid aux yeux et affronte le monde adulte sans complexe, avec un culot digne des Titis et autres Gavroches parigots, "les coudocor".
Mais "doukipudonktan ? " se demande Tonton Gabriel, se tamponnant le tarin de Barbouze de chez Fior. Queneau lance ainsi la virée burlesque de sa nièce Zazie dans Paris. Une gamine effrontée que cette "mouflette cambrousarde", qui n'a pas froid aux yeux et affronte le monde adulte sans complexe, avec un culot digne des Titis et autres Gavroches parigots, "les coudocor".Et Queneau poursuit sa jubilante balade urbaine de bistrot en coinstot, où le jeu consiste à repeindre la langue aux couleurs de la plus pure phonétique et du parler poulbot. "Snob mon cul", entonne la mouflette en guise d'entrée en matière. Et quand l'oncle Gabriel lui propose la visite des Invalides en guise de plongée dans l' "métrolleybus", la réponse fuse, sèche : "Napoléon mon cul ! Il m'intéresse pas du tout, cet enflé, avec son chapeau à la con ! "
Le savoureux perroquet Laverdure donne la réplique, de manière aussi réitérée que sibylline : "Tu causes, tu causes, c'est tout c'que tu sais faire !...". Zazie egzamine éberluée tout ce petit monde : "Et çui-là ki cè ?... " Elle ne rêve que du métro et de Singermindépré, la gosseline, on ne lui enlèvera pas ça de l'idée ! Mais Tonton Gabriel veille sanxaenèlèr : " La rue, c'est l'école du vice " prévient-il, et gare aux papouilles zozées !
Zazie apprend vite, "assèche un demi à bulbulements, expulse trois p'tits rots et se laisse aller, épuisée", avant de goûter aux joies de la Foire aux Puces, "là où on trouve des rambrans pour pas cher". Stoppée net devant un achalandage de surplus, aboujpludutout : " Izont des blouddjinnzes !..." Et tant pis s'il y a des croquants ki n'aiment pas squi est raffiné !
Les lourdingues, rombières, satyres, galapiats, gougnafiers, guidenappeurs et autres fleurs de nave en prennent pour leur grade. Les "nomdehieu, nomdguieu, lagoçamilébou, exétéra..."se profèrent par bordées. Mais, comme pour rattraper, il y a aussi "des médzavotché, des oeillades aphrodisiaques et vulcanisantes, des commissures labiales, des ombres quasiment anthropophagiques et des lamellibranches forcées dans leur coquille avec une férocité mérovingienne."
Queneau s'invite lui-même au détour d'une phrase, tel Hitchcock apparaissant fugacement dans ses films : "Toute cette histoire, à peine plus qu'un délire tapé à la machine par un romancier idiot (oh ! pardon)." Puis il n'hésite pas à faire valser les conjugaisons : " Gabriel fermit les yeux et se tournit vers le type... Elle lui foutit un bon coup de pied sur la cheville."
Zazie la mouflette, elle, sait ce qu'elle veut : "Je veux aller à l'école jusqu'à soixante cinq ans. Je veux être institutrice pour faire chier les mômes, pour leur larder la chair du derche... Sinon, je serai astronaute pour aller faire chier les Martiens !..." A défaut de métro, la môme est embarquée malgré elle dans un lot de touristes grouillants : " On veut ouïr ! On veut ouïr ! Kouavouar ? Kouavouar ? " Foin de bâille-naïte, tonton Gabriel est promu archiguide de tout ce petit monde aux cris de "Montjoie Sainte Chapelle ! ouvrez grands vos hublots, tas d'caves !..." A quoi tous ces cons répondent par la nécessité d'un pourliche.
Conséquences emmerdatoires et déconnances variées amènent les uns et les autres à quelque surenchère métaphysique : " La vie, un rien l'amène, un rien l'anime, un rien la mine, un rien l'emmène..." " Oui, surenchérit Laverdure, facétieux : nous ne comprenons pas le hic de ce nunc, ni le quid de ce quod ", " Quelle colique que l'egzistence ! " Et quand une rombière a "un fleurte terrible avec le flicmane Trouscaillon", Zazie poursuit ses découvertes au gré des apibeursdétouillou et des "politesse mon cul." " J'veux ottchose", clame-t-elle ("que la ffine efflorescence de la cuisine ffrançouèze")... " " Et pourtant, isi connaissent en bectance, les enfouarés ! "
" Les pas marrants, dit Zazie en asséchant un glasse, j'les emmerde. " Et d'ailleurs, Tonton Gabriel se voit bientôt en prise avec la "meute limonadière". " Tapage nocturne, chahut lunaire, boucan somnivore, médianoche gueulante... " Tous les signes de l'hécatombe finale (digne de celle de Brassens au marché de Brive-la-Gaillarde) s'accumulent devant la gosseline épuisée mais reconnaissante pour son oncle : " T'étais bath, t'as vraiment été suprême !"
Et lorsque Jeanne Lalochère la récupère, la môme dort debout. A la question immanquable : "Alors, qu'est-ce qu'est-ce que t'as fait ?...", Zazie expire dans un souffle : " J'ai vieilli ".