lundi 8 février 2016
Une gravière désaffectée, vestige d’une
activité industrielle oubliée. Il ne demeure que la cuvette en pente douce
qu’emplit peu à peu l’eau claire et pure de la nappe phréatique. Mystère des
eaux souterraines colonisant par porosité, lente imprégnation, les
anfractuosités de la surface. Au gré des hasards, une jungle aquatique
s’apprête à surgir. Retour aux conditions des origines planétaires, à l’échelle
d’une mare humide.
Bactéries en myriades, puces d’eau, mousses
envahissent bientôt les eaux dormantes, suivies des amphibiens, oiseaux,
insectes. Crapauds, couleuvres, libellules. Petits mammifères en quête de
proies. Végétaux de toute nature peuplent le fond, recouvrent la surface. La
niche écologique s’enrichit au fil des saisons. Les limons s’accumulent à
faible profondeur, tapissant le socle de l’habitat devenu fertile. Sur un
rythme régulier, la lumière perce les eaux, éclairant un tout nouveau théâtre
d’ombres. Les crues des rivières proches acheminent les poissons. Des labyrinthes
s’organisent entre les herbiers, forment refuges, gîtes, asiles. Prédateurs et
proies se côtoient. Le milieu s’équilibre entre ses hôtes. Le biotope vit.
Quel regard lui accordons-nous ? Qu’en
connaissons-nous vraiment ? Savons-nous que le polype d’eau douce ne
vieillit pas : ses cellules se renouvellent en permanence, échappent à la
dégénérescence, conservent la vie. Nous doutons-nous que les plantes s’échangent
des informations, à leur manière, secrète ? Fascinants végétaux capables
de prévenir l’attaque de prédateurs, de réagir à la musique ou d’émettre des
hormones aptes à attirer les insectes qui viendront les polliniser.
Comportements évoquant une manière de cerveau végétal.
Que penser des systèmes d’alerte développés
par les animaux dont l’oreille interne perçoit les vibrations inaudibles émises
bien avant le déclenchement des séismes ? Ou des abeilles enregistrant les
changements fins des champs magnétiques ? Les faits sont là. En guise d’alarme,
les mammifères disparaissent subitement ou ne se nourrissent plus. Les poissons
sautent hors de leur bassin. Les reptiles tournent en rond, se tapent la tête
contre les murs. Des signaux s’impriment dans les corps par ondes infimes. A la
manière dont le papillon ou le caméléon sont des clichés du monde où ils
évoluent, le vivant conserve l’empreinte du passage, de la trace plus ou moins
visible. Tandis que les photons de lumière bombardent les surfaces sensibles à
leur portée, perturbent l’organisation des cristaux chimiques, des figures
naissent dans le chaos du monde. Chaque disparition de cellule ici s’accompagne
ailleurs de la réplication d’une empreinte, d’un redevenir des corps.
Simulacres et survivances. Fugacité et persistance.
Le petit peuple de la mare va sa vie, ne
délivrant ses secrets qu’avec la parcimonie du vivant aux aguets. Même les
poissons ne dorment que les yeux ouverts ! Et lorsqu’un épais voile blanc
se répand comme une brume sur le fond du lac miniature, on évoque les
semblances d’un poison trouble drainant les profondeurs. La nature, elle, n’y
voit que réaction entre éléments : celle du carbonate de calcium, froid,
entrant en contact avec l’eau plus chaude.
Subtile, étonnante alchimie du biotope.
Une large tranchée blanche tapissée ici et là de
bandes de velours verdoyantes, comme une saignée profonde coupant la ville en
deux. La chenille compacte d’un tram avance sa carcasse de verre et de métal,
lente, silencieuse, sur le grand ruban blanc. Rivée à son rail, la rame
serpente au gré des courbes de l’avenue. Tranquille.
Une voiture s’engage en travers. Sans un
regard pour le tram qui s’avance en pleine visibilité, le conducteur avale
l’espace en terrain conquis, sûr de son droit. Choc inévitable. L’intérêt
particulier entrant en collision avec le domaine collectif : fait divers
vieux comme le monde. Inconscience des acteurs ? Insignifiance du fait ?
Illustration d’un fond d’inattention coupable, de déraison acquise. La nouvelle
– mais en est-ce vraiment une ? – fera un paragraphe illustré dans la
presse locale, et peut-être un reportage sur la chaîne de télévision du coin.
Parmi d’autres, multiples, exposées sans hiérarchie apparente. Fatras confus
engendré par un monde agité. Le fait divers catastrophiste nourrit nos
tendances complaisantes à l’émotion facile, notre pente naturelle à l’hébétude
consumériste. Haro sur l’univers exalté de nos chaînes TV en continu,
concoctant matière à information, à surinformation. A désinformation. La
stratégie est toujours la même : comment transformer un fait d’apparence
anodine en pièce montée dégoulinante de bonnes intentions. Une fois ouvert, le
robinet alimente sans fin un regard juteux, vendeur, sur le monde comme il
va : mal, souvent, selon ce regard-là. Voici les brèves qui s’allongent
comme queues de comète en plein jour.
Les consciences fourbues n’en ont jamais fini
de s’imprégner des navets consternants alimentés par les petites mésaventures
du quotidien. Le fait divers, cette démangeaison du présent, avale goulûment
l’Histoire comme l’Art, assimilés à un gigantesque jeu vidéo où le fun et le
jeunisme s’épaulent pour expulser toute tentative de penser la vie.
L’autofiction tient désormais lieu d’épopée.
« Soyez jeunes, urbains, festifs ! »
susurre-t-on jusqu’au fond des provinces reculées : il n’est plus ni art
ni culture qui ne cède à ces injonctions aussi simplistes que trompeuses.
Braqués sur la futilité du monde, les projecteurs de l’actualité accouchent
d’un déballage permanent d’où émerge l’écume du rien. Le zapping frénétique sur
l’« info » vire à l’opération d’enfumage pure et simple.
L’insignifiance crée l’ignorance, entretient le vide, déconnecte la pensée,
débouche sur la déconfiture d’une culture présumée populaire.
Et comme si on en redemandait une dose,
l’actualité contemporaine invente des redites à de vieux faits divers pourtant déjà
passés à la postérité. Le naufrage pathétique d’un rafiot de luxe affrontant
des icebergs gros comme des montagnes – déjà joué grandeur nature au début du
siècle – prétend rebondir et suggérer de nouveaux ravages. On en remet en scène
la vision frénétique, hystérique, la célébrant d’un navet planétaire qui achève
de couler le cinéma grand public dans une soupe hollywoodienne où adore patauger
le bon peuple larmoyant. Insuffisante approche : il faut viser une vérité
plus forte encore, plus proche de notre réel contemporain. Plus apte à frapper
les esprits, du moins ce qu’il en reste. On met donc en service de tout
nouveaux géants des mers, hauts comme des immeubles, larges comme des avenues.
Que l’on dirige près des côtes, au mépris des règles de sécurité. Provocation
au bon sens… et aux lois élémentaires de la navigation. Les mêmes causes
produisant les mêmes effets, la catastrophe prévisible a lieu… et se redouble
d’une mise en scène à faire froid dans le dos. A quand une fiction célébrant les
frasques du Costa Concordia ?...
L’histoire hoquette, bafouille et révèle de
curieuses tendances à célébrer nos travers les plus stupides, les plus ancrés.
Le feuilleton va bon train. Au théâtre confus de nos illusions, nous adorons
rejouer nos brèves infernales. La bêtise nous guette. La répétition nous navre.
La redite nous sidère.
Le
mauvais carnaval des masques bat son plein. Et nous laisse à court.
Du chaos, de l’indistinct, de l’informe :
c’était avant l’espace et le temps. Et puis voici l’être, né à partir de la
forme. La morphè grecque. La forme
enclenche une naissance : nous ne serons plus jamais les mêmes.
Désormais se reproduit à l’infini le passage
métaphorique, métamorphique, du rien à la chose. Avant, il y avait nécessité de
circonscrire pour comprendre : le monde antique était limité par le fleuve
des enfers. Désormais, notre espace peut déborder et s’écouler hors des
frontières connues des ancêtres.
L’infini précède le défini. L’information
signe la fin de l’informe. On est dans l’instant où ça prend forme : c’est
la morphose première. A partir de quoi on ne fera plus qu’imiter. Contrefaire,
parodier, développer : ce sera la métamorphose. Copie, duplication,
réplication. Conjonction bizarre de l’artifice et du réel. Carnaval des mimes.
Les folklores nous livrent leurs créatures métamorphes :
loups-garous et vampires, femmes-renards à l’esprit magique, tous ont le
pouvoir de modifier leur apparence physique pour épouser celle d’autres
espèces. Coquecigrues sans queue ni tête. La littérature de science-fiction
renchérit avec ses change-formes, humanoïdes génétiquement modifiés, capables
d’entrer en transe en modifiant leur apparence physique. La science pure
prolonge l’ivresse en décryptant le génome : l’ADN se fait modulable.
L’identité se fond dans l’altérité.
Nous étions dans le suspens, le hors temps,
hors espace. La métamorphose donne le sentiment d’un saut qualitatif. Une
révélation de l’altérité sans l’identité. On module, on crée des
variations : jardin, fable, labyrinthe. Le labyrinthe, lieu du Minotaure,
signe l’hybridité d’une métamorphose arrêtée : mi-homme, mi-bête, voici le
Centaure. La Nature crée la nymphe, stade hybride entre larve et insecte
adulte. Etat où s’endormir, état à prolonger… Valse-hésitation du provisoire,
en attente du définitif. On se perd, on se retrouve, provisoirement :
scénario qui dit le trouble.
On n’en sort qu’avec des ailes d’oiseau, sous
l’aspect d’Icare. Mais ce n’est que pour mieux fondre au soleil ! Ou à
l’écoute d’animaux parlants qui racontent des fictions : l’enfant se fait
homme, le fou devient sage. L’altération conduit au constat d’une altérité.
Mais mieux vaut ne pas trop philosopher : on finit toujours par être
dévoré par ses idées.
Parvenues à un point de sophistication ultime,
les formes tendent à se figer, éblouies par leur propre reflet. La nécessité
leur vient de faire le point, de jeter un regard sur leur propre parcours. Les
civilisations avancées sondent leurs excès, questionnent leurs doutes : la
perfection leur est une forme achevée dont elles ne pourront tenir indéfiniment
la note juste. A l’image de l’orchestre réussissant à s’accorder le temps d’un
concert. Et au-delà ?...
Tournant nos regards vers l’infini du cosmos,
nous voici plongés au cœur des formes dont nous sommes issus. Etoiles et
comètes nous renvoient l’image du chaos initial qui nous a vus naître. Nous
apprécions l’immense traversée qui nous a transformés. La métamorphose nous
apparaît dans ce trajet rétrospectif.
Arrivée à son zénith, la forme finie tend à se
déliter. Sans doute pour mieux se frotter aux vertiges d’autres mutations qui
l’attendent. Remis en question par des modèles moins avancés, où règnent
parfois des obscurantismes que nous reconnaissons pour les avoir autrefois
traversés, nous voilà confrontés aux limites d’un idéal qu’il nous faudra sans
doute amender.
Même fascinés par l’illusion de notre propre
pouvoir, nous ne sommes pas des dieux !...
Sur fond de cyprès, quelques fruits sur un
compotier. Nature morte que ces touches de couleurs vives offertes à l’organe
qui sent, à l’esprit qui saisit ? Non, il peut arriver que la simple
vision tourne à la voyance.
Entre senti et sentant, visible et voyant,
dehors et dedans, comment habiter le monde ? Il faut tout oublier pour
toucher du doigt la courbure des pommes charnues et l’odeur des cyprès
fraîchement endormis sur la toile. Et se laisser porter par ce que l’on ne
comprend pas.
Question de chair, idée neuve et antique. Nous
tentons d’accoler au monde visible la traversée d’un ego charnel. Belle
tentative pour une vision en miroir : le peintre se sent regardé par les
arbres qu’il vient de peindre. L’art s’incarne dans un mystère qui le dépasse.
L’artiste et le philosophe inventent ensemble leur troisième homme : le
poète se tient maintenant à la pointe du triangle parfait.
La sensation crée l’échange en boucle.
L’énigme court dans une circularité vertueuse. La figure de l’entrelacs
accouche de paroles croisées : le paysage s’incarne en moi et je suis sa conscience
(le peintre) ; il faut rendre au monde sa valeur d’énigme première (le
philosophe) ; la terre est bleue comme une orange (le poète).
Pommes et cyprès reposent sur la toile. La
perspective offerte par le peintre en bombe l’apparence. Nous percevons la
convexité d’une mue dissimulée au cœur de la matière. Voluminosité,
oscillations vibrionnantes. Les aplats se déforment comme ces mirages hantant
les déserts ou ces anamorphoses épatantes qui vous cueillent le regard et font
les délices de nos imaginaires en vadrouille. L’esprit s’émeut de visions
arrachées à un temps devenu soudain élastique. La toile bouge au gré du regard
qui insiste, pénètre, s’incruste. Avant d’arracher finalement la nature morte à
son statut de belle endormie.
Les matières posées sur la toile réveillent
nos sensations tactiles. Elles ouvrent autant d’univers parallèles que nos
regards pénètrent sans en croire vraiment leurs yeux. L’ampleur de la palette
déploie ses nuances comme l’instrumentiste répète ses gammes. Avec infinie
patience, régularité métronomique, souci du détail qui éveille les sens.
L’échelle chromatique expose ses touches quasi-sonores, aux demi-tons
troublants. La nature morte s’anime, prend vie.
C’est d’abord une touche de vent qui fait
onduler souplement les cyprès du fond, donnant à la scène son rythme
lent : un balancement quasi-musical qui nous berce bientôt, et que vient
compléter une douce sensation de chaleur méditerranéenne. Nous voici plongés
dans la touffeur d’une après-midi estivale.
Le volume de chaque fruit prend forme à
présent. Les chairs allument leurs couleurs vives, éveillent des envies de
saisir, de mordre, de goûter. Fourmillements et démangeaisons tactiles nous
envahissent en nombre et en intensité. Nous sommes habités par la réminiscence
d’un éden antique. Celle de notre ancêtre cavernicole découvrant l’intense
plaisir de plonger ses mains dans la fraîche consistance des argiles molles. De
la main au regard. Du regard à la main. La toile se fait support de matériau
comme d’intentions.
Dans un ultime raccord, l’œil a rejoint
l’esprit.
FORCATS
Qui sommes-nous vraiment ? Que
valons-nous ? semblent crier en chœur ces coureurs de l’extrême lancés
dans des courses de fond sans fin. Fuyant la société qui casse de l’humain, en
quête du toujours plus (d’admiration), voilà l’homme incertain enfourchant ses
kilomètres de vanité et ses heures de gloire. Les corps n’ont qu’à bien (se)
tenir. Leur demande-t-on leur avis, d’ailleurs ?
Mais quoi – ou qui – cherchent-elles à
dépasser, toutes ces mécaniques en nage, colorisées, sponsorisées, en quête
d’un surplus de regard et de dopamine ? Et que sont pour eux ces capteurs
de plaisir qui prennent place dans le cerveau, exigeant régulièrement leur
nourriture frénétique ? Quels défis se lancent-ils à eux-mêmes ? Aux
autres ? Entre logique de l’action et gratuité du geste.
Performer, dépasser, se dépasser : on
reconnaît bien là les valeurs omni-affichées par nos sociétés libérales. A
coups de barres et boissons énergisantes, voilà nos costauds projetés sur le
macadam lourd, sous l’œil protecteur de dizaines de secouristes aux petits
soins. Oxygène, brancards, défibrillateurs, médicaments contre la nausée :
rien ne manque. Et rien n’est trop beau pour encadrer le spectacle offert par
ces forçats du corps. Comme autant de répliques miniatures d’un monde agité qui
célèbre les flux et croit toujours y échapper.
Ils alimentent le marché des chaussures de
marque, des textiles, sacs et accessoires, boissons reconstituantes et crèmes
apaisantes. On n’y échappe pas, c’est le système. Et à l’arrivée, toujours les
mêmes scènes. Certains, frais comme des gardons du jour, s’efforcent de faire
bonne figure, quasiment prêts à repartir pour la même distance. En sens inverse.
D’autres se traînent, titubant, à bout, déjà loin du seuil d’alerte, leur
bouche tétant l’oxygène, bâillant comme des poissons qui écarquillent leurs
ouïes hors de l’eau.
Leurs collègues des salles de sport ne cèdent
rien aux forçats du bitume. Le surplace est leur credo, la surmusculation leur
évangile. Engagés pour des heures de foulées sur des tapis roulants, les voilà
comme des hamsters pédalant sans fin dans la roue métallique, au centre de leur
cage. Presses à cuisse, haltères, appareils variés aux mécaniques
contraignantes soumettent les muscles, les poussant à leur seuil de rupture. Et
puis ici, pas de paysage, mais la vue bornée de machines infernales rappelant à
s’y méprendre les instruments de torture moyenâgeux entrevus dans les oubliettes
de nos châteaux. A cela près que torturés et tortureurs sont ici les mêmes.
Infernaux miroirs.
Dopage, amateurisme marron, tricheries,
combines, on sait les dérives du sport contemporain. Les mécréants de
l’activité physique finissent par être plus nombreux que les croyants. Faut-il
y voir un début de réflexion sur les excès de pratiques pourtant acceptables
dès l’instant où elles ne prétendent qu’à une hygiène de vie ? Question de
mesure.
Derrière les blindages organisés par le sport
de haut niveau, c’est tout le rapport au corps et à son opacité qui pointe. Si
justement l’emprise du physique marche si fort, n’est-ce pas parce que
l’organisme sportif est lui-même un corps aveugle alimenté par des préjugés
dominants : il faut maigrir, il faut souffrir, il faut améliorer ses
performances. Bref, autant d’injonctions terroristes à se conformer au moule
établi. Sans que soit jamais posée la question de fond : quel corps
voulons-nous ?
Dans l’incertitude de la réponse à apporter, les
hamsters bravaches n’en ont pas fini de baver !
GESTUELLE
Clavier contre stylo, machine contre corps,
une lutte sourde s’engage à notre insu. Lutte de prestige ?
D’efficacité ? Simple affaire d’outil ? Enième soubresaut de la déjà
longue histoire de l’écriture ? Menu plaisir physique en passe de se
perdre, peut-être.
A quand remonte notre dernier long texte écrit
à la main, à l’ancienne ? Cette mémoire-ci aurait-elle à voir avec la
mémoire du geste ? Elle qui confronte le mouvement automatique à la
motricité fine, l’aplat lumineux de l’écran au volume de la feuille qui se
rature, se plie, se chiffonne, se coupe, se jette. Et la recherche d’un propre
et net définitif aux traces patiemment accumulée d’un travail qui hésite, se
cherche, accumule les essais et erreurs. Sans les faire disparaître de suite.
Et peut-être pour les exhumer un jour futur, comme l’archéologue reconstitue
patiemment les linéaments de l’histoire biologique. Oubli des repentirs et
mémoire du corps.
La vitesse d’exécution de la frappe tend à
dissoudre la temporalité propre à l’exercice écrit. L’exigence quasi-scolaire
des pleins et déliés avait laissé place à l’écriture script. Faut-il désormais
mettre au rang d’idée romantique la tradition de l’écriture cursive, reliant
entre elles les lettres d’un même mot ? Ou son abandon, tout au contraire,
signerait-il la liquéfaction accélérée des liens qui confortent encore la
cohérence de notre monde ?
En reliant les lettres entre elles, l’enfant
qui apprend acquiert l’image du bloc que représente le mot, et donc son
orthographe. Dans les boucles d’une majuscule ornée, il dessine, capte les
rondeurs, l’harmonie, l’équilibre. Il y a une danse de l’écriture, une mélodie
du message qui ajoute de l’émotion au texte prenant forme sous un regard actif.
Avec l’écriture manuscrite, on se rapproche de l’intimité de celui qui a tracé
les mots, tant chaque graphie possède sa propre gestuelle émotionnelle, son
charme unique. Jusqu’à révéler un peu de la personnalité de l’auteur ?
Calligraphie et narcissisme contre sécheresse du clavier.
L’écriture manuelle relève d’un geste complexe
qui mobilise à la fois des capacités sensorielles – je sens le stylo et la
feuille -, motrices – j’utilise mes doigts – et cognitives – je dirige le
mouvement par la pensée. Le manuscrit s’inscrit dans une gestuelle singulière
du corps. La frappe au clavier n’en peut figurer qu’une sommaire copie.
Le support papier autorise une liberté
d’action : on peut écrire à l’endroit ou à l’envers, jouer de la marge,
déformer ou superposer les tracés, agrémenter son texte d’un croquis
illustratif… Sans oublier tous les petits accidents d’écriture qui forment les
vestiges du travail émergeant en direct aux yeux de son auteur. Vrais reflets
de la plastique corporelle.
Vengeance du clavier : vélocité du
rythme, automaticité cognitive et capacité de penser le plus rapidement
possible… pour disposer d’un temps accru pour… penser à nouveau ? Mais où
est passée la riche mémoire du mouvement complexe ? Et le travail de
reformulation personnelle que permet la prise de notes ?
A défaut de continuer à couvrir des volumes de
pages, notre écriture manuscrite transfère sa fraîcheur, sa hardiesse au cœur
de notre environnement, sur les murs de nos rues, embellissant parfois la
grisaille de nos villes. Graphismes publicitaires, graffitis, écrits de
contestations, tags… les arts graphiques se portent au mieux. Et ne font
qu’amplifier nos gestuelles physiques. Le corps reste à l’honneur dans les
mystères créatifs de l’écriture. Et continue de coloniser de nouveaux espaces,
publics ou intimes.
Au service de la mémoire d’un geste culturel.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)


































































































































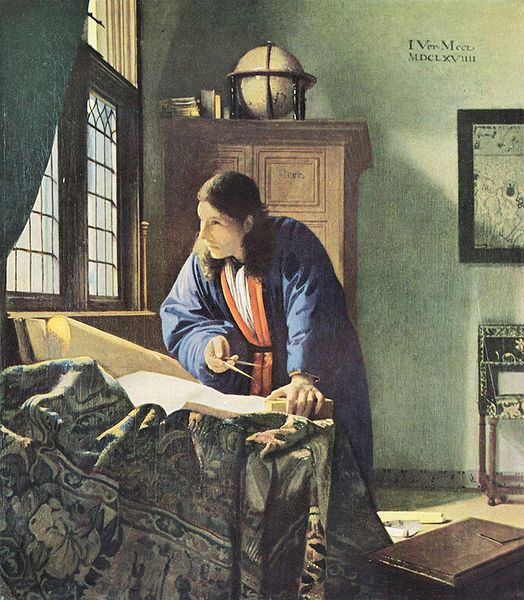














Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire