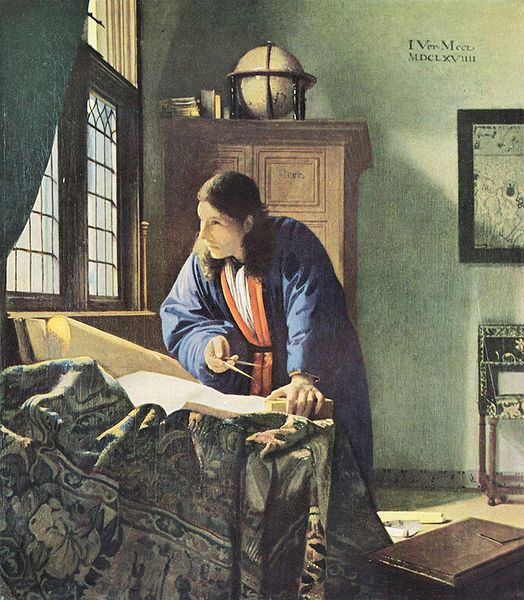dimanche 20 septembre 2015
mardi 15 septembre 2015
Paolo Fresu - Passalento
LE CARNAVAL DES MIMES (2)
Juste un frisson. Celui qui vous parcourt l’échine lorsque
la sensation vous saisit soudain : une présence derrière la porte. Comme
le sursaut d’une conscience qui vous soufflerait à l’oreille l’apparition d’une
doublure fraternelle. Une rassurante copie de soi-même.
L’imitation
s’est longtemps voulue la reproduction fidèle du monde sensible et la finalité
essentielle de l’art. Il ne s’agissait au fond que de copier d’aussi près que
possible les apparences du monde visible. Intangible cliché ?
Deux
légendes antiques incarnent ce concept d’imitation né au cœur de la mimesis grecque. Pline l’Ancien narre le
récit du peintre Zeuxis, capable de
figurer des raisins avec tant de ressemblance que des oiseaux se mirent à les
becqueter. Quant à Ovide, il raconte dans ses Métamorphoses comment le sculpteur Pygmalion, voué au célibat,
tomba amoureux de la statue d’ivoire née de ses mains, qu’il nomma Galatée, et qu’une déesse rendit vivante
selon ses vœux.
Plus avant,
au théâtre de sa Recherche, le jeune
Marcel Proust mime ses adieux aux aubépines de Combray comme il le ferait à des
jeunes filles en fleurs. De tout temps, sur les planches, la mélopée exprimée
par une voix d’acteur déclarant et soupirant nous fait mimer intérieurement la
modulation musicale d’un violoncelle : tension des muscles du diaphragme
et comme l’écho d’une voix intérieure apte à faire vibrer en nous la corde de
l’émotion. N’en va-t-il pas de même pour toute musique qui nous est
chère ?
De nos
jours, saisie du réel et travail mimétique s’imbriquent avec un tel souci de
réalisme que les images virtuelles qui en résultent se donnent à voir comme
similaires à celles qui nous sont familières. Or leur réalité n’est bien souvent que le produit de notre
désir. Au point que nous prenons pour vérité toute trace apparente du réel qui
se donne. La réalité a rejoint la fiction. Ou l’inverse, comment savoir ?
Alors,
objets et clones d’objets : du pareil au même ? La simulation est
venue se loger au cœur du contemporain. L’imaginaire, filtre posé sur le réel,
a laissé place à la réalité comme source de fiction souvent plus forte que le
réel lui-même. Jamais notre faculté de nous prendre au jeu du même et de
l’identique n’a été autant stimulée. Jusqu’aux conflits modernes, enracinés
dans des fureurs mimétiques où battent leur plein surenchères idéologiques et
religieuses. Les martyrs en tout genre étalent un zèle suspect quant à leur
objectif : rejoindre au plus tôt les prairies d’un Eternel hypothétique.
Que n’y vont-ils seuls et sans fracas ?
Plus mesuré,
le poète propose un temps de réflexion préalable avant de passer à
l’acte : mourir pour des idées, d’accord, mais de mort lente… Pourtant,
modèles, séries, prototypes se pressent à l’appel, envahissent nos espaces
communs – nos lieux communs ? – au point de coloniser les esprits. La fabrique
mimétique tourne à plein régime, démultipliant l’ivresse des ego dans une obscénité irrépressible.
Jusqu’aux clichés langagiers les plus éculés : ne lance-t-on pas à tout-va,
dans l’espace social, des « bonne
journée »… même en fin d’après-midi ? Langage avalé par une
mécanique du vide, de l’insignifiant. Absurde collectivement consenti.
Nous voilà
campés dans la position de touristes volages devant l’univers simple et
ordinaire des choses humaines. Il faut que la réalité ne nous oppose aucune résistance !
Quitte à outrepasser le fictif. Drôle de temps que celui qui se laisse porter
par l’illusion d’une humanité en voie de duplication à l’infini. Dans l’ombre
portée de nos silhouettes s’agitent de curieux doubles dansant une sarabande
qui nous échappe. Nous voici mimant des rôles muets dont le sens demeure
étranger à nos raisons en exil. L’ombre obsédante, le double maléfique se sont
emparés de nos familiers séjours. A force de vouloir apprivoiser notre part
obscure, celle-ci a subverti nos forces vives, phagocytant à notre insu notre
vision du monde et jusqu’à nos désirs les plus profonds.
Au carnaval
des mimes, la réalité a détrôné la fiction.
PAS PERDUS
L’homme investit de sa chorégraphie étrange le grand
hall de la gare. Le corps s’agite, soubresaute, avec la puissance et la
constance d’un ventilateur ronflant dans une immense pièce vide. Ses lèvres
bougent, exécutent un discours muet, tout en intériorité. Don Quichotte
moderne, il semble braver les éternels moulins d’une invisible utopie.
Drôle de
scénario qui se joue là devant nous, sous le faîte lumineux du dôme de verre.
Voici une géométrie dans l’espace au cœur de laquelle l’homme – faut-il dire
l’acteur qui s’ignore ? – paraît entretenir un dialogue complice avec
lui-même. Un monologue nourri par sa propre mémoire. On sent comme une voix du
passé sourdre de l’intérieur de ce corps battant.
Quel
invisible public l’homme prend-il à témoin au fil générique d’un récit qui
s’ancre dans ses propres origines ? Son mime vibrant invoque on ne sait
quelle divinité du théâtre des Anciens, nous entraîne sur les traces d’un
Socrate arpentant les rues de la Cité au côté de ses disciples. Tel un daemon s’abandonnant à ses impulsions, il est ce génial passeur initiant
un dialogue sans âge de professeur à élève. Avec la pointe d’ironie propre au
maître à qui on ne la fait plus, le voici qui met au jour les vertus
souterraines de l’accouchement de soi par soi. Sans écrire un seul mot.
Surgissement de l’espace intérieur, comme une renaissance.
La
charismatique silhouette bat l’air de ses bras faméliques. Ses lèvres palabrent
au rythme de ses gestes, tout à leur effort de retenir les mots comme des bêtes
indociles. Peut-être sait-il trop que tout vocable est appelé à mourir aussi,
qu’il peut surgir un temps où celui-ci vient s’échouer sur les plages désertées
de la langue. Comme une énorme baleine morte d’on ne sait quel manque de
souffle.
Mais il a décidé
de faire vivre la parole par le mouvement, d’articuler en gestes la curieuse
mimétique de son discours intérieur. A l’image de la langue signée par les
sourds-muets. Cet acteur de l’étrange semble avoir fait sien l’adage selon
lequel l’acte d’apprendre cousine avec la diction, la gestuelle propres au
théâtre. Animer les corps comme faire sonner les mots : deux versants
d’une même réalité qui perce sous l’imago,
forme adulte, accomplie, qui vient d’abandonner sa mue. A la manière dont la
nymphe éphémère vire lentement au papillon inattendu, insolite. A fleur de
peau, à fleur de mue.
Métamorphose. L’élève ancien appelle l’acteur nouveau. Qui tire sa
substance de l’antique peau. Ensemble, il leur est donné de ranimer le souffle
du sens, d’y adhérer pour de nouvelles aventures. L’osmose introuvable
redevient possible le temps d’un curieux ballet dans l’espace. Derrière la
gestuelle mutique, incantatoire, s’esquisse l’ombre d’un cyborg de science-fiction redevenant humain. Le temps d’en appeler
aux émotions propres à son histoire singulière.
L’ivresse
d’un dialogue intérieur s’incarne dans ce désir toujours intact de mimer le
monde.
ENTOMOLOGIE
Accroupi
sur la moquette de sa chambre, l’enfant gracile et laborieux s’active parmi ses
instruments d’apprenti sorcier. Coton, éther, filets, pièges divers. Et puis
des boîtes et des boîtes encore. Petites, moyennes, grandes, en plastique
transparent ou vieux carton récupéré. Un assortiment savant d’aiguilles fines
pour clouer les insectes capturés. Pour les présenter, les faire beaux. Les
apprêter aux fins d’exposition. Les assujettir à son désir. L’enfant
s’abandonne tout entier au plaisir primitif du regard qui possède. Voir, c’est
déjà tenir. Et posséder le monde.
Le petit
collectionneur découpe, fiche, colle, attribue des étiquettes. Il déploie les
ailes, étale les pattes délicates, transperce les thorax, fixe les corps sans
vie, avant de leur choisir un nom unique, précis, singulier. Vocable à l’énonciation
magique, issu d’un très ancien logos
légué par d’humaines lignées dont il se veut le descendant, l’héritier déjà
méritant. A l’image de ses glorieux aînés, le petit d’homme s’érige en maître
de la Nature. L’enfant ressent et savoure ce vertige si particulier d’être
investi du droit tout neuf de poser des noms qu’il veut savants sur les choses
et les êtres. Ivresse d’un pouvoir naissant.
Sans la
nommer vraiment, l’entomologiste en herbe éprouve une satisfaction toute
primaire à ranger, classer, étiqueter ses petites bêtes, comme il les appelle. Sensation de prendre
possession de la vie, de déployer sur les choses un pouvoir de voyant. Du haut
de ses neuf ans, il est déjà l’homme lige d’une nature qu’il soudoie, sur
laquelle il se donne le droit de vie et de mort. Sorcier minuscule, il tient au
creux de ses mains les mystères de son petit monde. Dans l’antre du savant en
herbe, le petit magicien se rêve en seigneur.
Les boîtes
s’entassent, se superposent, envahissent l’espace de cette caverne d’Ali Baba,
musée naturel en miniature. Mais l’espace se resserre soudain à l’échelle d’une
plus grande boîte encore. L’enfant vient de saisir – pur hasard – une drôle
d’image se reflétant sur une surface plastique : l’apparition fugace,
subreptice, de l’immeuble d’en face, qu’il saisit pour une fois dans sa
totalité. Grande boîte verticale se dressant face à la sienne, qu’il ne peut
voir entièrement, mais dont il devine maintenant la silhouette imposante.
Immense boîte où s’emboîtent des centaines de plus petites, abritant des
centaines de petites vies dans de petites cages, de petits êtres comme lui,
humains ceux-là. Toutes petites vies dérisoires à l’image de la sienne sans
doute.
Panique du
jeune prédateur soudain devenu grande proie. Insecte humain tout aussi affairé
que les sujets qu’il traite. Moment cruel où la vérité s’inverse, désignant
d’un coup la relativité du monde.
Au hasard
d’un regard furtif, le jaillissement du sens.
CONTAGION
Epi dèmos. Elle court elle court la rumeur. A l’allure d’un virus qui se propage aux entours du dèmos de nos cités, de nos ruralités. Elle gagne par imitation, contamine par contagion, dévore par duplication, absorbe par osmose. D’un corps à l’autre, d’une tête à la prochaine, d’une émotion suscitée à une sensation reçue. D’un ordre juste à un désordre moral. Primitive, la peur s’installe, la fascination colonise, l’imaginaire grave une danse macabre sur les écrans de la conscience. Sur fond de vengeance probable, anonyme, et de mort programmée.
D’antiques
récits émergent, nous replongeant dans notre condition oubliée d’animaux
humains en proie à de très anciennes sidérations. La figure épidémique modèle
scènes de panique et dissolution des identités. Le doute gagne les organismes
individuels, attaque le corps social patiemment édifié. La catharsis épidémique
nous plonge dans le magma singulier de nos émotions originelles.
La peur nous
cloue le bec, scelle nos lèvres dans un rictus muet. On déserte le langage
ordinaire, de crainte qu’il ne nous trahisse à son tour. Les mots sont pipés,
comme le virus reste innommé. A défaut de l’Eden perdu, nous aspirons encore à
un vague retour au calme. Chimère sécuritaire.
Traversé par
un mal sourd, ce monde-ci prend la marque infâmante du scepticisme à l’œuvre.
L’épidémie fait de nous des citoyens sans ethos.
Aliénés, impuissants, tributaires d’une foule anonyme dissoute dans un bouillon
de culture pathogène.
Mimant les
germes malins, passions et idées prolifèrent, se répandent en échanges,
transmissions, interactions. Un flux d’informations alarmantes, souvent
contradictoires, électrise nos synapses à la vitesse de l’éclair. Des capteurs
mouchetant les cerveaux permettraient d’exhaler la petite musique ronronnante
de la rumeur colonisant nos pensées les plus intimes. Ca pense comme ça coule,
en fluide.
L’épidémie
du bouche à oreille accouche d’une infernale psychose. La rumeur en écho transforme le n’importe quoi –
un fiasco, objet minimum, ordinaire,
commun – en une histoire unique, singulière, qui mérite d’être racontée.
L’idée, le récit, se dupliquent en écho, se répliquent à l’infini. Le fait brut
est lancé comme un pavé dans la mare publique. Tel un virus, il s’accroche et
court d’organisme colonisé en volonté annihilée. Le mécanisme s’active en
contagion. Mots et objets se contaminent pareillement.
Ainsi copié,
dupliqué, le virus nous mène droit à l’accoutumance, à l’addiction. Tic choppé.
Image en direct – tournoyante jusqu’à l’obsession – du geek multiplicateur accouchant d’une vidéo en boucle sur la Toile.
L’habitude de la réception s’installe, rend disponible, et cette disposition
toute neuve nous fait plus réceptifs encore. Processus exponentiel de l’avancée
en réseaux.
Dormez
braves gens ! Le conte populaire apaise en nous l’enfant, redisant à
satiété son apaisant récit. Le thème musical rythme nos obsessions sonorisées.
La parole politique endort jusqu’à nos instincts de survie. La contagion des
imaginaires est en route. Toujours en avance d’une épidémie. Répétitive, notre
mémoire s’embourbe dans un terreau propice aux idéologies rampantes. Nos
identités se diluent dans un murmure lancinant. Le phénomène épidémique impose
un présent totalitaire à nos raisons figées.
La pandémie
souffle désormais l’affreux vent de mort du fanatisme.
VOISINS
C’est la fête des voisins. Vieux rêve déguisé ou cauchemar récurrent que cette obligation annuelle de camaraderie urbaine, civile ? Forcément civile. Il est loisible de saisir cet instant unique d’un glissement : celui où l’injonction sympathique s’érige en gentillesse organisée. L’espace de quelques heures y suffira. Durée bénie, temps suspendu où la mitoyenneté se mue en citoyenneté.
Voisins, il
vous arrivait d’être le problème ? Vous êtes désormais la solution. Voilà
que l’on vous fête. Illustre anonyme, chacun de vous devient soudain aussi
célébré que le Soldat Inconnu. Riche idée que celle où l’on vous intronise,
sans coup férir, au rang de « prochain » à chérir plus que tout au
monde. Surtout ne pas se rebeller. On serait bien capable de nous inventer la
fête du reproche.
Voisinage.
Proximité de hasard ou de nécessité, par présence objective plus que par goût
réel. Habiter est affaire mentale, histoire de représentation. Etranger à son
voisin, on n’en reste pas moins exposé à son regard. Vigilant ou neutre,
délateur ou indifférent, absent ou attentif voisin, quintessence du voisinage.
Sous votre œil scrutateur, présumé envieux, nous vous haïssons tendrement,
petits big brothers omniprésents. Solidaires
par obligation, nous formons avec vous la grande marmelade des hommes dans
la ville, chère au poète.
Irions-nous
jusqu’à nous grimer sournoisement pour adopter votre aspect, vos
attitudes ? Raser les murs, être tout
comme, comble du mimétisme avoisinant.
Après tout, nous infiltrer, nous glisser dans l’identité d’un autre proche
permettrait de nous délester un temps de la nôtre, un tantinet routinière
avouons-le. Test édifiant de mutualité positive. Belle preuve d’abandon au
monde tel qu’il va.
Voisinage,
pâte molle, indistincte, à pétrir au gré de nos errances du moment. Vous êtes,
voisins, le miroir de nos enthousiasmes comme de nos inconséquences. Vous
figurez l’enjeu d’une vertu réputée enfin accessible, le prix de l’excellence
ouvert à tous : tendre au rang de citoyen responsable. L’avoisiner à tout
le moins.
Cher voisin,
tu demeures pour nous le chaînon rassurant, toujours en attente de
vérification, de nos attraits collectifs. Qu’advienne la preuve de méfiance de
trop et nous nous replions sur nous comme des escargots. Que tu nous attires à
nouveau dans les rets communicatifs d’une ferveur de bon aloi, et nous voilà
aspirés dans l’amour inconditionnel de ce prochain soudain si proche. D’une
empathie qui cerne, ou concerne ?
Comment
demeurer fidèle au cœur d’une émotion avoisinante,
constant dans sa culture de l’entourage ? Il y faudrait une quotidienne
fête des voisins. Nul doute qu’une enquête de voisinage rondement menée
lèverait nos derniers soupçons, nous redonnant définitivement le sens originel
d’une sympathie légitime, d’une coopération fraternelle. De celles que l’on n’a
pas envie de resquiller.
Pour nos
chers voisins, ces autres nous-mêmes, c’est tous les jours la fête !
SOUFFLEUR
Retour à la soupe primitive. La boule rouge ondoie,
hésitant entre fusion et calcination, fragment arraché à une très lointaine
coulée de lave. L’homme la tient au bout de sa canne comme aux rets de son
regard fasciné. Son visage perle de la sueur qui accouche. Du matériau brut
jaillit l’œuvre en état d’éruption. Passage secret de l’état de nature à celui
de culture.
Ce que
dompte ce moderne Vulcain, c’est un lambeau de pierre de lune. Un peu du noyau
des origines abandonné par le créateur au centre de la planète bleue. Vomissure
d’étoile, déjection de volcan, le cœur en fusion trahit sa présence enfouie au
plus profond, entre pelure et centre nucléaire.
Par quelle
magie la boule de pierre et feu mêlés est-elle en passe de se transmuer en
verre cassant et transparent comme la glace ? Le souffleur en tait le
jaloux secret. Il n’écoute que son poignet élastique tournant et retournant la
canne creuse animée d’un souffle redevenu divin. Mimétique, son geste figure
celui du musicien explorant les trésors infinis de la gamme. La main s’attarde,
rêve à la pointe de son instrument. Comme celle du sculpteur affronte le marbre.
Ou celle du potier modèle patiemment la pâte. Menaçante, la boule gonfle
jusqu’à enfler comme une géante rouge. Retour aux origines.
Ardents
comme ceux d’un dompteur, les yeux du vulcain fixent la chose en sa
métamorphose. Ils guettent, gourmands, l’instant précis du gonflement porté à
son acmé, celui où la forme se fait couleur. Oranges subtils, et jaunes d’or
épanouis succèdent insensiblement aux rouges de feu. Chronologie chromatique
aux fins glissandi de tonalités.
Ardent
songeur, le maître verrier sait que la difficulté de son métier vient justement
de l’apparente fluidité de sa matière. Faire, façonner, fabriquer, créer. Même
dans l’atmosphère étouffante d’un four à porcelaine où le visiteur oisif peut
croire à l’enfer, l’ouvrier actif n’est plus le serviteur du feu, il est son
maître. Et si c’est une rêverie, elle est active, les armes à la main. Et puis
chaque travail n’a-t-il pas son onirisme propre ? Chaque matière travaillée
n’apporte-t-elle pas les visions intimes qui lui sont propres ? L’artisan
le sait : on ne fait rien de bien à contrecœur, à contre-rêve. Tout en lui appelle un temps béni où chaque métier
aurait son chantre attitré, son guide onirique, chaque manufacture son bureau
poétique ! Heureuse utopie.
Imperceptiblement, le verre qui tiédit offrira bientôt ses parois translucides
au regard apaisé du verrier appréciant dans ses courbes épurées l’objet de son
ouvrage. Ou – occurrence fâcheuse – si la pâte s’est montrée rebelle à sa
fantaisie, l’artisan déçu la rattrapera en lui accordant la forme la plus
facile à souffler : celle d’une flasque, synonyme d’un fiasco qu’il tentera d’oublier.
Epuisé, assouvi,
l’artisan démiurge contemple enfin le fruit de son expir. L’esprit qui anime a
su inspirer son acte créateur. Et rappeler le geste fou de Prométhée
subtilisant le feu aux dieux ébahis pour l’offrir aux hommes. Entre souffle,
ouvrage et songe, le geste a conquis la matière.
Et su
atteindre les régions éthérées de l’âme. Anima
sua.
A SUIVRE ...
.
.
vendredi 3 juillet 2015
Bill Evans Trio - Nardis
LE CARNAVAL DES MIMES (1)
CLINAMEN
L’homme écoute
le silence. Comme il sait voir le vide. Silence et vide, il sait les faire
chanter. Depuis son rivage, il regarde s’agiter le monde. Avec l’art de
demeurer à distance pour regarder et bien voir. Télé-spectateur à l’antique, son bonheur peut dépendre d’une
simple pluie.
Comme tous
les enfants, le poète est fasciné par les innombrables grains de poussière
s’agitant en tous sens dans un rayon de soleil matinal. Son clinamen à lui est l’ancien nom donné au mouvement brownien,
fourmillante turbulence de cellules sous l’œilleton du microscope. Là où
particules et molécules folles font s’agiter son inframonde, invisible au
passant ordinaire.
Tout
s’affaire à son rythme propre, rien ne naît de rien. Les atomes s’agencent au
gré de chutes hasardeuses, aléatoires, d’où jaillit la matière. Pluies fertiles
d’éléments natifs. Poussière et lumière mêlées évoquent les rapports entre
humains. Rencontres physiques, mystérieux entrechocs qui figurent aussi le
sentiment amoureux. De la chute de pluies diverses naissent toutes nos vies.
Giboulées
rigoureusement verticales, sans variation ? Sans déviation ? Sans
erreur ? Non. Ce sont d’infimes écarts dans la trajectoire de ces chutes
qui créent justement du nouveau. Il arrive que les atomes dévient de leur chute
programmée. Ronds, durs, lisses ou crochus, on les imagine à la ressemblance de
notre monde connu. Derniers – et premiers – degrés de la matière, ils sont
divisibles à l’infini, encore et toujours providentiels. Dans les courses au
destin, leur chant naît du silence. Comme l’animé sourd de l’inanimé.
Clinamen, imperceptible variation du
destin qui contrarie le rectiligne ordinaire, attendu, pour nous offrir
l’écart, la dérive originale d’où surgira le surprenant. Le déconcertant, l’étrange. La vie naît de l’agencement fortuit de
l’inanimé. Des blocs de météorites, déchets refroidis d’astres bouillants,
s’agglutinent dans l’espace pour refaire de la vie. Sempiternel mécano de la
matière.
Entre chaos
et ordre, la pluie d’atomes ouvre les horizons de notre liberté. Elle rend
possible un passage à inventer. Entre désordre de relations multiples et
affolées où chacun cède aux émotions et entretient leur flux électrique. Et désir
de comprendre, d’expliquer, d’imaginer d’autres lieux où vivre l’utopie.
Notre monde
bouge, rien ne semble devoir rester immobile. Il est un texte dense que l’œil
parcourt en s’accrochant à des parcelles de sens qui l’interrogent : les
idées sont-elles des corps ? Ne sommes-nous que des agrégats
d’atomes ? Et si la matière est divisible à l’infini, comment atteindre le
principe de toute chose ?
Captée dans
l’infiniment petit, l’image d’un synapse serait-elle la photo d’une idée ?
Une manière de porte manteau cérébral ? La matière, substrat de toute
chose, fait pleuvoir ses éléments dans une précipitation constante, patiente,
silencieuse.
Macrocosme
et microcosme s’assemblent dans une même image de fourmillement des corps, de
séparations et de rapprochements successifs, incessants.
Pas de deux dansé entre hasard et nécessité. Clinamen, tango céleste
INTIMUS CIRCUS
Un discret chapiteau rouge posé là comme par magie. Les
gradins surplombent une petite piste ronde enchâssée parmi les spectateurs. La
minuscule arène est cernée de loupiotes aux couleurs de l’étrange. Ce que vous
verrez là aura la tonalité à la fois crue et tamisée des rêves et des
souvenirs. Et le charme entêtant d’un filtre enchanteur. La poésie de cet art,
c’est son imaginaire de baraque de foire.
« Fais
pas ton cirque ! », intime-t-on aux enfants turbulents. Inversons cet
appel au calme pour en faire un désordre joyeux, une pagaille organisée. Un
droit à la mélancolie aussi. On se sent vite pris dans les filets délicats d’un
climat d’étrangeté, inquiétant par moments, surréaliste souvent. Voici les
clowns blancs. Le diable rouge. Les clowns noirs. Et puis toutes les images
fantomatiques et saisissantes du cirque, comme dans un théâtre d’apparitions
auquel il faut s’abandonner sans résistance pour ce qu’il convoque d’émotions
pures, viscérales. Il y aura donc des clowns, des dresseurs de fauves, des
acrobates, des jongleurs. Des pantins, des marionnettes, des automates. Et
leurs diaboliques tireurs de fils, en coulisse.
Et puis de
l’action, du geste – de la geste –, des prouesses. Homme-Hercule et diablotin
ailé s’aimantent, se repoussent. Leurs corps jonglent l’un avec l’autre, comme
le feraient deux pôles irrésistiblement jumeaux. Leurs mimiques épurées
suscitent des ébauches de songes. Force et grâce, ces deux-là font l’essence du
spectacle vivant. Un pantin exécute un numéro de barre fixe, lancé dans l’espace
par une impulsion mécanique, mystérieusement animé par un jongleur qui fait
tourner la barre sur un rythme saccadé. Le pantin sidère en mimant l’acrobate
humain. Ces héros du cirque figurent le pliable et le manipulable à l’infini. Ils
sont les métaphores de l’homme-marionnette, du Polichinelle si cher à la comedia del arte. Tradition et modernité
s’explorent dans une passion mutuelle.
Un duo de
clowns – des augustes – drôles,
menaçants, troublants, mettent en scène le désir de battre, de gifler, de
mordre. De tuer ? Les clowns mêmes seraient-ils devenus méchants ?
Retournement inquiétant des valeurs.
Dans leur
arène de poche circulaire, tous affrontent le vide et la mort. Sans avoir l’air
d’y toucher. La muleta agitée ici et là est le rideau rouge de notre petit
théâtre intime, entre fantasmes entrevus et bravoure folle.
Le cirque,
seule école de vie où l’athlète et le clown – le muscle et l’émotion – savent
se tenir la main, faire bon ménage. La palme va au marionnettiste qui, dans la
coulisse, manipule tous ces corps qui jubilent. Il est le grand maître de la
pantomime ambiante.
Entre
clameur et silence, le cirque fait son théâtre, ou l’inverse. Tous mêlent leurs
histoires et l’insatiable plaisir de jouer les noces irréelles entre forces du
ciel et de la terre. Entre veille et sommeil, rêve d’enfant ou chimère
d’adulte, le cirque c’est celui que l’on se crée. Lorsque les impressions
diurnes s’éclipsent au profit de la fantasmagorie des songes. Rondes d’images
parfois teintées de blues.
Le carrousel
de nos vagabondages d’enfance.
CHEFFERIE
Hymne martial et coups de menton. Le drapeau national
flotte fièrement au vent de l’Histoire. Le bon peuple a besoin de signes pour
sentir battre son cœur, se féliciter d’en être, se rassurer collectivement. Le
patriotisme citoyen s’incarnera toujours dans un personnage à la mesure du
récit national. Et pour reprendre ce flambeau sensible en s’extrayant du lot,
certains savent surjouer les postures
hautaines, faussement graves et risiblement nobles.
Expert dans
l’art de cultiver son rapport à la verticalité, l’homme providentiel a bonne
presse. En père protecteur, il offre son giron rassurant à tous les grands
enfants que nous sommes restés, en quête d’affection, de reconnaissance,
d’espérance. Le pays est une grande famille à gérer, à sauver, ou à remettre
dans le droit chemin. Et le vrai chef sait se trouver toujours là où il
convient pour imposer sa loi aux fratries belliqueuses.
Autoritaire,
le passé pèse du poids des habitudes, des rites, des institutions mises en
place. Il plane un climat bon enfant lorsque les regards se fixent ensemble – comme un seul homme – sur la ligne bleue
des Vosges. Mais un simple regard sur l’Histoire vient nous rappeler qu’un
mythe ancien et partagé alimente la fabrique contemporaine, et toujours
d’actualité, de l’homme providentiel. Comme il nous faut le pain et le vin
quotidiens, nous ne pouvons nous passer de nos grands hommes. La verticalité
nous rassure tant elle nous tient confortablement hors du jeu des
responsabilités. Quand la chefferie perdra-t-elle cette aura sacrée qui plombe,
sans qu’il s’en doute vraiment, le citoyen ordinaire ?
L’émergence
moderne de mouvements sans leaders – les Indignés, les Anonymes – dit notre
aspiration à plus d’horizontalité. Pendant des siècles, on a ressassé aux
masses qu’elles ne sauraient survivre sans chef pour les guider. Avec, en toile
de fond, le péril sourd des infantilisations rampantes. Jusqu’à quand la
virilité à l’ancienne poursuivra-t-elle sa tâche démobilisatrice ?
Il est
urgent de démythifier tous les sauveurs potentiels, tenants têtus et douteux
d’une épopée permanente. L’autorité pyramidale a vécu. Une nouvelle matrice
esquisse enfin la figure proche du chef d’équipe, animateur à l’esprit
coopératif. Le patron de droit divin, claquemuré dans son bureau, loin de ses
salariés, semble avoir pris du plomb dans l’aile. Chacun avait pris l’habitude
de camper sur des positions stéréotypées : le chef au sommet de la
pyramide, la base plongée dans l’anonymat. Et la conséquence probable du choc
frontal en guise de relation d’autorité.
L’intelligence sociale, basée sur des comportements plus horizontaux,
ouvre de nouveaux critères du travailler
ensemble : rassembler des équipes, déléguer et faire confiance,
communiquer, mobiliser. La légitimité du dirigeant devrait reposer sur la
justice et l’exemplarité. La médiation veut
s’instaurer en règle commune, permettant d’alléger les conflits,
remobilisant des troupes apaisées et recentrées sur la tâche. En toile de fond,
l’instauration d’un pragmatisme vivable. A hauteur d’humain.
La
sempiternelle épopée verticale a pris figure de carton pâte.
DEMOCRATIE
Déni
et absurdité. Les choses tournent en rond, n’en finissent pas d’alimenter une
ritournelle devenue insensée. Le citoyen démocrate assiste médusé au délitement
du système qui s’affichait pourtant comme celui de la vie bonne. Toute une manière de penser, d’organiser le monde se
dilue dans une impasse à laquelle il participe pourtant… sans le savoir – ni le vouloir – vraiment. Et
sans adhérer activement au droit de donner son avis. Que reste-t-il du « parler, écouter », bases du débat, le cœur battant de l’exercice
démocratique ?
On laisse
inoccupés de très nombreux logements citadins qui pourraient dépanner des
milliers de sans-logis abandonnés à la rue. Croyant bien faire, les
responsables publics autorisent la création de parcs d’attraction grandioses
qui dévorent des espaces naturels irremplaçables, dédiés au bien commun depuis
des lustres. Logique implacable du « détruire pour créer ». Nos Etats
de droit s’entendent au plus haut niveau pour acheter un droit à polluer devenu
naturel. Nos responsables élus cèdent devant des pouvoirs financiers toujours
plus voraces et directifs. Les affaires privées soudoient les intérêts publics.
Que reste-t-il de nos parcelles de liberté collective, de solidarité active ?
La
démocratie meurt à petit feu, faute d’être pratiquée dans le débat citoyen. En
lieu et place, les médias mettent en scène des caricatures de disputes qui
virent à la parodie permanente. Laïcité, vie collective, intérêt général, les
mots se vident de leur sens et de leur vertu, à force d’être répétés sans
effets, sans suites données. On n’y croit plus.
Les
« urnes » sont délaissées, accentuant encore l’impression ambiante de
grande fatigue démocratique. Pourquoi confier le pouvoir à des gens qui mentent
par omission pour se faire élire, avant d’oublier ensuite leurs
engagements ? A parole publique dévoyée, désert électoral assuré.
L’exercice de la représentation citoyenne s’épuise. Le dictionnaire lui-même ne
donne-t-il pas un premier sens inquiétant au mot « urne » : vase qui sert à renfermer les cendres d’un mort ? Le présage ne manque
pas d’être troublant.
Une longue
et lente fatigue démocratique nous envahit. Et nous pousse à laisser souffler
un grand air de désenchantement.
C’est
oublier un peu vite que nous vivons dans les sociétés les plus libres, les plus
tolérantes, les plus riches et les moins inégalitaires que l’histoire a
connues. Comme tout ce qui est bon, la démocratie ne brillerait-elle que par
l’hypothèse de ce que nous serions en son absence ? Ne séduirait-elle
vraiment qu’au moment de son établissement ? Avant que l’on en oublie
aisément les vertus et avantages pour la considérer comme un simple dû ?
Manière simpliste de voir le don : à sens unique.
Mais la vie
associative est là, toujours aussi riche, multiple. Et avec elle le souci
accordé au plus proche, l’exercice simple et naturel de la compassion, la
dynamique du travail commun, la recherche et l’accomplissement de projets
collectifs. L’attention à chaque membre de l’ensemble porté par tout membre de
l’ensemble. La société demeure alors ce corps composite qui dessine la
silhouette en creux du peuple vivant.
Le demos n’est pas mort, il bouge encore.
ANTIHEROS
Bardé de sa rancœur et de toutes les frustrations
accumulées, le terroriste avance avec l’assurance du droit acquis, conquis,
requis. Derrière lui, l’armée silencieuse de ceux qui le soutiennent, là-bas,
veut-il croire. Devant lui, l’avenir radieux du martyr qui sacrifie sa vie pour
une cause qui le dépasse. Et qu’il n’a surtout pas pris le temps d’examiner
avec sa raison. Quelle raison ? Réfléchit-on lorsqu’on est mû par la haine
aveugle propre à l’exclu ?
Car il n’est
rien, ne se sent rien, n’aspire plus à rien.
Il est – se veut ? se proclame ? – le produit avarié d’une société pour
lui vide de sens. Son déchet avéré, désigné. Plus que du doigt, des yeux. Du
siège-même des émotions. Arpentant la ville de son enfance, Il ne reconnaît
rien ni personne. Personne ne le voit. Il n’en est pas. Il a intériorisé avec
le temps un espace qu’il a transformé en prison intérieure. En ghetto. A force
d’ondes négatives vérifiées, accumulées, il a devant lui les preuves d’une
exclusion qu’il veut injuste, féroce, irrémédiable. Il en a déjà pris acte,
parcourant un à un les affres minables de la petite délinquance. Mais rien ici
pour se faire reconnaître valablement, durablement.
Comment
passer du mépris de soi à la haine des autres ? Comment surtout rendre
sacrée cette rage qui l’habite, le hante, l’excède ?
Sinon en donnant à son mal-être un sens qui le dépasse, celui d’une justice
ordonnée d’en haut, par un Très-Haut.
Même s’il ne le connaît pas. Surtout s’il ne le connaît pas : il se veut
proche, d’emblée, de ce Grand Anonyme qui lui ressemble et dont il se donne le
droit de confisquer le sceau pour ce qui l’arrange. La fureur qui le dévore en
appelle à des nourritures secrètes, occultes, héritées de ses lointaines
origines, étrangères à tous ces impies, ces hérétiques qu’il côtoie chaque
jour. Le voilà prêt à basculer dans une traversée initiatique qui le confirmera
enfin dans l’identité qui lui faisait défaut.
Lui, le bouc
émissaire d’un système qui l’ignore, découvre le pouvoir insensé de retourner
aux autres leur regard négatif, de se voir enfin vainqueur dans leur yeux
apeurés. Mortel effet miroir. C’est la voie de sa revanche. Le triomphe des absents.
Le prix importe peu tant l’enivrement délivre. Puissance du faire corps : on lui offre le
statut de héros. Le voici chevalier autoproclamé. Il se sent enfin quelqu’un.
Tout est bon
pour alimenter cette deuxième naissance à laquelle il ne croyait plus. Le voilà
prêt à tout, au service aveugle de cette sacralité qui l’a vu renaître enfin.
Lui l’ancien banni a trouvé la cause
qui fera de lui un héros. Le héros
parmi une foule de prétendants avec qui rejouer – à armes égales cette fois –
un nouveau spectacle mimétique. Une grand-messe où la surenchère est la règle,
où la perfection prend des airs de quête infernale. D’un enfer à l’autre,
quelle différence ? Celle de choisir, justement, d’en être ? Celle de
la pureté absolue du soit disant martyre consenti. L’anti-héros est prêt.
Il n’a pas
raison ? Peu importe : il a le pouvoir de se donner raison. S’inscrivant sur le grand marché de la
martyrologie, sait-il que sa victoire intérieure sera de courte durée ?
Tant l’illusion et la folie sont les moteurs pervers des héros négatifs. Leur
carburant fétide pour embraser les destins, perdus d’avance, de ceux qui,
n’ayant plus rien à perdre, jettent toutes les vies – les leurs comme celles
des autres – aux horties de l’Histoire.
L’infernale
mécanique du retour au même et à l’identique a gommé toute altérité et creusé un vide cérébral abyssal. La
radicalité a mystifié l’exigence. Tué l’intelligence.
Produit
pervers de l’effet miroir, la haine est fille du désespoir.
SOUFFLEUR
Retour à la
soupe primitive. La boule rouge ondoie, hésitant entre fusion et calcination,
fragment arraché à une très lointaine coulée de lave. L’homme la tient au bout
de sa canne comme aux rets de son regard fasciné. Son visage perle de la sueur
qui accouche. Du matériau brut jaillit l’œuvre en état d’éruption. Passage
secret de la nature à la culture.
Ce que
dompte ce moderne Vulcain, c’est un lambeau de pierre de lune. Un peu du noyau
des origines abandonné par le créateur au centre de la planète bleue. Vomissure
d’étoile, crachure de volcan, le cœur en fusion trahit sa présence enfouie au
plus profond, entre pelure et centre nucléaire.
Par quelle
magie la boule de pierre et feu mêlés est-elle en passe de se transmuer en
verre cassant et transparent comme la glace ? Le souffleur en tait le
jaloux secret. Il n’écoute que son poignet élastique tournant et retournant la
canne creuse animée d’un souffle redevenu divin. Mimétique, son geste figure
celui du musicien explorant les trésors infinis de la gamme. La main rêve à la
pointe de son instrument, comme celle du sculpteur affronte le marbre Ou celle
du potier donne forme à la pâte. Menaçante, la boule gonfle jusqu’à enfler
comme une géante rouge. Retour aux origines du monde.
Ardents
comme ceux d’un dompteur, les yeux du vulcain fixent la chose en sa
métamorphose. Ils guettent, gourmands, l’instant précis du gonflement porté à
son acmé, celui où la forme se fait couleur. Oranges subtils, et jaunes d’or
épanouis succèdent insensiblement aux rouges de feu. Chronologie chromatique
aux fins glissandi de tonalités.
Ardent
rêveur, le maître verrier sait que la difficulté de son métier vient justement
de l’apparente fluidité de sa matière. Faire, façonner, fabriquer, créer. Même
dans l’atmosphère étouffante d’un four à porcelaine où le visiteur oisif peut
croire à l’enfer, l’ouvrier actif n’est plus le serviteur du feu, il est son
maître. Et si c’est une rêverie, elle est active, les armes à la main. Et puis
chaque travail n’a-t-il pas son onirisme propre ? Chaque matière
travaillée n’apporte-t-elle pas ses songes intimes ? L’artisan le
sait : on ne fait rien de bien à contre-cœur, à contre-rêve. Ah ! il songe à un temps béni où chaque métier
aurait son rêveur attitré, son guide onirique, où chaque manufacture aurait son
bureau poétique !
Imperceptiblement, le verre qui tiédit offrira bientôt ses parois
translucides au regard apaisé du verrier appréciant dans ses courbes épurées
l’objet de son ouvrage. Ou – occurrence fâcheuse – si la pâte s’est montrée
rebelle à sa fantaisie, l’artisan déçu la rattrapera en lui accordant la forme
la plus facile à souffler : celle d’une flasque, synonyme d’un fiasco qu’il tentera d’oublier.
Epuisé, assouvi, l’artisan démiurge peut contempler
le fruit de son expir. L’esprit qui anime a su inspirer son geste créateur. Entre
souffle, rêve et travail, le geste a conquis la matière.
Et su
atteindre les régions éthérées de l’âme. Anima
sua.
mardi 17 février 2015
EMOUVANCES (9) Fragments de temps suspendu
LegoBaladin
SIXTINE
EPHEMERES
 Que peuvent
avoir en commun des phénomènes naturels aussi divers que l’agencement des
graines d’une fleur de tournesol, l’élégante spirale dessinée par la coquille
de certains mollusques, et le profil de la Voix Lactée, la galaxie qui nous
accueille ? Quelle règle géométrique d’une inégalable harmonie se cache
dans l’œuvre de grands artistes et architectes, de Vitruve à Le Corbusier en
passant par le grand Léonard et Salvador Dali ? Aussi incroyable que cela
puisse paraître, la réponse à ces questions est un simple nombre !
Que peuvent
avoir en commun des phénomènes naturels aussi divers que l’agencement des
graines d’une fleur de tournesol, l’élégante spirale dessinée par la coquille
de certains mollusques, et le profil de la Voix Lactée, la galaxie qui nous
accueille ? Quelle règle géométrique d’une inégalable harmonie se cache
dans l’œuvre de grands artistes et architectes, de Vitruve à Le Corbusier en
passant par le grand Léonard et Salvador Dali ? Aussi incroyable que cela
puisse paraître, la réponse à ces questions est un simple nombre !
MAÏEUTIQUES
 Chair
de nos mères, paroles de nos pères. Quand la parole prendra-t-elle chair si la
chair est impuissante à livrer parole ? Le fleuve du temps voit chaque
père reprendre insensiblement ses gammes sur le père enfoui avant lui… en
prenant soin du père à venir. Chaque génération penche sur la suivante un
regard attendri, au risque de s’y perdre. Père présence, disparition, force.
Père calme, peur, refuge. Père oubli, patronyme, transparence. Tous pères
solidaires. Et si les pères sacrifiaient leurs goûts, leur consistance, et
jusqu’à leurs rêves pour dédouaner d’antiques pères absents, fantômes demeurés
à l’état de trace, d’ébauche, car trop vite disparus, évaporés. Mais quel père
est-il vraiment comptable d’un autre alors que tous le sont par hérédité
ordinaire des âges, sourde voie d’héritage ? Devoir vital d’échapper au
long cortège de la malédiction des pères. Oser sortir de la lignée immémoriale
pour rester au guet d’un chemin singulier et solitaire, à la croisée de tous
ces pères possibles à épuiser… sans en élire aucun.
Chair
de nos mères, paroles de nos pères. Quand la parole prendra-t-elle chair si la
chair est impuissante à livrer parole ? Le fleuve du temps voit chaque
père reprendre insensiblement ses gammes sur le père enfoui avant lui… en
prenant soin du père à venir. Chaque génération penche sur la suivante un
regard attendri, au risque de s’y perdre. Père présence, disparition, force.
Père calme, peur, refuge. Père oubli, patronyme, transparence. Tous pères
solidaires. Et si les pères sacrifiaient leurs goûts, leur consistance, et
jusqu’à leurs rêves pour dédouaner d’antiques pères absents, fantômes demeurés
à l’état de trace, d’ébauche, car trop vite disparus, évaporés. Mais quel père
est-il vraiment comptable d’un autre alors que tous le sont par hérédité
ordinaire des âges, sourde voie d’héritage ? Devoir vital d’échapper au
long cortège de la malédiction des pères. Oser sortir de la lignée immémoriale
pour rester au guet d’un chemin singulier et solitaire, à la croisée de tous
ces pères possibles à épuiser… sans en élire aucun.
LUDOPHONIES
s’émouvoir. Il y a grande jubilation à la langue en fête. Et à la fabrique des mots.
 Art du rêve. Rêve d’enfance. Enfance de l’art. Toute
une vie se résume sur la surface d’un seul tableau aux couleurs multiples.
Grand carnaval des animaux figuré par le peintre passionné des origines de la
vie. Entrelacs de scènes anthropomorphiques où hommes et bêtes mêlés emplissent
un univers pictural nourri aux souvenirs enfantins. Visions et fragments de
réalités côtoyées ou entrevues. Echos fertiles et touchants offerts au jeu
candide des associations. Naïveté d’un regard naissant sur la magie possible du
monde. La vie paysanne déploie son réalisme ingénu. L’homme devenu adulte se
plaît à ranimer l’enfant assoupi en lui. Songes éveillés pour enfançons ravis.
Art du rêve. Rêve d’enfance. Enfance de l’art. Toute
une vie se résume sur la surface d’un seul tableau aux couleurs multiples.
Grand carnaval des animaux figuré par le peintre passionné des origines de la
vie. Entrelacs de scènes anthropomorphiques où hommes et bêtes mêlés emplissent
un univers pictural nourri aux souvenirs enfantins. Visions et fragments de
réalités côtoyées ou entrevues. Echos fertiles et touchants offerts au jeu
candide des associations. Naïveté d’un regard naissant sur la magie possible du
monde. La vie paysanne déploie son réalisme ingénu. L’homme devenu adulte se
plaît à ranimer l’enfant assoupi en lui. Songes éveillés pour enfançons ravis.
 Puissance du
coloriste. Violence des éclats de lumière. Sensations tactiles optiquement
suggérées par les matières. Métal, ciels, soies ou chairs ouvrent autant
d’univers parallèles que nos regards pénètrent sans en croire vraiment leurs
yeux. L’artefact pictural transmue nos réels en autant d’éclats de vie toujours
déjà là où coule la source de nos mondes intérieurs. Devant nous l’incroyable
auquel il nous est soudain donné de croire, le voilé dévoilé, le figé habité,
l’éthéré tangible.
Puissance du
coloriste. Violence des éclats de lumière. Sensations tactiles optiquement
suggérées par les matières. Métal, ciels, soies ou chairs ouvrent autant
d’univers parallèles que nos regards pénètrent sans en croire vraiment leurs
yeux. L’artefact pictural transmue nos réels en autant d’éclats de vie toujours
déjà là où coule la source de nos mondes intérieurs. Devant nous l’incroyable
auquel il nous est soudain donné de croire, le voilé dévoilé, le figé habité,
l’éthéré tangible.
BIOPHONIES
Isolation, normes, protection, l’acoustique prend des airs de repli dans l’ordonnancement, la restriction, le contrôle. Notre capacité à entendre ne procéderait-elle plus que par soustraction, annulation, disparition ? Sommes-nous à ce point tentés, hantés par le silence ? Et qu’en est-il de la signature acoustique propre à tout ce qui vit ?
 Car le vital
bruisse de mille émissions aux fonctions ordinaires ou inattendues. Créations
buccales de tous ordres, entre borborygmes, flatuosités, gargouillis bizarres,
plus ou moins infâmes, ou nobles vocalises célébrant l’esthétique. Murmures
signés, codes inscrits au plus secret des organes intérieurs. Chahut sonore de
la corporéité se rappelant à notre bon souvenir comme à notre plus fine écoute.
Car le vital
bruisse de mille émissions aux fonctions ordinaires ou inattendues. Créations
buccales de tous ordres, entre borborygmes, flatuosités, gargouillis bizarres,
plus ou moins infâmes, ou nobles vocalises célébrant l’esthétique. Murmures
signés, codes inscrits au plus secret des organes intérieurs. Chahut sonore de
la corporéité se rappelant à notre bon souvenir comme à notre plus fine écoute.
SIXTINE
Le doigt de Dieu. On ne voit que lui, plein centre de
l’immense voûte où dansent cent figures sculptées célébrant la fête des corps
dans un paradis perdu des origines. Vaste scène primitive sans haut ni bas,
flottant dans un espace que le peintre a voulu céleste. Le mouvement y
tournoie, le flux y circule, à l’aune d’un vertige créateur dont la divinité
seule sait apprécier le détonant secret.
D’un geste
nonchalant, Adam étend son bras gauche pour recueillir l’énergie vitale que
Dieu lui transmet de sa main droite. Du divin à l’humain, symétrie savante,
entendue, des mondes prêts à fusionner sans tout à fait se mélanger. Les deux
index se rapprochent sans se toucher. Entre Dieu et sa créature, la poignée de
main est télépathique. Car si Adam est à l’échelle de l’homme, Dieu, lui,
s’élève à l’échelle des astres. Il flotte de toute sa masse au-dessus du monde
interstellaire, enlaçant une jeune fille prépubère préfigurant sans doute la
Vierge. Enveloppé dans une cape ondulante, le corps aérien semble esquisser
dans l’espace une coupe d’encéphale propre à insuffler l’esprit aux malheureux
mortels que nous sommes et demeurons. Tout le plafond de la chapelle tourne
autour de ces deux doigts que sépare un vide infinitésimal et pourtant sidéral.
C’est le moment unique, sublime, qui voit l’œuvre jaillir des mains de son
créateur. Instant magique de tous les possibles dont nous prend l’envie
d’isoler la grâce, pressentant qu’elle ne durera pas.
Déjà,
pressant l’homme, s’annonce la figure séduisante d’Eve, suivie par l’ombre d’un
serpent vigoureux et tentateur. On devine alors - plus que l’on ne la voit
s’accomplir - la laide déchéance d’un couple banni et la cohorte des malheurs
conséquents. Mais pour l’heure, le peintre est tout à sa joie d’animer la
puissance des chairs que décuple à l’infini l’originalité du modèle. Autour de
lui, le génial Adam voit ainsi se décliner sans fin une profusion de nus aux
formes sculpturales : prophètes en méditation, sibylles inspirées, enfants
cariatides, tous exposant leurs corps glorieux dans une vaste fresque qui
célèbre l’ancien récit et annonce le nouveau. L’arbre généalogique du Sauveur
est en place sans toutefois que celui-ci n’apparaisse nulle part. Le message
visuel célèbre l’œuvre totale déclinant peinture, architecture et sculpture.
L’arc de triomphe à ciel ouvert, dédié à l’homme bâtisseur, peuple les arcades
de cette immense galerie à claire-voie, ouvrant un gigantesque continent où
pierre marbre et chair humaine s’entremêlent, tous convoqués par le créateur
pour les besoins d’une fiction conçue ex
abrupto à notre intention.
Mais il
arrive que l’œuvre, échappant en partie à son auteur, infléchisse ses
innocences premières vers des réalités plus prosaïques. Ainsi, la fraîcheur des
origines transmue sa gratuité au gré d’une Histoire qui la dépasse. Sous la grâce
éphémère dormait l’impatience des ego.
L’homme alangui fait place au potentat investi : laissant se déployer la
continuelle marche en avant du désir, l’état de nature cède sa place à celui de
culture. Le paroxysme de la peur - celle que l’on éprouve comme celle que l’on
crée - s’incarne dans le scénario implacable de duels fratricides. Les hommes
découvrent qu’ils adorent se faire peur. Notre semblable nous devient
intolérable et génère la crise mimétique qui appelle le grand Léviathan :
le pouvoir tombe dans l’escarcelle d’institutions prêtes à le faire fructifier
jusqu’à la confiscation. L’irascible Caïn a tué l’innocent Abel, provoquant la
naissance des nations et de leurs lois. La collusion secrète du sabre et du
goupillon s’organise, inventant des configurations fécondes que l’Histoire
validera cent fois, confisquant à l’art la fraîcheur originelle et magique de
la danse des corps. L’homme vient de perdre son innocence.
D’impeccables soldatesques en ordre de bataille sont désormais prêtes à
écrire maints récits de prise de pouvoir occultes, éphémères, répétitives. Le
plafond sublime des corps éclatants a accouché, à quelque vingt mètres sous sa
voûte, au ras du plancher des vaches, d’un long cortège de corporéités
spectrales aux chairs enfouies dont seules émergent des têtes livides,
omniscientes, aux visées omnipotentes. Cardinale et somnambulique cohorte des
soldats de Dieu vêtus de chasubles asexuantes,
aux teintes sanguinaires de l’incarnat, entonnant sur une seule note hypnotique
la litanie mortifère des inusables martyrs de la cause. Causa nostra porteuse de mort, exaltant le sacrifice sans fin des
chairs flétries. Vingt mètres plus haut, le Dieu planant ne peut que jeter un
regard affligé sur cette absconse réalité humaine, lointainement engendrée,
mesurant combien l’œuvre a définitivement échappé à son créateur. « Je ferai
pleuvoir sur terre quarante jours et quarante nuits », se surprend-il à
proférer en guise de menace. Mais y croit-il encore, témoin atterré de ce long
cortège de vieillards cacochymes qui se balance au rythme d’une lettre morte
qui a su escamoter son Verbe génial ?... Le bienheureux pouvoir divin
accouche en direct d’une chimère cléricale.
Comment la
fête des corps a-t-elle pu engendrer
cette légion impuissante, éplorée, de fantômes égrotants, uniques locataires
désormais de la chapelle magique transformée en une immense salle fermée à clé.
« Con clave ». Conclave. Marmite autoclave plutôt où barbotent
de misérables secrets prestement réduits en cendres dans la fumée grisâtre
d’une ridicule cheminée sans âge. Pacotilles célestes aux relents de bondieuseries
fumeuses. Torves manœuvres sur fond de confidences codées, de lenteurs
millénaires, de scénarios simplissimes où bons et méchants s’étripent avec
jubilation. Clergé médiatique qui ne sait que détester ou adorer et fait
semblant de connaître ce qu’il ne comprend toujours pas. Triste réalité propre
à enfumer la foule hystérique des pèlerins qui s’engrouillent, béats, aux aguets de la consolante papale prête à
choir du balcon lointain. « Une preuve du pire, c’est la foule »,
nous glisse à bon escient le poète.
Quant à
Dieu, à jamais frustré de ses essais créateurs, on peut l’entendre expirer dans
un souffle du tonnerre de Zeus : " Tonnerre, je ne joue plus pour tous
ces pauvres hères. J’ai peur que la fin du monde soit bien triste."
EPHEMERES
Le fugace a un faible pour les incartades précaires,
insolites. De celles qui nous laissent interloqués et ravis. On y déniche
pêle-mêle des queues de ficelle, de ces bouts d’on-dit / as-tu-vu qui font l’avers plaisant des longs exposés et
des récits patiemment construits. Il arrive que ces frêles libellules - éphémères - jouent les passeuses entre
des vérités consistantes, des narrations échafaudées, bien charpentées, aptes à
nous rassurer. Pour autant, il nous les faut ces précieuses vétilles,
coutumières de nous peaufiner des pauses salutaires au creux de scénarios trop
bien fagotés, aux issues attendues. Au jeu joyeux des hasards survient parfois
l’aventure qui sait dérider nos pesanteurs ordinaires.
Tout
ronronnait jusqu’alors… quand surgit l’étincelle qui se met à vibrionner devant
nos yeux épatés. Suspension des durées communes, un flottement physique et
mental nous propulse loin du cours attendu des choses. Nous touchions à
l’assoupissement où nous plonge toute histoire qui musarde : combien de
temps durerait la traversée nous embarquant au fil du livre, du tableau, du
film ? Le moment peut venir où, lassé de nous, de notre attention devenue
flottante, le récit se révolte, se révulse et décide de quitter ses codes et
ses repères douillets pour nous affoler et nous surprendre. Et c’est souvent
par pure effraction qu’il ouvre devant nous un espace troué d’interstices, une
fissure, un étonnement, un frisson embryonnaire qui réveille nos impatiences et
ranime une ancienne aspiration à l’étrange.
Le cinéaste
lui-même reprend la chose à son compte : il connaît nos limites de
spectateurs et sait jouer avec les codes. Aussi choisit-il le moment propice
pour suspendre le récit en nous prenant par la main, ou par le regard plutôt.
L’œil est soudain saisi par le minuscule, l’inattendu ou le sublime, injectés
sans coup férir dans une durée subliminale de quelques secondes où s’égrènent
pourtant quelques moments précieux de véritable éternité qui feront trace.
Ainsi dans
cette ville en état de siège investie et terrorisée par des militaires en armes
à chaque coin de rue, nous assistons à la fuite de civils qui se terrent, se
dissolvent dans chaque trou disponible, talonnés par la peur à chaque plan du
film. Rafales d’armes automatiques, cadavres sur le bitume, contrôles et
arrestations sommaires. Paysage de désolation, le récit court - lui aussi -
dans une épouvante qui dure, nous prend aux tripes, confine au désespoir. Et
c’est au mitan du film, au moment où l’on n’attend plus d’éclaircie, que le
cinéaste choisit de nous délivrer une séquence nocturne, onirique : sur
une avenue glauque, surgi de nulle part, un immense cheval blanc traverse
l’écran - notre écran mental et affectif - de gauche à droite, dans un galop
sonore et superbe, poursuivi de près par une jeep de soldats tirant en l’air
(comme fêtant - eux aussi ! malgré eux - la liberté ?). Un air de
délivrance baigne les esprits durant quelques secondes qui figurent la force
d’un espoir possible, irréel, s’extrayant soudain de deux heures de drame.
Ainsi dans
le huis clos d’un appartement citadin abritant la fin de vie d’un vieux couple
solitaire, nous voici plongés dans un climat de mort qui rôde, ne sachant quand
elle adviendra. Le cinéaste nous relève soudain de notre tension attachée à
cette mort programmée, nous emmenant très loin du lieu oppressant - sans le
quitter pour autant - pour une brève et bienvenue bouffée d’oxygène. Cinq plans
muets de quatre secondes chacun nous transportent au cœur de cinq toiles
accrochées aux murs de l’appartement. Toiles quelconques, de paysages anonymes,
mais convoquées là pour dire simplement l’ailleurs de la mort, son avers
tangible dès lors que visible. A la suite desquelles le cinéaste sait que nous
pouvons nous retourner un peu plus légers vers l’issue du récit de la mort qui
rôde.
Légèreté,
fugacité de l’éphémère. Fragilité de l’insecte éponyme dont la durée de vie se
perd dans les eaux stagnantes des marais. Fleur et papillon accompagnent l’idée portée par l’homme antique sur ces
moments de vie qui ne font que s’évanouir. Sans lendemain, puisqu’attaché au
jour même, l’éphémère est ce moment court, passager, provisoire, qui n’excède
pas ce jour, ou cet autre, marqué par son éphéméride particulier. Paradoxe
entre la conscience du temps qu’il requiert pour le nommer et la pensée de son
inconsistance. Tension entre le ponctuel et la durée, le continu et le
discontinu, la présence et l’absence. Convulsion annonciatrice d’une mort
prochaine. Spleen entre angoisse et
lyrisme.
S’il revient
aux multiples formes d’art de fixer la richesse complexe qui anime la vie, certaines
semblent cristalliser les paradoxes de l’éphémère. L’espace du poème parvient à
saisir au filet des mots, dans le rythme du souffle, le volatile des émotions
et des pensées, les métamorphoses de l’être. Lutter contre la disparition,
l’oubli de nos impressions les plus fines, telle est la gageure du sculpteur de
mots. « Ce qui plaît au monde est un songe éphémère »,
se lamente Pétrarque. A chacun de défendre la géographie des mots particulière
à son espace personnel, au rapport singulier qu’il entretient avec eux, en lien
étroit avec ses récits de vie. Imaginons nos mots inscrits sur autant de petits
papiers que nous transformons parfois en boulettes serrées à balancer
étourdiment dans le monde… Et si nous les défroissions sans les déchirer, pour
les lisser et leur faire prendre un envol conscient, appliqué, attentif… mémorable ?...
Volonté de retenir le « presque
rien » et la certitude rassurante du « ça a été » chère à Roland Barthes.
Dans toute
photographie niche un miracle : la rencontre de l’éphémère et d’une forme
d’éternité. Dans la structure microscopique des photons figeant les zones de
l’image, comme dans la structure granulaire du temps physiquement inscrit. A y
regarder de plus près, le temps vécu n’est pas continu, mais fait d’instants
discrets dont chacun compose un chiffre parfait. Pénétrant la structure interne
de chacun de ces petits miracles, nous y verrions autant d’instantanés dont la
force ne dépend que de la qualité du regard que nous savons leur accorder. L’éternité
du transitoire se niche dans la nature du regard porté sur l’instant - anodin,
fugace, en lui-même. Le sensible est une nymphe en perpétuelle métamorphose,
composée de caractères, d’idéogrammes parfaits, aux géométries accomplies. Le
monde est un texte, une rêverie poétique toujours à l’œuvre, invisible dans le
visible. A nous d’en décrypter les transitions magiques. Multiple présence.
Surgissements secrets. Poéthique.
« Mon esprit galope comme un cheval
étonné », constate le philosophe aux aguets. « Il se balade en liberté sur la toile de mes fictions »,
ajoute en écho le peintre cinéaste. Tous les deux ont raison. L’art sait
inscrire nos imaginaires dans les fugacités durables de l’éphémère. Si durables
qu’il nous est loisible d’en faire l’inventaire, nous en rejouant mentalement
la pertinence apte à nourrir notre mémoire émotive. Fines libellules du
sensibles, ces éphémères témoignent de jeux de bascule dans l’étrange qui
frisent souvent une élégance de l’instant que nous ne soupçonnions guère. Une
manière d’apogée de la métamorphose.
NOMBRE D'OR
Divine proportion. Rapport magique contenu tout
entier dans la symbolique d’une lettre : la « phi » grecque, initiale du légendaire Phidias, architecte
du classique Parthénon dont la structure se décline en autant de rectangles
d’or. « Les choses qui sont dotées de proportions correctes
réjouissent les sens », note Thomas d’Aquin.
 Que peuvent
avoir en commun des phénomènes naturels aussi divers que l’agencement des
graines d’une fleur de tournesol, l’élégante spirale dessinée par la coquille
de certains mollusques, et le profil de la Voix Lactée, la galaxie qui nous
accueille ? Quelle règle géométrique d’une inégalable harmonie se cache
dans l’œuvre de grands artistes et architectes, de Vitruve à Le Corbusier en
passant par le grand Léonard et Salvador Dali ? Aussi incroyable que cela
puisse paraître, la réponse à ces questions est un simple nombre !
Que peuvent
avoir en commun des phénomènes naturels aussi divers que l’agencement des
graines d’une fleur de tournesol, l’élégante spirale dessinée par la coquille
de certains mollusques, et le profil de la Voix Lactée, la galaxie qui nous
accueille ? Quelle règle géométrique d’une inégalable harmonie se cache
dans l’œuvre de grands artistes et architectes, de Vitruve à Le Corbusier en
passant par le grand Léonard et Salvador Dali ? Aussi incroyable que cela
puisse paraître, la réponse à ces questions est un simple nombre !
Un nombre
d’une humble apparence, connu depuis l’antiquité, qui apparaît continûment dans
toutes les représentations naturelles et artistiques : le Nombre d’or. Un
nombre à peine supérieur à l’unité, mais composé d’une suite infinie de
décimales. A l’image du fameux « pi »
grec, lui aussi, connu de tous les collégiens. Valeur arithmétique dorée :
1,61803… Nombre d’objets de notre quotidien sont façonnés selon cette divine
proportion : livres, cartes de crédit, journaux, téléviseurs, tableaux,
écrans divers… Dorées sont nos fenêtres ouvertes sur le monde.
La première
trace écrite de phi remonte à l’an
300 avant JC, dans un ouvrage qui compte parmi les plus célèbres, les plus
imprimés et les plus commentés de l’Histoire : les Eléments de géométrie d’Euclide. Œuvre maîtresse pour la
compréhension du monde, premier best-seller scientifique, ouvrage fondamental
de notre culture. « Le tout est à la
partie ce que la partie est au tout. » Ainsi, le rapport Longueur / largeur
de nos cartes familières est-il sensiblement toujours le même : 1,61803…
Géométrique à l’origine, le vieux nombre d’or donna naissance à des suites
arithmétiques remarquables mises au jour par le plus grand mathématicien du
Moyen Age : Finobacci, fils d’un marchand italien du XIIe siècle initié
aux mathématiques arabes et au système arabo-hindou. Avant une vulgarisation
européenne qui créa nombre d’objets à la logique rigoureuse : compas d’or,
spirales, pentagones, étoiles, pavages, polyèdres, pyramides, flocons de neige…Tous
phénomènes aux équilibres secrètement codés. Le Nombre d’or au cœur du langage
mathématique de la beauté.
Depuis les
pyramides d’Egypte jusqu’à la Porte du
Soleil, monument de culture pré-inca, des civilisations éloignées par le
temps et l’espace se rejoignent - sans toujours se concerter - dans leur estime
du nombre d’or. Même l’éminent luthier Stradivarius prit la précaution de
percer les trous de ses violons selon les proportions d’or. Architecture,
astronomie, dessin, peinture… Toutes ces activités humaines font appel à une
même loi.
Qu’en est-il
de la Nature ? Symbole de l’idéal humaniste de la Renaissance, l’Homme de Vitruve, de Léonard de Vinci
met en valeur les proportions idéales du corps humain, inséré dans un carré et
dans un cercle. Le rapport entre le côté du carré et le rayon du cercle est le
nombre d’or. Et même si notre développement physiologique humain est soumis à
un constant changement de proportions, nous conservons notre forme d’origine
selon une figure précise et régulière : la spirale.
Les insectes
tracent également une spirale quand ils s’approchent d’un point de lumière. Les
rapaces suivent cette même trajectoire quand ils se lancent en chasse. C’est la
seule qui leur permette de maintenir la tête droite sans jamais lâcher des yeux
leur proie. La vie végétale n’est pas en reste. Etudiant la disposition des
feuilles sur une tige, nous remarquons que celle-ci obéit à des règles
géométriques et numériques : une sorte de « patron », une
organisation, apparaît alors, par groupes de cinq et suivant… des
spirales ! Le chou romanesco déploie ses spirales parfaites vers la droite
et vers la gauche selon les suites du nombre d’or. Quant à la taille d’un
arbre, elle varie tout au long de sa vie, mais son apparence extérieure - les
proportions entre sa taille et la longueur de ses branches - restent identiques.
La spirale
d’or donne forme aux escargots. La structure interne de la coquille du Nautilus se construit par ajouts
successifs de compartiments chaque fois plus grands, mais qui conservent tous
la même forme. Décidément, le nombre phi n’a
rien d’une antiquité qui aurait pris la poussière, bien au contraire : il
continue sa vie, plus vigoureux que jamais ! Son territoire de compétence
sur nos univers présente des horizons infinis qui n’en finissent pas d’étonner
le spécialiste comme l’amateur. Selon le mot célèbre de Galilée, l’immense
livre de la nature est écrit en langage mathématique. Qui nous incite à
décrire, comprendre et agir. Triptyque sur lequel s’est construit le progrès du
savoir humain. Et son incroyable harmonie.
MAÏEUTIQUES
 Chair
de nos mères, paroles de nos pères. Quand la parole prendra-t-elle chair si la
chair est impuissante à livrer parole ? Le fleuve du temps voit chaque
père reprendre insensiblement ses gammes sur le père enfoui avant lui… en
prenant soin du père à venir. Chaque génération penche sur la suivante un
regard attendri, au risque de s’y perdre. Père présence, disparition, force.
Père calme, peur, refuge. Père oubli, patronyme, transparence. Tous pères
solidaires. Et si les pères sacrifiaient leurs goûts, leur consistance, et
jusqu’à leurs rêves pour dédouaner d’antiques pères absents, fantômes demeurés
à l’état de trace, d’ébauche, car trop vite disparus, évaporés. Mais quel père
est-il vraiment comptable d’un autre alors que tous le sont par hérédité
ordinaire des âges, sourde voie d’héritage ? Devoir vital d’échapper au
long cortège de la malédiction des pères. Oser sortir de la lignée immémoriale
pour rester au guet d’un chemin singulier et solitaire, à la croisée de tous
ces pères possibles à épuiser… sans en élire aucun.
Chair
de nos mères, paroles de nos pères. Quand la parole prendra-t-elle chair si la
chair est impuissante à livrer parole ? Le fleuve du temps voit chaque
père reprendre insensiblement ses gammes sur le père enfoui avant lui… en
prenant soin du père à venir. Chaque génération penche sur la suivante un
regard attendri, au risque de s’y perdre. Père présence, disparition, force.
Père calme, peur, refuge. Père oubli, patronyme, transparence. Tous pères
solidaires. Et si les pères sacrifiaient leurs goûts, leur consistance, et
jusqu’à leurs rêves pour dédouaner d’antiques pères absents, fantômes demeurés
à l’état de trace, d’ébauche, car trop vite disparus, évaporés. Mais quel père
est-il vraiment comptable d’un autre alors que tous le sont par hérédité
ordinaire des âges, sourde voie d’héritage ? Devoir vital d’échapper au
long cortège de la malédiction des pères. Oser sortir de la lignée immémoriale
pour rester au guet d’un chemin singulier et solitaire, à la croisée de tous
ces pères possibles à épuiser… sans en élire aucun.
Père
initiateur, passeur de vie, faiseur de traces en vrac, obstiné bricoleur de
petits riens, entêtant poseur de mots sur tout, inlassable épuiseur des
pourquoi et des comment, manitou pédagogue des fines leçons de choses comme des
grands secrets à partager. Père pélican, touchant cousin de nos frères animaux,
prédateur naturel qui s’ignore, bricoleur d’une oralité ludique et dévoreuse
penchée sur la grande marmite fumante des mets et des objets. Papa poule,
rassurant double se glissant dans l’ombre des mères. Père de passage semant au
hasard des désirs, essaimant ici et là, au fil des rencontres ; mateur
indifférent de moissons vite délaissées. Père à jamais virtuel, vieux garçon
recouvrant de la cendre du temps sa généalogie incertaine. Père chef de clan,
grand sachem, vivante statue sur pied, réceptacle des haines comme des
adorations, Commandeur pathétique et terrible. Père récit fascinant les enfants
de contes répétitifs immémoriaux, dansant la gigue en compagnie de lutins
gouailleurs. Père toujours au charbon épuisant le réel, épuisé du réel, puits à
réel. Père conseil, père phare, père copain proche et complice des quatre cents
coups de l’enfance. Père peur de ce qu’il a mis au monde et qui le dépasse.
Père de la Nation, recours unique, symbole toujours au garde à vous, tapi dans
nos consciences collectives et dans la nuit de l’Histoire. Petit Père des
Peuples, sourire chafouin et calculs débonnaires, décrétant le Bien - le sien - urbi et orbi. Père curé semeur de
sermons vides ne tombant qu’entre les oreilles de piafs volages. Père la
pudeur, père la vertu, arborant leurs raideurs primaires et surannées. Camaïeu
miroitant de paternités.
Voguant sur
les ailes de sa métamorphose, le père nouveau - avatar animal du vin primeur -
ranime la flamme de l’antique père oublié qui brûle en lui. Brûle de bien
faire, jure de ferrailler hors des abdications et compromissions. Combat neuf,
vivace, toujours repris à ses fondements. A perpète. Défi ordinaire où s’abîmer
insensiblement. Jusqu’à en oublier le « hors père », cette parole qui
ranime l’envie, renoue avec d’antiques désirs, les primitifs qui ont modelé
l’âme. Origines profondes contre empreintes obligées. Père trace.
Homme sage.
Père Socrate accoucheur des esprits à défaut d’engendrer les corps. Violence du
questionnement socratique faite au disciple ou à l’élève, à qui l’on propose d’accoucher
de… lui-même. Autonomie construite par le fils qui mène son raisonnement
personnel, édifie sa loi propre. Le savoir est en nous, à portée, et nous ne le
voyons pas ! Pauvres prisonniers d’une caverne obscure, il ne nous est
donné que d’apercevoir les silhouettes dansantes animées par de vilains
faiseurs de prodiges. Nous ne voyons que des ombres, nous n’entendons que des
rumeurs, celles de la doxa, de
l’opinion courante véhiculée par tous. Tandis que la plus intime connaissance,
celle de nous-même, nous échappe… Seul l’électrochoc socratique peut déciller
nos yeux aveuglés, confinés dans la vaine critique des apparences.
Le père
Socrate. Homme de tous les paradoxes. Face plate, nez camus, narines
retroussées, œil de bœuf, toujours mal attifé, le philosophe le plus incarné
qui soit fait de sa laideur une preuve
de sa… beauté ! Lui le tenant du canon grec Kalokagathia qui fait s’harmoniser beauté et bonté en proportions
égales. Beau mais laid, bizarre mais rationnel, homme poli toujours en retard, tempérament
de buveur jamais ivre, anti-héros qui fuit la gloire publique, maître penseur
qui refuse de donner la leçon à quiconque, rationaliste évoquant une révélation
divine, révolutionnaire et conservateur au point de se plier à des lois
injustes qui le conduisent à la mort. Homme complexe à l’image d’une vérité qui
l’est tout autant lorsqu’il appartient à chacun de se la concocter pour ce qui
le concerne. Pas de prêt à penser !
On n’apprend
pas, on se remémore. Il faut se défaire de ce que l’on croit savoir - l’opinion
- pour désirer connaître - naître avec.
C’est ce désir-là qui nous rend le savoir intérieur. Apprendre à… désapprendre,
à nous déprendre ! Le dialogue socratique nous conduit à la construction
d’un objet commun repris par chacun à son propre compte. Force de la maïeutique
des âmes.
« Philosopher, c’est apprendre à mourir. »
Détacher l’esprit du corps. Penser des réalités qui, elles, ne meurent
jamais. Platon développe l’Apologie de Socrate en lui faisant retourner
l’accusation contre ses juges. Il est cet homme singulier qui accepte de mourir
au nom d’une vérité qu’il porte en lui et qui lui est supérieure : comment
vivre autrement ?
Accoucher du
savoir, comme de la chair : acte violent, douloureux. Zeus, le dieu des
dieux, en fait l’expérience forte. Saisi de violents maux de têtes, il doit
appeler à l’aide son forgeron de fils, Ephaïstos, pour lui briser le crâne afin
d’en faire sortir sa fille Athena, - née de la tête - pour s’incarner en… déesse de la sagesse.
Naissance cérébrale dont on s’assure de la viabilité en se livrant au rite
antique de l’amphidromie : le
père fait le tour du foyer en brandissant son enfant, lui conférant ainsi sa
légitimité et la reconnaissance sociale aux yeux des siens. Aux affres de
l’accouchement succèdent les moments heureux de l’accueil du nouveau-né. Savoir
et sagesse, en l’occurrence, viennent d’investir le panthéon de la pensée. Pour
une joie similaire aux naissances charnelles : celle qui consacre la force
de l’esprit raisonnant en écho à l’âme résonnante. Puissance du penseur-né prêt
à initier le questionnement porteur de toutes les libertés.
Qui
suis-je, moi seul, hors père, hors repères, tous horizons ouverts ? A moi
seul de le dire. Alors je parle, parle encore. Histoire d’entendre ma propre
voix résonner en moi. Encore une fois. Jusqu’à plus soif. Jusqu’à chanter. Et
puis je danse sur le deuil apaisé des espoirs évanouis.
s’émouvoir. Il y a grande jubilation à la langue en fête. Et à la fabrique des mots.
Traits
d’esprit, allusions, calembours. Equivoques, ambiguïtés. Chaque tournure de jeu
a son originalité propre, ses règles et partis pris. Les enfants nomment
« devinettes » ces énigmes prisées dans les salons d’autrefois.
Paroles obscures, mystérieuses, dont le sens est voilé sous une parabole ou une
métaphore. « Quel animal marche le matin sur quatre pieds, à midi sur
deux, sur trois le soir ?... », demande le sphinx à un Œdipe
circonspect.
Le calembour
a mauvaise réputation : il joue du double sens, des homophonies faciles et
parfois d’un mauvais goût souligné par le grand Hugo : n’est-il pas
« la fiente de l’esprit qui vole » ? Allusion aux petites
caboches de piafs. Plus succincts et actuels sont les allographes en SMS :
liberté DCD, doctrinaires AI répondent aux crédits BC, à la charte LUD.
Embusquées non loin de là, les contrepèteries frôlent le risque d’un goût qui
peut s’avérer douteux : « Partir, c’est mourir un peu ».
La fabrique
des mots tourne à plein régime quand s’éveillent les néologismes. La très
ordinaire « voiture » se découvre des poignées de cousines, déclinées
en argot ancien ou récent : tout à tour caisse, bagnole, chignole, tire, tacot… L’espiègle Frédéric Dard,
amateur mutin, en fourgue à foison dans ses San
Antonio : ses héros battent des ramasse-miettes
pour faire du gringue, se sentent jalminces, s’empaffent dans de joyeuses chicornes,
ouvrent leur boîte à ragoût, sans renauder à la tortore. Ces locdus clapent de la menteuse en éclusant un
scotch, avant de s’esbigner ou de mettre les adjas.
Quant aux
lapsus, ces bourdes involontaires de nos politiciens - « ils m’ont mal sous-estimé »,
assure sans rire un illustre président -, ils fleurissent aussi dans la bouche
de nos plus avisés sportifs ; « à
l’insu de leur plein gré », il va de soi. Le langage informatique
réveille nos imaginaires en forgeant les métonymies « souris, bureau, fenêtre ». Les écrivains s’amusent à
des coagulations phonétiques : « Doukipudonktan
», s’insurge la Zazie de Queneau
prête à découvrir « Singermindépré ».
D’autres s’abandonnent à d’intuitifs néologismes : « Foluptueuse », folle de volupté, « Députodrome », Assemblée Nationale, « Joconder », sourire d’un air
niais.
« On n’habite pas un pays, on habite
une langue », suggère Cioran. Quel rapport de la pensée au
langage ? C’est l’enjeu posé par Rousseau dans son Essai sur l’origine des
langues. On ne peut parler si on ne sait penser, et inversement. Ce que parler
veut dire ?... cela a à voir avec l’origine des facultés humaines requises
pour l’exercice. Il faut bien un surplus d’intention pour que le langage puisse
advenir. Parler, c’est se dire soi-même, parler de son désir, se mettre en
scène à travers les mots. L’enfant n’éprouve-t-il pas un besoin viscéral de
parler dès qu’il s’éprouve comme sujet conscient dans le monde ? Rousseau
distingue le langage signification du langage communication. Et, décortiquant
plus avant le formidable outil, il pointe notre faculté à oublier le
significatif ordinaire pour en isoler une qualité « abstraite ».
Alors que dans un monde sans classification tout serait confus, magmatique,
totalitaire, l’aptitude au langage nous rend capables de mettre de côté, de
séparer, d’ « abstraire » certaines qualités. Un peu comme on
extrairait un fin nectar précis, précieux, d’un chai de cent ans d’âge. Ainsi,
autant le mot « frère » exprime une personne concrète à relation
ciblée, autant l’adjectif « fraternel » renvoie à une idée générale
moins saisissable, plus abstraite et réutilisable dans maints contextes.
Abstraire, c’est aller à l’essentiel du sens, indice certain d’une exigence
intellectuelle. « Le mot effectue le meurtre de la chose »,
confirme Lacan. Le langage, outil d’humanité.
On va
jusqu’à inventer des langues complètes, réplique du plaisir des babils
enfantins, des jeux avec les sonorités, de ces lallations poussées à partir d’
émissions buccales inouïes. C’est le javanais, amusement de potache, jargon
parlé plus que réel codage. On intercale dans les mots les phonologies
parasitaires va ou av : bavonjavour pour
bonjour, savupavermavarchavé pour
supermarché. Non loin, le verlan, autre argot, inverse les syllabes : teubê pour bête, vénère pour énervé, zyva
pour vas-y. Plus ancienne forme au 17e siècle : verjus pour jus vert. Plus sérieux,
l’espéranto, seule langue construite devenue vivante avec des locuteurs actifs
répartis dans la plupart des pays du monde… et relancée par Internet. Langue
d’un « pays enchanté », à l’apprentissage facilité par une absence
notable d’exceptions. On peut rêver en parlant neuf.
Slam et rap contemporains mènent plus avant encore les tentatives de
libérer l’expression par un verbe haut et fort. Les mots riment et rythment à
tire-larigot, entraînent une musique de la langue qui nous emporte au cœur de
l’émotion, ne nous lâche plus, nous ensorcelle. Réminiscences du scat - onomatopées aléatoires de la voix
escamotant le code musical - propre au jazz. L’inspiration déborde, se lâche,
emporte le langage dans un délire inventif sans limite et sans fin.
On est loin
de la sage « étymologie » - « recherche du vrai », au sens…
étymologique - toujours en quête du sens, au plus près de l’histoire réelle des
mots, de leur pérégrinations obligées d’une mémoire à une autre. La langue ne
se sent bien qu’en état de permanente invention. Dans la suspension inattendue
des envols à la Desnos : « … le
cœur sur la main et la cervelle dans
la lune ».
ENFANSONGES
 Art du rêve. Rêve d’enfance. Enfance de l’art. Toute
une vie se résume sur la surface d’un seul tableau aux couleurs multiples.
Grand carnaval des animaux figuré par le peintre passionné des origines de la
vie. Entrelacs de scènes anthropomorphiques où hommes et bêtes mêlés emplissent
un univers pictural nourri aux souvenirs enfantins. Visions et fragments de
réalités côtoyées ou entrevues. Echos fertiles et touchants offerts au jeu
candide des associations. Naïveté d’un regard naissant sur la magie possible du
monde. La vie paysanne déploie son réalisme ingénu. L’homme devenu adulte se
plaît à ranimer l’enfant assoupi en lui. Songes éveillés pour enfançons ravis.
Art du rêve. Rêve d’enfance. Enfance de l’art. Toute
une vie se résume sur la surface d’un seul tableau aux couleurs multiples.
Grand carnaval des animaux figuré par le peintre passionné des origines de la
vie. Entrelacs de scènes anthropomorphiques où hommes et bêtes mêlés emplissent
un univers pictural nourri aux souvenirs enfantins. Visions et fragments de
réalités côtoyées ou entrevues. Echos fertiles et touchants offerts au jeu
candide des associations. Naïveté d’un regard naissant sur la magie possible du
monde. La vie paysanne déploie son réalisme ingénu. L’homme devenu adulte se
plaît à ranimer l’enfant assoupi en lui. Songes éveillés pour enfançons ravis.
Place d’un
village - Vitebsk - comme scène d’un
théâtre familial, rural, jouant les épisodes familiers de la vie quotidienne du
menu peuple. Derrière ces bohèmes modestes, sans le sou, l’enfant qui fut
ranime la tendresse d’un regard qui n’a rien oublié. Marc Chagall - le peintre
candide - aime voir le monde comme les enfants seuls savent le recréer :
merveilleux. A ses yeux, ce sont eux qui ont raison. Leur sens du surnaturel parvient
à dévoiler une magie où les gens marchent sur la tête, volent comme des
oiseaux. Où les vaches s’abritent sous des ombrelles, où les corps flottent
dans les nuages. Où des animaux aimables jouent du violon. Un univers parallèle
que l’imaginaire jubile à renverser cul par-dessus tête, parmi un flot de
couleurs qui éclatent et pétulent.
Et mille
autres trouvailles. Un violoniste rigolo au visage peint en vert joue, sur le
toit de sa maison, une musique au plus près du ciel. Il neige sur le village et
l’église a un curieux petit clocher rond comme un oignon. Un village assez
pauvre, perdu dans la campagne, arbore fièrement ses maisons de bois. Non loin,
une poule géante emmène un rêveur sur son dos. Le peintre a décidé de raconter
son histoire en redonnant vie à ses proches, ses voisins, ses animaux préférés.
Sans oublier ses objets familiers : le petit violon chante toujours la
même chanson.
Un autre
jour, l’enfant-peintre s’en va avec son oncle au fond des campagnes chercher
des bestiaux dans sa carriole cahotante. Alors il peint ces animaux qui lui
sont chers : vaches, ânes, chevaux. Et puis aussi coqs et chats. Il leur
fait la fête en coloris vifs, en bleu, en rouge, en vert. Tant ils font partie
de lui, de son histoire. Tant il les aime. La mémoire de l’enfant jette
pêle-mêle sur les toiles du peintre ses objets familiers préférés. Horloges,
crucifix, chandeliers entreprennent une curieuse farandole. Une horloge est
emportée dans les airs par un poisson ailé qui joue du violon. Tandis que des
silhouettes d’amoureux se nichent dans les buissons. Les doux bonheurs se
lovent à l’abri du fil tourmenté de l’histoire.
Et lorsqu’un
cirque s’installe sur la place du village, on tourne, on danse, on se promène
la tête en bas. Acrobates, écuyères, trapézistes s’animent de couleurs
pimpantes. Les têtes se dévissent, se décrochent. Les corps se courbent,
s’arquent en des ondulations improbables mais toujours touchantes, élégantes.
Avant que tous ne remontent sur les toits hospitaliers. Une vache rouge y
nourrit deux verts enfançons, clin d’œil du peintre à l’antique légende romaine
des frères jumeaux Romulus et Remus. Scène paysanne chaleureuse qui sent
l’étable, en contrepoint à l’espace cosmique éthéré. La fermière qui
s’apprêtait à traire la bête en perd… la tête ! La vache nourricière se
fait vache céleste qui engendre l’univers et les astres. Couronnant ses héros
sympathiques, en guise de protection et d’heureux destin, Chagall installe à
leur intention un ballet d’étoiles filantes illuminant la nuit sombre. La
lumière défie l’ombre.
Prophètes et
rois de la Bible viennent se mêler à la fête, escortés par des bambins
séraphiques. Adam et Eve sont de retour dans un paradis envahi de fleurs. Tout
en haut, un ange allume les bougies célébrant la recréation d’un Eden trop tôt
envolé. Réalité et sacré se mettent au service d’une même révélation au cœur de
la grande célébration picturale d’un éternel printemps de la vie. Chagall,
guetteur d’humanité, est l’inventeur de l’un des plus beaux bestiaires qui
puise son énergie dans le bouillonnement, les tensions, les déchirements de
l’inconscient. L’exil, la solitude, la nostalgie s’éclairent de cris, de
stridences colorées. Du sang de l’histoire, il puise sa couleur première. Des
spasmes et agonies terrestres il tire le goût des envols vers les images du
rêve. A la rencontre d’un mythe moderne qu’il crée à hauteur des enfants que
nous sommes tous. A hauteur de sa modestie : « Moi, vous savez, je suis un pauvre homme : je doute. Il n’y
a pas de secret chez moi. J’ai fait mes tableaux, tout est là. Il n’y a rien à
ajouter. »
Et pourtant,
le peintre devenu adulte sait entretenir avec ferveur ce paradis naïf de
l’enfance. Aux épreuves douloureuses de la vie il oppose crânement sa
résistance personnelle et artistique.
Bleu contre jaune, rouge contre vert, le grand gosse aime à se jouer des
couleurs en les opposant entre elles. Maniant les chromatismes du rêve, il
invente pour ses personnages des barbes tour à tour violettes, bleues ou
vertes. Primitif et Fauve à la fois, il s’offre la liberté de mettre de la
couleur où il veut. Un délicieux âne vert ouvre son bestiaire enchanteur où des
animaux ravis assistent à la valse des corps et des têtes. Non décidément, ce
poète n’a pas la tête sur les épaules, apportant crédit au dicton
yiddish : « On dit de quelqu’un que sa tête vole dans le ciel
quand il se laisse emporter par sa fantaisie. » Il aime jouer de la
métaphore et du souvenir palimpseste : la mémoire du village est à Chagall ce que la vache est au
veau : une mère, un lieu d’origine dont on ne se défait jamais tout à
fait.
Ivre
d’images, de sensations, d’idées, le peintre plante un couteau au cœur de sa
toile, évoquant la violence de la création et l’irruption de l’imaginaire et
des passions dans l’univers quotidien des objets familiers. L’éternel enfant
rêve ou cauchemarde -c’est selon - entre tradition juive et folklore russe,
contes de Gogol, fables de La Fontaine et épisodes de la Bible. Serait-ce lui,
déguisé en Minotaure songeur vêtu de rouge, enveloppant une jeune femme
recouverte d’un foulard à la mode russe ? Lui encore ce personnage tombant
du haut de la toile et glissant sur la surface enneigée ?...
La tête à
l’envers, l’homme poète réfléchit hors de soi. A l’image du peintre travaillant
ses scènes dans tous les sens, les accrochant même parfois à l’envers. Happés
par l’apesanteur, nous pénétrons la tête la première dans le chaos primitif du
paradis naïf, coloré, de l’enfance. « Mon
cirque se joue dans le ciel », nous souffle Chagall.
PALETTE
 Puissance du
coloriste. Violence des éclats de lumière. Sensations tactiles optiquement
suggérées par les matières. Métal, ciels, soies ou chairs ouvrent autant
d’univers parallèles que nos regards pénètrent sans en croire vraiment leurs
yeux. L’artefact pictural transmue nos réels en autant d’éclats de vie toujours
déjà là où coule la source de nos mondes intérieurs. Devant nous l’incroyable
auquel il nous est soudain donné de croire, le voilé dévoilé, le figé habité,
l’éthéré tangible.
Puissance du
coloriste. Violence des éclats de lumière. Sensations tactiles optiquement
suggérées par les matières. Métal, ciels, soies ou chairs ouvrent autant
d’univers parallèles que nos regards pénètrent sans en croire vraiment leurs
yeux. L’artefact pictural transmue nos réels en autant d’éclats de vie toujours
déjà là où coule la source de nos mondes intérieurs. Devant nous l’incroyable
auquel il nous est soudain donné de croire, le voilé dévoilé, le figé habité,
l’éthéré tangible.
L’ampleur de
la palette déploie ses nuances comme l’instrumentiste répète ses gammes. Avec
infinie patience, régularité métronomique, souci du détail. L’échelle
chromatique expose ses touches quasi sonores aux demi-tons troublants. Les
rouges s’animent, s’apprécient, se prêtent à sens. Le vif carmin - colorant
extrait de cochenilles - nous invite aux plaisirs capiteux et nocturnes de la
cité proche. C’est le rouge profondeur, le rouge passion des franches et
fastueuses bombances. A sa marge pointe le magenta, rouge violacé, mélange de
lumières bleu et rouge. L’une des trois couleurs primaires, avec le cyan et le
jaune, utilisées en quadrichromie, avec le noir. Non loin, le rouge bordeaux,
foncé, grenat - silicate naturel aux accents de pierre précieuse ou de teinte
vineuse. Le rouge vire au pourpre - extrait de mollusque enflammant les
tuniques romaines - qui, injecté de jaune, vire au sang caillé, dernière étape
avant le rouge brun du sang séché. Le rose enfin, joyeuse outrance, noie les
bleus célestes, trop profonds, d’une nuance d’ironie bienvenue : fané
comme un « vieux rose ». Jusqu’aux limites du rose fuchsia où percent
parfois des atmosphères déliquescentes dans des paysages de boue ou de feu. Des
rouges se dégage une teneur charnelle que l’on croirait parfois porteuse du
tanin extrait des rafles de son raisin par le viticulteur. Les rouges savent
donner tout leur alcool à des compositions charnelles ou crépusculaires.
Il peut
arriver que les couleurs s’échappent de la palette, subrepticement, à l’insu du
peintre. S’incrustant dans les profondeurs du langage ordinaire, elles y mènent
des vies parallèles, à travers métaphores et images variées issues de sagesse
populaire. Echos climatiques, échos chromatiques. La matière des ciels se
charge de masses cotonneuses où jaillissent des embrasements de fin du jour.
Bleu ciel, bleu nuit profonde, bleu intense, outremer qui s’impose en plein
jour. Aquatiques reflets bleus explorés sans fin par les impressionnistes. Bleu assaisonné de rouge pour en exprimer la
valeur violacée. Bleu léger où s’évanouit l’horizon, où s’estompe l’azur. Sang
bleu, sang noble. Conte bleu fabuleux. Houille bleue, énergie des vagues, des
marées. Peau bleue frappée par l’œdème. Maladie bleue. Bleu couleur spectrale
entre vert et indigo. Bleu pervenche, mauve. Bleu de Prusse, de cobalt, résidus
métallifères. Fumée bleuâtre de cigarette. Bleusaille affrontant des peurs
bleues. Affleurement bleuâtre des veines qui serpentent sous l’épiderme.
Bleuet, centaurée parsemant les blés d’or. Reflets bleutés. Les bleus
parcourent nos réalités familières.
Face à tous
ces coloris capiteux ou communs, picturaux ou langagiers, seul le blanc foudroie
sur la toile. Pas seulement parce qu’apposé à l’état pur, mais grâce à la gamme
des gris, plus subtils les uns que les autres, qui en nourrissent la
luminosité. Effets satinés sur drapés de coton coulant en rivières lumineuses
qui, lorsque le tissu se relâche, composent les morceaux d’une peinture quasi
abstraite aux transparences liquides.
Jeux
combinatoires du peintre qui fait dégouliner de ses tubes une seule, puis deux,
trois, quatre des couleurs de sa palette de base. Sans oublier son or toujours
présent à l’état de poussière ou de mélasse bruineuse. Le pari consiste à
tenter d’épuiser toutes les combinaisons chromatiques pour autant d’atmosphères
imprégnant la toile. Et à capter cette coïncidence - éphémère par nature -
entre la trace visible du pinceau et la part de réalité qu’il figure.
L’éphémère confine à l’éternel, l’espace d’une toile.
« Touche avec les yeux », intime-t-on au jeune enfant ébahi.
Conseil cruel ou fertile injonction ? Fourmillements et démangeaisons
tactiles témoignent d’une permanence dans l’appréhension sensible des couleurs.
Comme la trace de réminiscences d’un éden antique. Celle de notre ancêtre des
cavernes découvrant l’intense plaisir de plonger ses mains dans la fraîche
consistance des argiles molles. Euphorie aussitôt prolongée par la vision d’un
premier - et grossier - nuancier d’ocres terreux. De la couleur tirée des
éléments aux palettes de la Renaissance… De la main au regard, du regard à la
main… La palette se fait support de matériau comme d’intentions. L’artiste y
dépose les virtualités de l’œuvre à venir. En attente de polychromies étonnées.
BIOPHONIES
Isolation, normes, protection, l’acoustique prend des airs de repli dans l’ordonnancement, la restriction, le contrôle. Notre capacité à entendre ne procéderait-elle plus que par soustraction, annulation, disparition ? Sommes-nous à ce point tentés, hantés par le silence ? Et qu’en est-il de la signature acoustique propre à tout ce qui vit ?
 Car le vital
bruisse de mille émissions aux fonctions ordinaires ou inattendues. Créations
buccales de tous ordres, entre borborygmes, flatuosités, gargouillis bizarres,
plus ou moins infâmes, ou nobles vocalises célébrant l’esthétique. Murmures
signés, codes inscrits au plus secret des organes intérieurs. Chahut sonore de
la corporéité se rappelant à notre bon souvenir comme à notre plus fine écoute.
Car le vital
bruisse de mille émissions aux fonctions ordinaires ou inattendues. Créations
buccales de tous ordres, entre borborygmes, flatuosités, gargouillis bizarres,
plus ou moins infâmes, ou nobles vocalises célébrant l’esthétique. Murmures
signés, codes inscrits au plus secret des organes intérieurs. Chahut sonore de
la corporéité se rappelant à notre bon souvenir comme à notre plus fine écoute.
Stridulations insistantes des cigales. Grincement de dents chez le
poisson-perroquet. Rumeurs fauves des cétacés marins, dont l’intensité, si elles
étaient produites dans l’air ambiant, équivaudrait à la décharge d’une arme à
feu de gros calibre à quelques centimètres de notre oreille. Puissance sonore de
la crevette pistolet, corpuscule de quatre centimètres émettant -
proportionnellement à son poids - un souffle sonore neuf fois supérieur à celui
d’un orchestre symphonique.
Les animaux
peuvent aussi adapter leurs comportements acoustiques. Un enregistrement en
fait foi : l’orque imite l’aboiement de l’otarie aux fins de l’attirer et
de la dévorer. Des papillons de nuit parviennent à brouiller les signaux des
chauves-souris prédatrices. Défense du territoire, chasse, accouplement ou
simple jeu… Quel que soit l’objectif d’un signal, celui-ci doit être audible et
sans interférences. Précision millimétrée de Dame Nature.
Y a-t-il du
hasard dans la nature ? L’origine et l’évolution de la vie relèvent-elles
de ce hasard ? Des savants parlent d’une probabilité quasi nulle à ce
sujet. Les mouvements des masses nuageuses, les tourbillons produits pas l’eau
d’un fleuve sont comme le trajet d’une boule de billard : autant de
phénomènes soumis à variations, à digressions, échappant, à un certain moment,
à toute prévision. C’est une longue suite de mutations heureuses qui ont fait
de l’homo sapiens ce qu’il est
devenu. En physique, beaucoup de phénomènes n’obéissent à aucune loi. Pour
autant, la métaphysique classique ignore la notion de hasard. Selon Spinoza,
Dieu « existe librement (quoique
nécessairement) parce qu’il existe par la seule nécessité de sa nature ».
Puisqu’il est infini, qu’il est partout dans la nature, il y a partout de la
nécessité et non du hasard. A la lumière des sciences modernes, on peut
aujourd’hui se poser la question des limites - toujours provisoires mais bien
réelles - de nos connaissances. Et donc de la nécessité de leur actualisation
permanente. En biologie moléculaire, l’opposition hasard / nécessité n’est
ainsi pas une contradiction. D’un côté, il y a le hasard des mutations
génétiques. De l’autre, il y a la nécessité, pour tout organisme, de résister
au milieu et de s’y adapter. Une mutation favorable à la survie sera retenue,
une mutation défavorable sera éliminée. Hasard et nécessité.
L’univers du
vivant crée l’harmonie sonore au sein d’un grand orchestre animal. Tempérée ou
tropicale, chaque forêt génère sa propre signature acoustique, expression
spontanée, organisée, des insectes, des reptiles, des amphibiens, des oiseaux
et des mammifères. Le cerf brame pour inaugurer la saison des amours. Les
grenouilles arboricoles du Pacifique se disputent la fréquence de la bande
acoustique : l’une coasse, suivie immédiatement par une autre sur un
registre plus aigu… et l’orchestre se met en branle. Un paysage sonore africain
baroque, est révélé par l’analyse fine des spectrogrammes : les insectes
tissent la toile de fond, chaque espèce d’oiseau pose sa touche, les serpents,
singes et grands félins complétant les niches de l’espace sonore. L’orchestre
est au complet.
Plus de
quinze mille sons originaux interrogent notre curiosité dans ce répertoire
méconnu des espèces animales !
Auxquels se mêlent ceux, plus familiers, de la géophonie : vent,
eau, pluie, mouvements du sol… Et ceux, plus contestables, de notre propre
cacophonie humaine : extraction minière, exploitation forestière,
étalements urbains et pollutions conséquentes, qui réduisent d’autant la
superficie des habitats sauvages… et perturbent gravement le grand orchestre
naturel.
Tendons
notre ouïe. Le vent agite quelques feuilles. Un pinson des arbres s’essaie à
quelques gammes, tandis que le coucou engage résolument sa rengaine têtue. La
vocalise en spirale du pouillot véloce rompt le silence et gonfle l’espace.
Chaque arbre a sa musique propre, qui varie selon la saison. Rude, rugueuse,
plus sourde, l’hiver. Ronde, pleine, proche du ronronnement, l’été, alors que
la végétation au sol se fait craquante. Le monde forestier bruisse de sons que
le visiteur ne perçoit plus. Manque d’habitude ou simple distraction. Seule
l’oreille aux aguets saura distinguer les nuances. Bienveillances de
l’attention.
Mais comment
reconnaître, entendre des sons que l’on n’écoute plus ? En perte de
références, note sensibilité diminue. Rampante, insoupçonnée, notre surdité
s’installe sans crier gare. Le grand orchestre de la nature s’éteint peu à peu.
Inscription à :
Commentaires (Atom)