vendredi 3 juillet 2015
Bill Evans Trio - Nardis
CLINAMEN
L’homme écoute
le silence. Comme il sait voir le vide. Silence et vide, il sait les faire
chanter. Depuis son rivage, il regarde s’agiter le monde. Avec l’art de
demeurer à distance pour regarder et bien voir. Télé-spectateur à l’antique, son bonheur peut dépendre d’une
simple pluie.
Comme tous
les enfants, le poète est fasciné par les innombrables grains de poussière
s’agitant en tous sens dans un rayon de soleil matinal. Son clinamen à lui est l’ancien nom donné au mouvement brownien,
fourmillante turbulence de cellules sous l’œilleton du microscope. Là où
particules et molécules folles font s’agiter son inframonde, invisible au
passant ordinaire.
Tout
s’affaire à son rythme propre, rien ne naît de rien. Les atomes s’agencent au
gré de chutes hasardeuses, aléatoires, d’où jaillit la matière. Pluies fertiles
d’éléments natifs. Poussière et lumière mêlées évoquent les rapports entre
humains. Rencontres physiques, mystérieux entrechocs qui figurent aussi le
sentiment amoureux. De la chute de pluies diverses naissent toutes nos vies.
Giboulées
rigoureusement verticales, sans variation ? Sans déviation ? Sans
erreur ? Non. Ce sont d’infimes écarts dans la trajectoire de ces chutes
qui créent justement du nouveau. Il arrive que les atomes dévient de leur chute
programmée. Ronds, durs, lisses ou crochus, on les imagine à la ressemblance de
notre monde connu. Derniers – et premiers – degrés de la matière, ils sont
divisibles à l’infini, encore et toujours providentiels. Dans les courses au
destin, leur chant naît du silence. Comme l’animé sourd de l’inanimé.
Clinamen, imperceptible variation du
destin qui contrarie le rectiligne ordinaire, attendu, pour nous offrir
l’écart, la dérive originale d’où surgira le surprenant. Le déconcertant, l’étrange. La vie naît de l’agencement fortuit de
l’inanimé. Des blocs de météorites, déchets refroidis d’astres bouillants,
s’agglutinent dans l’espace pour refaire de la vie. Sempiternel mécano de la
matière.
Entre chaos
et ordre, la pluie d’atomes ouvre les horizons de notre liberté. Elle rend
possible un passage à inventer. Entre désordre de relations multiples et
affolées où chacun cède aux émotions et entretient leur flux électrique. Et désir
de comprendre, d’expliquer, d’imaginer d’autres lieux où vivre l’utopie.
Notre monde
bouge, rien ne semble devoir rester immobile. Il est un texte dense que l’œil
parcourt en s’accrochant à des parcelles de sens qui l’interrogent : les
idées sont-elles des corps ? Ne sommes-nous que des agrégats
d’atomes ? Et si la matière est divisible à l’infini, comment atteindre le
principe de toute chose ?
Captée dans
l’infiniment petit, l’image d’un synapse serait-elle la photo d’une idée ?
Une manière de porte manteau cérébral ? La matière, substrat de toute
chose, fait pleuvoir ses éléments dans une précipitation constante, patiente,
silencieuse.
Macrocosme
et microcosme s’assemblent dans une même image de fourmillement des corps, de
séparations et de rapprochements successifs, incessants.
INTIMUS CIRCUS
Un discret chapiteau rouge posé là comme par magie. Les
gradins surplombent une petite piste ronde enchâssée parmi les spectateurs. La
minuscule arène est cernée de loupiotes aux couleurs de l’étrange. Ce que vous
verrez là aura la tonalité à la fois crue et tamisée des rêves et des
souvenirs. Et le charme entêtant d’un filtre enchanteur. La poésie de cet art,
c’est son imaginaire de baraque de foire.
« Fais
pas ton cirque ! », intime-t-on aux enfants turbulents. Inversons cet
appel au calme pour en faire un désordre joyeux, une pagaille organisée. Un
droit à la mélancolie aussi. On se sent vite pris dans les filets délicats d’un
climat d’étrangeté, inquiétant par moments, surréaliste souvent. Voici les
clowns blancs. Le diable rouge. Les clowns noirs. Et puis toutes les images
fantomatiques et saisissantes du cirque, comme dans un théâtre d’apparitions
auquel il faut s’abandonner sans résistance pour ce qu’il convoque d’émotions
pures, viscérales. Il y aura donc des clowns, des dresseurs de fauves, des
acrobates, des jongleurs. Des pantins, des marionnettes, des automates. Et
leurs diaboliques tireurs de fils, en coulisse.
Et puis de
l’action, du geste – de la geste –, des prouesses. Homme-Hercule et diablotin
ailé s’aimantent, se repoussent. Leurs corps jonglent l’un avec l’autre, comme
le feraient deux pôles irrésistiblement jumeaux. Leurs mimiques épurées
suscitent des ébauches de songes. Force et grâce, ces deux-là font l’essence du
spectacle vivant. Un pantin exécute un numéro de barre fixe, lancé dans l’espace
par une impulsion mécanique, mystérieusement animé par un jongleur qui fait
tourner la barre sur un rythme saccadé. Le pantin sidère en mimant l’acrobate
humain. Ces héros du cirque figurent le pliable et le manipulable à l’infini. Ils
sont les métaphores de l’homme-marionnette, du Polichinelle si cher à la comedia del arte. Tradition et modernité
s’explorent dans une passion mutuelle.
Un duo de
clowns – des augustes – drôles,
menaçants, troublants, mettent en scène le désir de battre, de gifler, de
mordre. De tuer ? Les clowns mêmes seraient-ils devenus méchants ?
Retournement inquiétant des valeurs.
Dans leur
arène de poche circulaire, tous affrontent le vide et la mort. Sans avoir l’air
d’y toucher. La muleta agitée ici et là est le rideau rouge de notre petit
théâtre intime, entre fantasmes entrevus et bravoure folle.
Le cirque,
seule école de vie où l’athlète et le clown – le muscle et l’émotion – savent
se tenir la main, faire bon ménage. La palme va au marionnettiste qui, dans la
coulisse, manipule tous ces corps qui jubilent. Il est le grand maître de la
pantomime ambiante.
Entre
clameur et silence, le cirque fait son théâtre, ou l’inverse. Tous mêlent leurs
histoires et l’insatiable plaisir de jouer les noces irréelles entre forces du
ciel et de la terre. Entre veille et sommeil, rêve d’enfant ou chimère
d’adulte, le cirque c’est celui que l’on se crée. Lorsque les impressions
diurnes s’éclipsent au profit de la fantasmagorie des songes. Rondes d’images
parfois teintées de blues.
Le carrousel
de nos vagabondages d’enfance.
CHEFFERIE
Hymne martial et coups de menton. Le drapeau national
flotte fièrement au vent de l’Histoire. Le bon peuple a besoin de signes pour
sentir battre son cœur, se féliciter d’en être, se rassurer collectivement. Le
patriotisme citoyen s’incarnera toujours dans un personnage à la mesure du
récit national. Et pour reprendre ce flambeau sensible en s’extrayant du lot,
certains savent surjouer les postures
hautaines, faussement graves et risiblement nobles.
Expert dans
l’art de cultiver son rapport à la verticalité, l’homme providentiel a bonne
presse. En père protecteur, il offre son giron rassurant à tous les grands
enfants que nous sommes restés, en quête d’affection, de reconnaissance,
d’espérance. Le pays est une grande famille à gérer, à sauver, ou à remettre
dans le droit chemin. Et le vrai chef sait se trouver toujours là où il
convient pour imposer sa loi aux fratries belliqueuses.
Autoritaire,
le passé pèse du poids des habitudes, des rites, des institutions mises en
place. Il plane un climat bon enfant lorsque les regards se fixent ensemble – comme un seul homme – sur la ligne bleue
des Vosges. Mais un simple regard sur l’Histoire vient nous rappeler qu’un
mythe ancien et partagé alimente la fabrique contemporaine, et toujours
d’actualité, de l’homme providentiel. Comme il nous faut le pain et le vin
quotidiens, nous ne pouvons nous passer de nos grands hommes. La verticalité
nous rassure tant elle nous tient confortablement hors du jeu des
responsabilités. Quand la chefferie perdra-t-elle cette aura sacrée qui plombe,
sans qu’il s’en doute vraiment, le citoyen ordinaire ?
L’émergence
moderne de mouvements sans leaders – les Indignés, les Anonymes – dit notre
aspiration à plus d’horizontalité. Pendant des siècles, on a ressassé aux
masses qu’elles ne sauraient survivre sans chef pour les guider. Avec, en toile
de fond, le péril sourd des infantilisations rampantes. Jusqu’à quand la
virilité à l’ancienne poursuivra-t-elle sa tâche démobilisatrice ?
Il est
urgent de démythifier tous les sauveurs potentiels, tenants têtus et douteux
d’une épopée permanente. L’autorité pyramidale a vécu. Une nouvelle matrice
esquisse enfin la figure proche du chef d’équipe, animateur à l’esprit
coopératif. Le patron de droit divin, claquemuré dans son bureau, loin de ses
salariés, semble avoir pris du plomb dans l’aile. Chacun avait pris l’habitude
de camper sur des positions stéréotypées : le chef au sommet de la
pyramide, la base plongée dans l’anonymat. Et la conséquence probable du choc
frontal en guise de relation d’autorité.
L’intelligence sociale, basée sur des comportements plus horizontaux,
ouvre de nouveaux critères du travailler
ensemble : rassembler des équipes, déléguer et faire confiance,
communiquer, mobiliser. La légitimité du dirigeant devrait reposer sur la
justice et l’exemplarité. La médiation veut
s’instaurer en règle commune, permettant d’alléger les conflits,
remobilisant des troupes apaisées et recentrées sur la tâche. En toile de fond,
l’instauration d’un pragmatisme vivable. A hauteur d’humain.
La
sempiternelle épopée verticale a pris figure de carton pâte.
DEMOCRATIE
Déni
et absurdité. Les choses tournent en rond, n’en finissent pas d’alimenter une
ritournelle devenue insensée. Le citoyen démocrate assiste médusé au délitement
du système qui s’affichait pourtant comme celui de la vie bonne. Toute une manière de penser, d’organiser le monde se
dilue dans une impasse à laquelle il participe pourtant… sans le savoir – ni le vouloir – vraiment. Et
sans adhérer activement au droit de donner son avis. Que reste-t-il du « parler, écouter », bases du débat, le cœur battant de l’exercice
démocratique ?
On laisse
inoccupés de très nombreux logements citadins qui pourraient dépanner des
milliers de sans-logis abandonnés à la rue. Croyant bien faire, les
responsables publics autorisent la création de parcs d’attraction grandioses
qui dévorent des espaces naturels irremplaçables, dédiés au bien commun depuis
des lustres. Logique implacable du « détruire pour créer ». Nos Etats
de droit s’entendent au plus haut niveau pour acheter un droit à polluer devenu
naturel. Nos responsables élus cèdent devant des pouvoirs financiers toujours
plus voraces et directifs. Les affaires privées soudoient les intérêts publics.
Que reste-t-il de nos parcelles de liberté collective, de solidarité active ?
La
démocratie meurt à petit feu, faute d’être pratiquée dans le débat citoyen. En
lieu et place, les médias mettent en scène des caricatures de disputes qui
virent à la parodie permanente. Laïcité, vie collective, intérêt général, les
mots se vident de leur sens et de leur vertu, à force d’être répétés sans
effets, sans suites données. On n’y croit plus.
Les
« urnes » sont délaissées, accentuant encore l’impression ambiante de
grande fatigue démocratique. Pourquoi confier le pouvoir à des gens qui mentent
par omission pour se faire élire, avant d’oublier ensuite leurs
engagements ? A parole publique dévoyée, désert électoral assuré.
L’exercice de la représentation citoyenne s’épuise. Le dictionnaire lui-même ne
donne-t-il pas un premier sens inquiétant au mot « urne » : vase qui sert à renfermer les cendres d’un mort ? Le présage ne manque
pas d’être troublant.
Une longue
et lente fatigue démocratique nous envahit. Et nous pousse à laisser souffler
un grand air de désenchantement.
C’est
oublier un peu vite que nous vivons dans les sociétés les plus libres, les plus
tolérantes, les plus riches et les moins inégalitaires que l’histoire a
connues. Comme tout ce qui est bon, la démocratie ne brillerait-elle que par
l’hypothèse de ce que nous serions en son absence ? Ne séduirait-elle
vraiment qu’au moment de son établissement ? Avant que l’on en oublie
aisément les vertus et avantages pour la considérer comme un simple dû ?
Manière simpliste de voir le don : à sens unique.
Mais la vie
associative est là, toujours aussi riche, multiple. Et avec elle le souci
accordé au plus proche, l’exercice simple et naturel de la compassion, la
dynamique du travail commun, la recherche et l’accomplissement de projets
collectifs. L’attention à chaque membre de l’ensemble porté par tout membre de
l’ensemble. La société demeure alors ce corps composite qui dessine la
silhouette en creux du peuple vivant.
Le demos n’est pas mort, il bouge encore.
ANTIHEROS
Bardé de sa rancœur et de toutes les frustrations
accumulées, le terroriste avance avec l’assurance du droit acquis, conquis,
requis. Derrière lui, l’armée silencieuse de ceux qui le soutiennent, là-bas,
veut-il croire. Devant lui, l’avenir radieux du martyr qui sacrifie sa vie pour
une cause qui le dépasse. Et qu’il n’a surtout pas pris le temps d’examiner
avec sa raison. Quelle raison ? Réfléchit-on lorsqu’on est mû par la haine
aveugle propre à l’exclu ?
Car il n’est
rien, ne se sent rien, n’aspire plus à rien.
Il est – se veut ? se proclame ? – le produit avarié d’une société pour
lui vide de sens. Son déchet avéré, désigné. Plus que du doigt, des yeux. Du
siège-même des émotions. Arpentant la ville de son enfance, Il ne reconnaît
rien ni personne. Personne ne le voit. Il n’en est pas. Il a intériorisé avec
le temps un espace qu’il a transformé en prison intérieure. En ghetto. A force
d’ondes négatives vérifiées, accumulées, il a devant lui les preuves d’une
exclusion qu’il veut injuste, féroce, irrémédiable. Il en a déjà pris acte,
parcourant un à un les affres minables de la petite délinquance. Mais rien ici
pour se faire reconnaître valablement, durablement.
Comment
passer du mépris de soi à la haine des autres ? Comment surtout rendre
sacrée cette rage qui l’habite, le hante, l’excède ?
Sinon en donnant à son mal-être un sens qui le dépasse, celui d’une justice
ordonnée d’en haut, par un Très-Haut.
Même s’il ne le connaît pas. Surtout s’il ne le connaît pas : il se veut
proche, d’emblée, de ce Grand Anonyme qui lui ressemble et dont il se donne le
droit de confisquer le sceau pour ce qui l’arrange. La fureur qui le dévore en
appelle à des nourritures secrètes, occultes, héritées de ses lointaines
origines, étrangères à tous ces impies, ces hérétiques qu’il côtoie chaque
jour. Le voilà prêt à basculer dans une traversée initiatique qui le confirmera
enfin dans l’identité qui lui faisait défaut.
Lui, le bouc
émissaire d’un système qui l’ignore, découvre le pouvoir insensé de retourner
aux autres leur regard négatif, de se voir enfin vainqueur dans leur yeux
apeurés. Mortel effet miroir. C’est la voie de sa revanche. Le triomphe des absents.
Le prix importe peu tant l’enivrement délivre. Puissance du faire corps : on lui offre le
statut de héros. Le voici chevalier autoproclamé. Il se sent enfin quelqu’un.
Tout est bon
pour alimenter cette deuxième naissance à laquelle il ne croyait plus. Le voilà
prêt à tout, au service aveugle de cette sacralité qui l’a vu renaître enfin.
Lui l’ancien banni a trouvé la cause
qui fera de lui un héros. Le héros
parmi une foule de prétendants avec qui rejouer – à armes égales cette fois –
un nouveau spectacle mimétique. Une grand-messe où la surenchère est la règle,
où la perfection prend des airs de quête infernale. D’un enfer à l’autre,
quelle différence ? Celle de choisir, justement, d’en être ? Celle de
la pureté absolue du soit disant martyre consenti. L’anti-héros est prêt.
Il n’a pas
raison ? Peu importe : il a le pouvoir de se donner raison. S’inscrivant sur le grand marché de la
martyrologie, sait-il que sa victoire intérieure sera de courte durée ?
Tant l’illusion et la folie sont les moteurs pervers des héros négatifs. Leur
carburant fétide pour embraser les destins, perdus d’avance, de ceux qui,
n’ayant plus rien à perdre, jettent toutes les vies – les leurs comme celles
des autres – aux horties de l’Histoire.
L’infernale
mécanique du retour au même et à l’identique a gommé toute altérité et creusé un vide cérébral abyssal. La
radicalité a mystifié l’exigence. Tué l’intelligence.
Produit
pervers de l’effet miroir, la haine est fille du désespoir.
SOUFFLEUR
Retour à la
soupe primitive. La boule rouge ondoie, hésitant entre fusion et calcination,
fragment arraché à une très lointaine coulée de lave. L’homme la tient au bout
de sa canne comme aux rets de son regard fasciné. Son visage perle de la sueur
qui accouche. Du matériau brut jaillit l’œuvre en état d’éruption. Passage
secret de la nature à la culture.
Ce que
dompte ce moderne Vulcain, c’est un lambeau de pierre de lune. Un peu du noyau
des origines abandonné par le créateur au centre de la planète bleue. Vomissure
d’étoile, crachure de volcan, le cœur en fusion trahit sa présence enfouie au
plus profond, entre pelure et centre nucléaire.
Par quelle
magie la boule de pierre et feu mêlés est-elle en passe de se transmuer en
verre cassant et transparent comme la glace ? Le souffleur en tait le
jaloux secret. Il n’écoute que son poignet élastique tournant et retournant la
canne creuse animée d’un souffle redevenu divin. Mimétique, son geste figure
celui du musicien explorant les trésors infinis de la gamme. La main rêve à la
pointe de son instrument, comme celle du sculpteur affronte le marbre Ou celle
du potier donne forme à la pâte. Menaçante, la boule gonfle jusqu’à enfler
comme une géante rouge. Retour aux origines du monde.
Ardents
comme ceux d’un dompteur, les yeux du vulcain fixent la chose en sa
métamorphose. Ils guettent, gourmands, l’instant précis du gonflement porté à
son acmé, celui où la forme se fait couleur. Oranges subtils, et jaunes d’or
épanouis succèdent insensiblement aux rouges de feu. Chronologie chromatique
aux fins glissandi de tonalités.
Ardent
rêveur, le maître verrier sait que la difficulté de son métier vient justement
de l’apparente fluidité de sa matière. Faire, façonner, fabriquer, créer. Même
dans l’atmosphère étouffante d’un four à porcelaine où le visiteur oisif peut
croire à l’enfer, l’ouvrier actif n’est plus le serviteur du feu, il est son
maître. Et si c’est une rêverie, elle est active, les armes à la main. Et puis
chaque travail n’a-t-il pas son onirisme propre ? Chaque matière
travaillée n’apporte-t-elle pas ses songes intimes ? L’artisan le
sait : on ne fait rien de bien à contre-cœur, à contre-rêve. Ah ! il songe à un temps béni où chaque métier
aurait son rêveur attitré, son guide onirique, où chaque manufacture aurait son
bureau poétique !
Imperceptiblement, le verre qui tiédit offrira bientôt ses parois
translucides au regard apaisé du verrier appréciant dans ses courbes épurées
l’objet de son ouvrage. Ou – occurrence fâcheuse – si la pâte s’est montrée
rebelle à sa fantaisie, l’artisan déçu la rattrapera en lui accordant la forme
la plus facile à souffler : celle d’une flasque, synonyme d’un fiasco qu’il tentera d’oublier.
Epuisé, assouvi, l’artisan démiurge peut contempler
le fruit de son expir. L’esprit qui anime a su inspirer son geste créateur. Entre
souffle, rêve et travail, le geste a conquis la matière.
Et su
atteindre les régions éthérées de l’âme. Anima
sua.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)


































































































































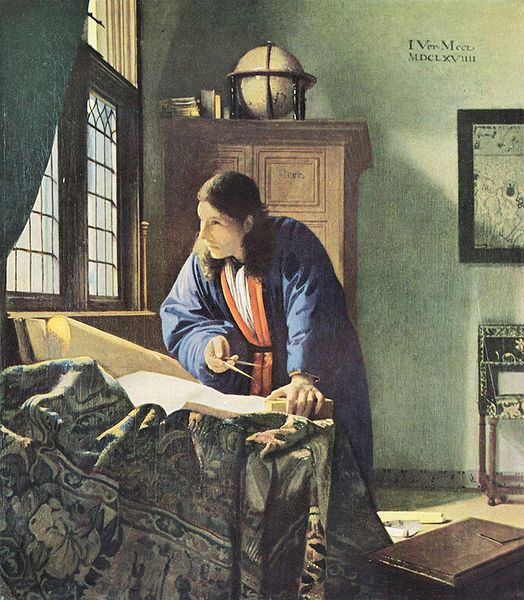














Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire